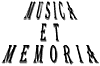Henri Libert
organiste de la basilique de Saint-Denis
(revue de presse)
medaillon2.gif) |
| fragment photo 1930 (BNF) DR. |
Né à Paris le 15 décembre 1869, élève de César Franck et Charles-Marie Widor, Henri Libert remporta le 1er prix de la classe d'orgue du conservatoire de Paris en 1894. Titulaire de l'orgue de la basilique de Saint-Denis de 1896 à 1937, il donna de nombreux concerts et écrivit quelques pièces pour orgue et pour piano, des leçons de solfège ainsi que de la musique vocale sacrée. En 1898, il était candidat avec Charles Tournemire pour le titulariat de Sainte-Clotilde. Il mourut à Vanves le 14 janvier 1937, à l'âge de 67 ans.[1]
« Les concours du Conservatoire
Le concours de piano, avec vingt et un concurrents, avait pour morceau d’exécution la troisième ballade de Chopin en la bémol Selon l'habitude, c'est toujours la classe de M. Marmontel qui tient la corde ; cette année, le premier prix nommé est un enfant de treize ans, M. Delafosse, qui a joué et déchiffré remarquablement. Un second premier prix a été donné à M. Berny.
On supposait que M. Henri Libert, qui, l’an dernier, obtint le deuxième prix, aurait reçu le premier cette année, par la façon brillante dont il a joué — il n’en a rien été. C’est chose ajournée. »
(Le Sud-Ouest thermal et balnéaire, 1er août 1887, p. 3)
« C'est vendredi prochain qu'aura lieu à Rouen le grand concert d'orgue donné par M. Henri Libert, le brillant élève de Widor.
Au programme, la Sixième Symphonie de Widor, fugue de Bach, Rapsodie de Saint-Saëns, Romance sans paroles d'Henri Libert, Pièce héroïque par le maître César Franck. »
(La Civilisation, 19 juillet 1896)
« Le grand orgue de la Basilique de Saint-Denys fut inauguré le 21 septembre 1841. C'était alors l'instrument le plus vaste, le plus magnifique et le plus parfait que l'on rencontrât en France. Aristide Cavaillé-Coll, qui en avait dressé les plans, n'était âgé alors que de vingt-deux ans. […]
Cet instrument laisse peut-être à désirer au point de vue d'une plus grande facilité de maniement : un réel quatrième clavier, par exemple, et un plus grand nombre de pédales de combinaison mais, au point de vue de la magnificence sonore, il est difficile de rêver une qualité de son plus brillante, plus lumineuse dans les mutations, plus moelleuse dans les fonds, plus puissante et plus véritablement royale dans les anches. Il ne faut pas taire non plus que ce magnifique chef d'œuvre est confié au merveilleux talent d'un des plus brillants élèves des dernières années de César Franck, M. Henri Libert qui arrive à faire complètement disparaître les défectuosités techniques de son instrument. Nous gardons une impression inoubliable de certain programme composé d'œuvres de Bach et de Haendel, ainsi que d'une longue et magnifique improvisation, exécutés lors de l'audition donnée en 1912 à la Basilique de Saint-Denys, par les Amis des Cathédrales. »
(La Tribune de Saint-Gervais, janvier 1914, p. 70-72)
« Récitals d'Orgue et de Piano de M. Henri Libert.
La fin de la saison musicale n'en épuise pas l'intérêt. Il nous a été donné ces derniers jours d'assister à deux manifestations artistiques dont les musiciens algérois garderont longtemps le souvenir.
M. Henri Libert, compositeur, premier prix du Conservatoire de Paris, où il a été le suppléant de M. Widor à la classe de composition, et organiste des grands orgues de la Basilique de Saint-Denis, est venu, on effet, se faire entendre d'abord sur les belles orgues de notre église Saint-Charles de l'Agha, et nous a donné la plus haute impression artistique, dans une série de pages sublimes, des grands maîtres de l'admirable instrument.
Sonate de Mendelssohn, Préludes, Fugues et Chorals du grand Sébastien Bach, Noël de Daquin, Symphonie de Widor, Prélude et Choral de M. Libert ont successivement transporté un auditoire ému et recueilli, que l'Euterpe d'Alger et la Chorale de Saint-Charles, dirigées par M. Siacci et accompagnées par M. Fourcaud, ont à leur tour charmé par l'exécution d'une page aussi belle que peu connue du Christus de Liszt, baryton, choeurs et orgue, chantée à souhait par M. Petit, et par celle, sévère et grandiose, du Credo d'une Messe de P.-L. Hillemacher : belle journée pour l'art comme pour la charité.
Puis, dans un. récital de piano salle des Beaux-Arts, M. Henri Libert s'est montré pianiste accompli, d'une autorité, d'une virtuosité, d'une puissance et d'un charme incomparables, aussi bien dans des oeuvres classiques telles que le Prélude, aria et final de César Franck, la Sonate Clair de Lune de Beethoven et l'admirable Ballade en sol mineur de Chopin, où il fut acclamé, que dans ses oeuvres personnelles : oeuvres inédites, dont nous eûmes la primeur, et qui montrèrent sous le jour le plus attrayant un talent à la fois puissant, et multiple : pittoresque et vivant, dans la Suite Bohémienne, poétique dans les Feuillets d'album, classique dans le Prélude et Fugue, et toujours d'une franchise, d'une chaleur et d'une solidité à toute épreuve.
Nous avons dit à M. Henri Libert, en l'applaudissant comme il le méritait, non pas adieu mais au revoir : Alger n'entendra jamais assez d'artistes de cette valeur et de cette conscience ! »
(L'Afrique du Nord illustrée, 29 mai 1920, p. 14)
« Musique, un récital d’orgue à la Basilique de Saint-Denis :
Malgré l’éloignement, malgré le froid, un public nombreux est accouru hier à Saint-Denis sur l’annonce, d’ailleurs discrète, d'un récital donné par l’organiste de la Basilique, M. Henri Libert.
Ce fait, s’ajoutant à bien d’autres, montre l’attrait qu’exerce la musique d’orgue. Il explique le désir si souvent exprimé qu’il soit possible d’entendre, en dehors des offices où leur rôle est singulièrement restreint, ces admirables instruments qui ont rendu célèbre dans le monde entier la facture française et dont la grande voix ne retentit qu’en de trop rares circonstances.
De dimensions analogues à celles des formidables machines sonores de Saint-Sulpice et de Notre-Dame, l’orgue de Saint-Denis est le premier en date de ces magnifiques monuments. Cavaillé-Coll était un tout jeune homme quand il en conçut le plan et en reçut la commande. Sa mécanique était, pour l’époque, d’une géniale nouveauté. Quant à l’harmonisation, elle demeure, de nos jours, un chef-d’œuvre. Elle lui confère une couleur, un caractère, une physionomie qui n’appartiennent qu’à lui. Rien de plus beau et de plus majestueux que ses basses, rien de plus riche et de plus varié que ses jeux manuels où tous les degrés de la force, toutes les nuances des timbres offrent à l’exécutant des ressources infinies.
M. Henri Libert en use magistralement. Compositeur de haute valeur, virtuose de grand style, M. Libert est, depuis longtemps, tenu par ses pairs pour l’un des meilleurs organistes de Paris. Ce jugement a été, sans aucun doute, unanimement ratifié, hier, à Saint-Denis. Gustave Bret. »
(L'Intransigeant, 26 octobre 1926, p. 5)
orgue.jpg) |
| Henri Libert en 1930 à l'orgue Abbey de la chapelle des Apprentis d'Auteuil (photo Agence Rol, coll. BNF) DR. |
« Musique de scène pour Sainte-Thérèse de Lisieux :
— On a joué, dans la salle du Trocadéro, vendredi dernier, au profit des Orphelins-apprentis d'Auteuil, une sorte de « mystère en sept images » de M. Jean Suberville, évoquant la vie et la mort de Sainte-Thérèse de Lisieux. Une importante musique de scène d'Henri Libert soulignait ces images et était exécutée par un orchestre emprunté aux Concerts Lamoureux et à l'Opéra, avec la maîtrise de Saint-Eustache, sous la direction de Félix Raugel. Elle mérite de sérieux éloges, autant par son habileté d'écriture que par son style vraiment religieux, pénétré de sérénité et de foi, digne de César Franck. L'ouverture est basée sur des thèmes liturgiques qu'elle développe comme pour constituer le cadre des images qui vont se succéder. Le prélude de la première de celles-ci, avec ses cors, ses cloches, ses sonorités cristallines, a une expression surtout agreste : c'est une sorte de vision mystique, au Monastère du Grand Saint-Bernard. Un interlude pastoral mène à la seconde, où apparaît la « petite soeur Thérèse » dans le jardin familial. Un autre est, au contraire comme une prière, un autre emprunte une voix, comme un esprit ; un autre revient aux thèmes liturgiques et fait chanter l'orgue. Un grand développement orchestral, avec le Te Deum grégorien, affirme ensuite l'épanouissement de l'âme de la religieuse, puis son essor vers l'éternité, dans un style à la fois plein de clarté et de puissance, de grâce et de chaleur. Cette partition de l'organiste de la basilique de Saint-Denys lui fait grand honneur. H. de C. »
(Le Ménestrel, 6 avril 1928, p. 159-160)
« La représentation au Trocadéro de l’édifiant « Mystère en 7 images », de M. J. Suberville sur Sainte-Thérèse de Lisieux, vient de fournir à M. Henri Libert l’occasion d’une très importante partition de musique de scène ; à laquelle le public a fait un accueil des plus chaleureux. Cette partition, qui comprend une partie symphonique développée en cinq ou six préludes et interludes, révèle chez son auteur un tempérament dramatique et symphonique que seuls connaissaient quelques initiés et qui, pour beaucoup, a été une révélation.
M. Henri Libert n’est guère connu, en effet, que comme l’un des tout premiers organistes de Paris, titulaire depuis de longues années des orgues de Saint-Denys, où il donne des récitals très importants. Son nom fut prononcé l’an dernier pour la succession du regretté E. Gigout à la classe d’orgue du Conservatoire de Paris, et, dès la fondation du Conservatoire américain de Fontainebleau, il y a affirmé la précellence de notre école d'orgue française par un enseignement des plus remarquables.
Mais ce virtuose de tempérament et de style, ce maître trop modeste, était jusqu’ici moins connu comme compositeur. La partition de Sainte Thérèse, pour son début scénique, le classe du coup parmi les meilleurs. Bâtie sur des motifs originaux et appuyée sur des thèmes liturgiques tels que le Salve Regina et le Te Deum grégoriens, la musique de M. Henri Libert n’est aucunement scholastique; elle reste vibrante et humaine ; et, sans rien demander aux écritures ultra modernes, dont elle n’ignore cependant aucun des raffinements, mais nourrie de Bach et de Franck, elle demeure constamment d’une grande pureté de style en même temps que d'une grande fermeté toute classique de ligne et d'une charmante sonorité orchestrale. On en a retenu particulièrement le Prélude ; l'interlude pastoral des Buissonnets, le Te Deum dialogué, voix, orgue et orchestre, de la Prise de voile, et la conclusion, d’une grandeur que n’eut pas désavouée l’auteur des Béatitudes. M. Félix Raugel a conduit cette partition, dont l’exécution n’était pas sans périls, avec une autorité, une foi et une ardeur communicatives, tirant d’un orchestre trié sur le volet tout ce qu’il pouvait donner et prenant sa légitime part du beau succès de son maître Henri Libert. P.S. »
(L'Indépendant de Seine et Oise, 19 mai 1928)
« M. Henri Libert, organiste des grandes orgues de la basilique de Saint-Denis, professeur au Conservatoire américain, est nommé directeur de l'enseignement musical dans les maisons d'éducation de la Légion d'honneur en remplacement de M. Paul Hillemacher, obligé d'interrompre ses fonctions par raison de santé. »
(Comoedia, 1er septembre 1929, p. 2)
« On a inauguré hier l'orgue électrique de l'église Sainte-Thérèse à Auteuil :
Une belle cérémonie artistique s'est déroulée, hier après-midi, à la chapelle Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus, à Auteuil, à l'occasion de la bénédiction des orgues par Mgr Herscher, archevêque de Laodicée, et de leur inauguration solennelle par le maître Henri Libert.
C'est la première fois qu'un « orgue moderne américain » est placé dans une église française. Il doit d'ailleurs l'essentiel de sa technique à deux inventions de chez nous, l'une de M. Péchard qui, il y a cinquante ans, imagina de substituer l'électricité au vieux système mécanique ; la seconde, beaucoup plus récente et due à M. Vidal. Celui-ci, s'inspirant des merveilleux progrès acquis par les nouvelles orgues électriques, conçut le projet magnifique « des combinaisons libres », rêve des virtuoses de tous les temps.
En quelques mots profanes, cette découverte permet à l'artiste de préparer à l'avance, à sa guise, les multiples sonorités que peut concevoir son talent et qu'il garde pour tel ou tel instant de son exécution. Il n'a, au moment voulu, qu'à appuyer du doigt ou du pied sur un piston pour utiliser ces sons en « réserve ». Voici les caractéristiques très précises de l'orgue d'Auteuil du type quatre claviers dont un de pédale : 162 organes à la disposition de l'organiste, soit 43 jeux, dont 33 réels et 10 par transmission ou extension; 34 accouplements dont 26 à la main par dominos et 8 au pied par « pistons »; 80 organes de combinaison; dont 62 à la main par « boutons d'appel » et 18 au pied par pistons » ; 5 organes divers, dont 3 d'expression permettant à volonté d'ouvrir ou de fermer toutes les sonorités de l'orgue.
A 15 heures, sous les doigts de M. Henri Libert, le nouvel orgue a fait entendre, avec la toccata et fugue en ré mineur de Bach, sa voix puissante et douce, et deux heures durant une grande émotion pénétra l'élégant public d'artistes, de prélats et de fidèles qui assistaient à cette inauguration.
(Le Journal, 7 février 1931, p. 1)
« Nécrologie Nous avons appris la mort de l'organiste Henri Libert, titulaire des orgues de la Basilique Saint-Denis. Né à Paris le 15 déc. 1869, il avait étudié avec Marmontel, Diémer, Franck, Widor, Massenet, Godard ; il fut professeur d'orgue au Conservatoire américain de Fontainebleau, et suppléant de M. Widor à sa classe d'orgue du conservatoire jusqu'à sa retraite ; il a publié des œuvres variées pour orgue, piano, des motets, de la musique vocale, de chambre. »
(L'Art musical, 29 janvier 1937, p. 404)
« En 1896, Henri Libert était nommé après un brillant concours organiste du célèbre Cavaillé-Coll de la Basilique de Saint-Denis. Il honora cette tribune pendant quarante ans, exerçant un fécond apostolat en faveur de l’œuvre de Bach et de Haendel, « rajeunissant par des pensers nouveaux les antiques formes du Prélude, de la Fugue et de la Passacaille » (F. Raugel). La mort récente et prématurée de ce brillant disciple de Franck et de Widor a ouvert une lourde succession. »
(L'Art musical, 23 avril 1937, p. 659)
Collecte : Olivier Geoffroy
(octobre 2025)
-page1.jpg) |
| Henri Libert, Duo en forme de canon, pour orgue ou harmonium, dédié "A mon ami Charles Quef", alors organiste du grand orgue de l'église de La Trinité à Paris (in abbé Joubert, Les Maîtres contemporains de l'orgue, vol. 2, Paris, Sénart, 1912, coll. DHM) DR. Partition au format PDF |
[1] NDLR : Né dans le 17ème arrondissent où sa famille réside depuis plusieurs années (successivement rue Lemercier, rue Truffaut, rue de Rome), son père, Léon Libert, employé au ministère des finances, est originaire de Lorraine (Stenay) et sa mère, née Isabelle de Jouenne d’Esgrigny d’Herville, de Provence (Salon-de-Provence). Au Conservatoire de Paris, où il effectue toutes ses études musicales il est l’élève pour le solfège d’Antoine Marmontel (1ère médaille en 1880, à l’âge de 10 ans), pour le piano préparatoire d’Emile Decombes (1885), pour le piano supérieur d’Antoine Marmontel et Louis Diémer (2ème prix 1886), pour l’orgue de César Franck et de Charles-Marie Widor (1er prix 1894, aux côtés de Louis Vierne) et de composition de Jules Massenet. Répétiteur de Widor dans sa classe de composition (1896 à 1905), il est professeur et membre du jury pour les examens de l’Ecole Niedermeyer, ainsi que professeur d’orgue au Conservatoire américain de Fontainebleau (1921 à 1937). En 1929, le 21 août, par décision du Grand Chancelier de la Légion d’honneur, Henri Libert est nommé directeur de l’enseignement musical dans les Maisons d’éducation de la Légion d’honneur. En 1926, il avait candidaté en vain à la succession d’Eugène Gigout comme professeur d’orgue au Conservatoire de Paris : c’est Marcel Dupré qui lui était préféré.
Organiste, il succéda en 1896 à Adolphe Delhaye au grand orgue Cavaillé-Coll de la basilique de Saint-Denis, poste qu’il occupa durant 41 ans. C’est Henri Heurtel qui lui succédait en 1937. Durant son exercice dans cette église, il postula à deux reprises pour une tribune plus prestigieuse : en 1898 pour succéder à Gabriel Pierné à Sainte-Clotilde (Tournemire fut choisi) et en 1900 à Eugène Sergent à Notre-Dame de Paris (Vierne l’emporta). En 1930, également responsable de la conception artistique d’un orgue neuf dans la nouvelle chapelle Sainte-Thérèse-de-l‘Enfant-Jésus des Orphelins Apprentis d’Auteuil (40 rue La Fontaine, Paris XVIe), il fait construire par la maison Abbey un important instrument de 43 jeux (3 claviers et pédalier) à transmission électrique. Il l’inaugure le 6 février 1931, le qualifiant alors « d’orgue moderne américain. » Il avait adhéré dès sa création en 1913 à l’Union des Maîtres de Chapelle et Organistes (UMCO) qui sera dirigée par Widor, puis pas Büsser.
Comme compositeur, on lui doit des pièces pour piano à quatre mains (Badinage, 2 Airs connus réunis en duo, Air ancien, Le Carillon, Rondeau, Souvenir d’autrefois…), un Prélude brillant pour piano et violoncelle, ou piano et violon, tiré de l’op. 35 de Mendelssohn (arrangement), et des pages pour orgue (Cantabile, Prélude, Prière, 4 Offertoires sur de vieux Noël, Romance sans paroles, Duo en forme de canon, Fugue en ré, Pièce symphonique, Variations symphoniques sur un thème en forme de passacaille, 4 Chorals sur le tombeau de Bach…) et deux ouvrage pédagogiques intitulés Cinquante Leçons de solfège en clé de sol, leçons progressives et expressives dans le caractère du lied (Paris, H. Lemoine, 1931) et L’Art de travailler la pédale d’orgue (Hérelle).
1894.jpg) |
.gif) Jeanne Laisné vers 1895 (DR) | |
| Jeanne Laisné en mai 1894 dans le rôle d'Aurore du Portrait de Manon de Massenet (DR) |
En novembre 1901, à Paris, Henri Libert avait épousé une artiste lyrique qu’il avait connue lors de ses études au Conservatoire de Paris, la soprano Marie Sophie Jeanne Laisné. Née le 21 mars 1870 à Paris, elle fréquentait le Conservatoire de Paris, notamment les classes d’Ernest Boulanger (chant) et d’Emile Taskin (opéra-comique) et décrochait en 1892 une 1ère médaille de solfège, un 2ème prix de chant et un 1er prix d’opéra-comique. Le 16 janvier 1893, elle avait débuté à l’Opéra-comique de Paris dans la création de Werther de Massenet (rôle de Sophie), mais elle devait arrêter sa carrière au théâtre lors de son mariage. C’est à Pau, en mars 1901 au Palais d’hiver, que sa représentation d’adieux fut donnée avec La Vie de bohème de Puccini, aux côtés du ténor Julien Leprestre et du baryton Max Bouvet. Entre temps, salle Favart elle avait participé à plusieurs créations, parmi lesquelles Fidelio de Beethoven (30 décembre 1898, rôle de « Marceline »), Orphée de Gluck (6 mars 1896, rôle de « l’Ombre heureuse »), Le Portrait de Manon de Massenet (8 mai 1894, rôle de « Aurore ») et fut affichée dans le répertoire classique de Carmen, La Bohème, Falstaff, Mignon, Les Noces de Jeannette, Le Pré-aux-Clercs, La Dame blanche, etc…. Néanmoins, elle continua de se produire un temps dans des récitals ou autres concerts de musique de chambre, parfois accompagnée au piano par son époux.
Elle est la sœur du compositeur et organiste Marcel Laisné (1877-1953) qui tint l’orgue de l’église Saint-Louis de Fontainebleau durant 40 ans. Tous deux étaient enfants de Louis Laisné, photographe, et de Sophie Sabatier (1839-1891), 1er prix de piano 1860 au Conservatoire de Paris, professeur de piano.