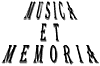Louis Thiry
Revue de presse
 |
| Louis Thiry à l'orgue (photo X...) DR. |
Organiste et interprète reconnu de la musique de Bach et de Messiaen, Louis Thiry (1935-2019) fut organiste à Baccarat (Meurthe-et-Moselle) puis à l'église Saint-Martin de Metz. Il fut l'élève de Robert Barth, à l'Institution des Jeunes Aveugles de Nancy, puis de Louis Thirion et Jeanne Demessieux, au conservatoire de cette même ville avant de rejoindre l'Institution Nationale des Jeunes Aveugles de Paris, dans la classe d'André Marchal et de Gaston Litaize, puis le conservatoire supérieur (classe de Rolande Falcinelli, classe d'écriture de Simone Plé-Caussade) où il obtint un premier prix d'orgue et d'improvisation. Louis Thiry fut professeur au conservatoire de Rouen et membre de l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de cette ville.
*
« M. Louis Thiry, jeune organiste de l’église Saint-Martin, est un exemple de courage à donner aux jeunes — et à leurs aînés. A l’âge de huit ans, une grenade abandonnée par les Allemands en retraite saute, lui arrache deux doigts de la main gauche et le rend aveugle. C’est alors l’institution des Aveugles de Nancy, le Conservatoire : à dix-sept ans il est 1er prix d’orgue à Nancy ; à vingt-trois ans, 1er prix d’orgue à Paris. Le dernier festival de Besançon l’a fait connaître de toute la France par son récital à la Primatiale Saint-Jean.
Par son courage et son talent, M. Louis Thiry, qui est par ailleurs marié et père de deux enfants, mérite bien le prix artistique et le prix de vertu que l’Académie lui décerne aujourd’hui avec un prix de 500 F, un diplôme et une médaille d’argent. »
(Mémoires de l'Académie nationale de Metz, janvier 1965, p. LXXXIII)
« J.S. BACH Le Clavier bien tempéré Louis Thiry à l'orgue de l'Eglise Réformée d'Auteuil. Un coffret de 5 disques ARN 532 012.
Il n'y a plus à faire l'éloge du Clavier bien tempéré de J.-S. Bach. La conception harmonique et la science d'écriture de cette œuvre ont nourri la méditation des musiciens et l'atmosphère poétique de ces Préludes et Fugues continue à nous toucher. On avait l'habitude de les entendre jouer au piano et au clavecin. Voici une interprétation sur l'orgue de l'Eglise Réformée d'Auteuil. L'entreprise est légitime et valait d'être tentée. L'orgue donne un relief nouveau à l'entrelacement des lignes contrapuntiques, et le choix des timbres et des dynamiques souligne judicieusement la couleur des tonalités et les contrastes de l'expression. A cet art de la registration, Louis Thiry joint une technique éblouissante. Cette virtuosité nous séduit. Mais la musique y gagne-t-elle en émotion ?
Philippe Charru »
(Etudes, janvier 1978, p. 142)
« [entretien avec Gaston Litaize] :
Au départ d'André MARCHAL, en 1959, vous avez pris en main la classe d'orgue.
Gaston Litaize : Comme il se doit, j'enseignais à mes élèves l'exécution et l'improvisation. Mais, en dehors de leur formation instrumentale, je les initiais au contre point et à la composition. […]
Pour se préparer à leur métier, les élèves se voyaient confier des enfants clairvoyants dont ils assuraient la formation sous le contrôle d'un professeur expérimenté. Vous avez précisément été le responsable de cet enseignement.
Gaston Litaize : Cette classe m'échut après la libération. J'y ai notamment formé Louis THIRY et Danielle SALVIGNOL, organistes réputés et professeurs de Conservatoire. »
(Le Louis Braille, avril 1985, p. 3)
« MESSIAEN • L'Ascension — Les Corps glorieux
Louis Thiry à l'orgue Metzler de la Cathédrale Saint-Pierre de Genève
Disque Calliope CAL 9926.
L'œuvre d'orgue d'Olivier Messiaen est un des monuments de la musique d'aujourd'hui. A quiconque accepte un premier dépayse ment, elle apparaît d'une étonnante richesse d'écriture, de couleurs et de rythmes. Qui se lasserait, par exemple, d'écouter la 6è pièce des Corps glorieux qui doit une part de son élan à sa source grégorienne, ou les grands éclats de la 3è pièce de L'Ascension ? Comme, d'autre part, la version de Louis Thiry, ici rééditée en technique « compact », est considérée par tous comme l'interprétation de référence, je ne peux que conseiller vivement l'achat de ce disque, seul ou accompagné des deux autres que la maison Calliope offre pour les souscriptions d'automne. J'espère seulement qu'un jour prochain Louis Thiry achèvera son intégrale en nous donnant les Méditations sur le mystère de la Sainte Trinité (1969).
Michel Corbin »
(Etudes, décembre 1987, p. 718)
Cinq siècles de musique d'orgue à Rouen. Réponse au discours de réception de M. Louis Thiry par M. Christian Goubault :
« Monsieur,
Olivier Messiaen a dit de vous "Louis Thiry est un extraordinaire organiste. Virtuose accompli, musicien total, d'une mémoire et d'une adresse sans égales ; on peut le classer parmi les héros de la musique ! Il a donné plusieurs exécutions prestigieuses de mes oeuvres d'orgue les plus difficiles, notamment de ma "Messe de la Pentecôte". Tous ceux qui ont entendu et tous ceux qui entendront Louis Thiry ne peuvent que l'admirer". Il y a trente ans, Olivier Messiaen écrivait déjà : "J'avais été émerveillé de votre musicalité, de votre mémoire et de la perfection de vos interprétations".
Il est difficile d'ajouter quoi que ce soit à ces éloges. Je me souviens qu'au cours du mois de juin 1976, sur l'orgue même dont Messiaen était titulaire - celui de l'église de la Trinité à Paris - vous aviez offert un récital éblouissant, une interprétation vigoureuse de "Livre d'Orgue" de Messiaen et créé plusieurs oeuvres d'orgue contemporaines de Jean Pierre Leguay et d'Antoine Tisné. Rappelons que vous avez enregistré une quasi intégrale de l'oeuvre pour orgue d'Olivier Messiaen sur l'orgue Metzler de la cathédrale de Genève, enregistrement couronné par le Grand Prix du Président de la République et de l'Académie du disque français.
Nous avons pu encore le constater aujourd'hui, vous avez également une prédilection pour la musique européenne d'orgue ancienne, de Sweelinck à Bach, en passant par Purcell, Arauxo, Frescobaldi. Vous avez enregistré la musique de Sweelinck, l'intégrale du "Clavier bien tempéré" de Bach, à l'orgue et non au clavecin, "L'Art de la fugue" sur l'orgue de saint Taurin d'Evreux.
Et maintenant, après avoir loué votre talent, et selon l'usage de notre Académie, je dois vous présenter. Né à Fléville, près de Nancy, le 15 février 1935, Louis Thiry obtient d'abord un premier prix d'orgue au Conservatoire de Nancy, en 1952. A Paris, il se perfectionna auprès d'André Marchal - à qui il vouait une véritable affection - à l'Institution des Jeunes Aveugles. Il travailla au Conservatoire de Paris à la fois le contrepoint et la fugue avec Mme Simone Plé-Caussade, et l'orgue avec Rolande Falcinelli. Organiste titulaire à l'église Saint-Martin de Metz de 1951 à 1972, il remporte le premier prix d'orgue et d'improvisation du Conservatoire de Paris, en 1958 et six ans plus tard (1964), le grand Prix Artistique de l'Académie Nationale de Metz. Il est bientôt appelé à Rouen par Jean-Sébastien Béreau, directeur du Conservatoire National de Région, pour y devenir professeur d'orgue. Dans cet établissement, Louis Thiry a formé et forme une pléiade de jeunes organistes, qui lui doivent beaucoup. Concertiste international, il est également un expert respecté. C'est sur ses idées et ses recommandations qu'a été construit l'instrument de la nouvelle église de Mont-Saint-Aignan, restauré l'orgue du facteur rouennais du XVIIIe siècle Charles Lefèvre de l'église Notre Dame-de-Charité, dans l'enceinte de l'hôpital Charles-Nicolle, où nous nous trouvons à présent.
Cet instrument avait été construit entre 1731 et 1733 pour l'église Saint-Nicolas d'Albane à Rouen, détruite en 1840. Pour l'installer en tribune à Notre-Dame-de-Charité, il fallut supprimer le couronnement des grandes tourelles et scier deux pieds de soubassement. En 1911, l'instrument fut restauré assez maladroitement, mais sans perdre ses qualités essentielles et la plupart de ses tuyaux anciens. Grâce à Louis Thiry et aux facteurs Benoist et Sarrelot, l'orgue retrouva ses trois claviers manuels, ses 25 jeux avec ses beaux cornets et trompette au récit, son prestant et sa doublette du grand orgue, son bourdon, son nasard et son larigot du positif. En l'inaugurant, le 22 avril 1986, Louis Thiry avait raison d'affirmer que "les auditeurs de ce jour peuvent être assurés qu'à très peu de choses près, ils entendront les mêmes sonorités qu'entendaient leurs ancêtres qui, il y a 250 ans, fréquentaient l'église Saint-Nicolas de Rouen". Pour mettre en valeur cet instrument magnifique, Louis Thiry a joué en les présentant- des pièces de musique européenne en lieu et place du discours de réception à l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen. Mon discours en réponse se poursuit avec un florilège de la musique d'orgue rouennaise, et quelques zigzags dans le temps, puisque je vais commencer par Franz-Aloys Klein et Marcel Dupré, remonter à Jehan Titelouze, pour m'arrêter avec Jacques Boyvin, à l'aube de ce XVIIIe siècle qui a vu la naissance de l'orgue Charles Lefevre de cette chapelle. Ainsi la boucle sera bouclée.
Avec bienveillance, Louis Thiry m'a donné des leçons pour que je puisse jouer honorablement cette musique. Je désire simplement - en illustrant musicalement mon propos - faire acte pédagogique, tout en rendant hommage à une lignée d'organistes rouennais dont certains ont été membres de notre Compagnie. »
(Précis analytique des travaux de l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen, janvier 1992, p. 31-33)
Une conférence de Louis Thiry sur l'écoute musicale : séance du 24 novembre 2001 :
Écouter, guetter, désirer, avoir soif de l'inattendu, de cet avenir immédiat duquel je ne sais rien. Ecoute curieuse, intriguée, craintive parfois, attente d'événements inconnus, heureux ou inquiétants.
Vivre l'écoulement d'un temps toujours nouveau ? Mais aussi retrouver le connu, le retour rassurant des saisons et des jours, cette mélodie du temps retrouvé, ce temps harmonieux de la mélodie... L'écoute musicale, c'est tout cela, attente de la surprise, plaisir du retour à la maison, de la rencontre avec l'autre dans sa nouveauté, ou avec de vieilles connaissances. Si le plaisir de l'écoute musicale réside dans l'attrait de la surprise, il n'en est pas moins présent dans le bonheur des retrouvailles. Comme pour la rencontre avec l'autre, la rencontre avec l'œuvre musicale a besoin d'une fréquentation quotidienne. Mais nous savons que la fréquentation quotidienne, si elle n'est pas sous-tendue par une présence attentive, n'engendre que lassitude et ennui. Il en est de même de l'écoute musicale : écouter, c'est savoir que la découverte d'un trésor caché est toujours possible, qu'hier, aujourd'hui ou demain, la même phrase musicale sera différente pour nous.
A notre époque saturée d'informations, nous ne sommes plus familiers avec ce mode d'écoute. Nous sommes souvent submergés par la quantité. Le renouvellement de l'écoute nous semble ne pouvoir passer que par le remplacement de l'objet écouté. Combien possédons-nous de disques compacts que nous n'avons écoutés qu'une seule fois, sans nous rendre compte que, dans certains cas, cette écoute était parfaitement vaine. Nous oublions en effet la part irremplaçable de la mémoire dans l'écoute musicale : une mélodie, même simple, ne peut prendre forme dans notre esprit sans le secours de la répétition. Cette assimilation n'a d'ailleurs rien à voir avec de quelconques connaissances techniques ; elle se fait dans l'espace du sensible immédiat.
L'existence de l'enregistrement sonore a profondément changé notre relation à l'écoute ; mais savons-nous en user d'une façon positive ? Ce qui dans les siècles passés était un événement unique, (pensons par exemple à ce que pouvait être l'audition d'une symphonie de Beethoven) peut aujourd'hui tomber dans la banalité d'une écoute distraite en fond sonore dans le brouhaha de nos restaurants ou de nos supermarchés.
En revanche, les moyens actuels de diffusion peuvent nous permettre d'accéder, par une fréquentation quotidienne, à une connaissance, à une assimilation de l'œuvre d'art à notre être le plus intime. Et cette connaissance peut être donnée, je le répète et j'y insiste, même à ceux qui n'ont aucune compétence technique. Mais pour ce faire, il faut accepter de répéter son écoute, considérant que la première audition, si elle peut laisser quelque impression, ne livre qu'une toute petite partie des secrets de l'œuvre.
Toutes les musiques ne sont évidemment pas égales devant la possibilité d'assimilation d'un auditeur donné : une musique qui intègre à sa structure des éléments répétitifs importants (Vivaldi, Haendel) pourra être entendue et comprise dès la première audition. Par contre, une musique au déroulement continuellement renouvelé, aura besoin de nombreuses auditions pour prendre forme dans notre esprit. Par ailleurs, tous les auditeurs ne sont pas égaux devant une pièce musicale donnée. Là intervient ce qu'il faut bien appeler la culture, mais la culture entendue au sens large : non pas l'érudition pédante et desséchante, mais la connaissance intime et vivante. Le paysan analphabète des siècles passés connaissait des centaines d'espèces végétales, mais n'en connaissait ni les noms latins ni le code génétique ; c'était néanmoins, au vrai sens du mot, un homme cultivé. A la culture ainsi entendue, les dictionnaires et les encyclopédies n'apporteront rien. Certes l'histoire de la musique mérite considération, mais l'œuvre d'art échappe à l'histoire. L'analyse musicale a son intérêt, mais ne m'expliquera jamais l'émotion ressentie à l'audition d'une simple petite phrase de Mozart ; c'est là une histoire d'amour. L'œuvre d'art est posée devant nous, message de vie, intemporelle. Parfois, elle nous attire, parfois elle nous intimide, elle peut aussi nous rebuter ; quoi qu'il en soit, elle est là, osons-nous en approcher ; elle est pour nous, qui que nous soyons.
Où est-elle cette musique délivrée du do, du ré, du mi, de la ronde, de la noire et de la double croche ? Où est-elle cette écoute pure de tout savoir, riche de toute attente poétique, de toute attente créatrice ?
Les connaisseurs apprécient, donnent un prix, donnent même des prix. Ils connaissent la valeur des choses, la longueur de la ronde, la hauteur du la.
L'enfant contemple et rêve. Sait-il qu'il écoute ? La musique entre en lui comme le vent, comme le soleil. En lui elle chante, elle danse. En lui les mélodies et les rythmes s'inscrivent comme les images, comme les odeurs ; ils accompagnent ses jeux et ses rêves et le nourriront tout au long des jours.
Tout le travail du musicien sera de retrouver cette fraîcheur, ce jaillissement que l'écrit tente de conserver et de transmettre. Toute une vie lui sera peut-être nécessaire pour retrouver ce chant de l'origine, pour oublier le do, le ré, le mi, la ronde, la noire et la double croche, pour réveiller en lui l'enfant qui chante et danse.
Pour illustrer son propos, Louis Thiry a ensuite joué au piano :
La Fantaisie en ré mineur de Mozart
Le deuxième Moment musical de Schubert
Les préludes Voiles et Bruyère de Debussy »
(Précis analytique des travaux de l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen, janvier 2001, p. 217-219)
Collecte : Olivier Geoffroy
(mars 2025)