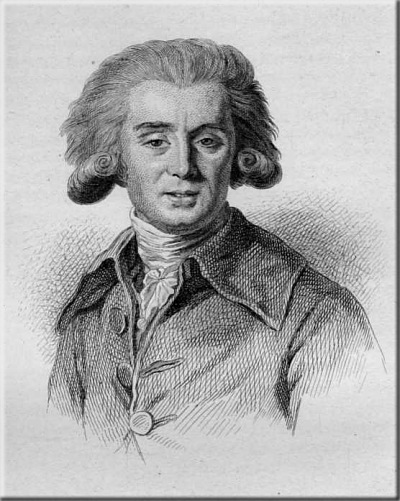
( Coll. D.H.M. ) DR
André Ernest Modeste GRÉTRY
(1742 – 1813)
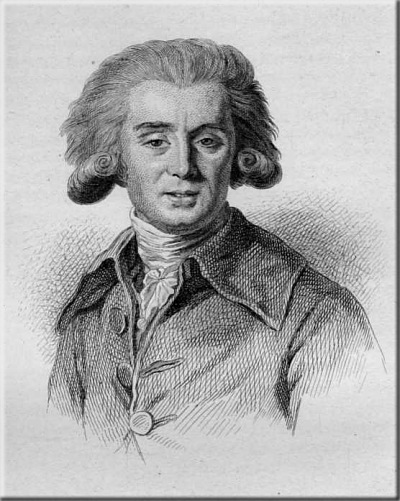 |
| Grétry, portrait gravé à l'eau-forte, 1873 ( Coll. D.H.M. ) DR |
par Pierre Lasserre
in L’Esprit de la musique française.
De Rameau à l'invasion wagnérienne
(Paris, Librairie Payot & Cie, 1917)
I
André-Ernest-Modeste Grétry naquit à Liège, le 11 février 1741. Ses grands-parents, Jean-Noé Grétry et Dieudonnée Campinado, s'étaient mariés contre le gré de leurs familles qui les en avaient punis en les abandonnant à eux-mêmes, et il en était résulté un certain déclassement social que cet aimable ménage supportait avec gaîté. Ils s'étaient établis aubergistes à Blégny, hameau des environs de Liège, et, le dimanche, Jean-Noé faisait danser les paysans au son du violon. A peine son fils, François, put-il tenir l'archet qu'il l'aida dans ce ministère; le bonhomme était si doué qu'à douze ans il obtenait au concours la place de premier violon de l'église Saint-Martin de Liège. Il allait bientôt devenir le maître de violon le plus réputé de la ville. Lui-même fit un mariage de sentiment ; mais, plus heureux que son père, il força le consentement des parents de sa future femme qui trouvaient son état trop modeste ou trop peu sûr. C'est le père de Grétry le Grand. Et voilà au moins une famille où la fameuse loi de l’étape a été fidèlement observée. Le ménétrier de village engendre le maître de violon et celui-ci donne le jour au compositeur d'opéras.
La première enfance d'André s'écoula, en grande partie, à la campagne, auprès de ses grands-parents. Je me plais à supposer que le vieux Jean-Noé faisait danser encore et à placer dans le souvenir de ces dimanches du village la source de l'inspiration si gracieuse et si malicieuse à la fois, si drue et si élégante, si rustique et si fine avec laquelle le musicien de Colinette et de Richard saura peindre et animer la gaîté des paysans en fête.
Ce fut pour l'enfant un gros chagrin de quitter Blégny, quand son père le plaça au chœur de l'église collégiale de Saint-Denis. Là, son existence se partagea entre les fonctions d'enfant de chœur et les leçons de musique qu'il recevait, avec ses camarades, d'un maître fort brutal. Il quitta Saint-Denis à l'âge de douze ans et reçut alors, dans le privé, l'enseignement d'un musicien nommé Leclerc, dont il loue, dans ses Mémoires, la douceur et la bonté. Le désir de composer naissait en lui, et il ne fut pas médiocrement excité par les représentations d'une troupe italienne qui parcourait les grandes villes en jouant les opéras-bouffes de Pergolèse et de Galuppi. Cette troupe séjourna un an à Liège, et François Grétry obtint pour le jeune garçon ses entrées à l'orchestre. Le contact de Pergolèse fut révélateur. En écoutant la Serva padrona, André, comme il l'a écrit, « se mourait de plaisir » et l'idée que lui aussi pourrait un jour faire des opéras le jetait hors de lui-même.
Il avait un très beau soprano. Ayant repris place dans le chœur de la collégiale avec ce sens musical exalté et instruit par les Italiens, il produisit, comme soliste, une impression extraordinaire. Les musiciens de l'orchestre, où son père était violon solo, se mirent à jouer pianissimo pour le mieux entendre. Un chanoine, grand amateur et riche, M. de Harlez, fut enthousiasmé et promit au jeune virtuose l'aide matérielle dont il pourrait avoir besoin pour développer ses talents. Mais celui-ci avait hâte de s'affirmer comme compositeur. Il écrivit sans rien savoir, un motet et une fugue, dont ses Mémoires nous confessent qu'il avait pillé les idées dans divers morceaux, mais en les déformant, les retournant de bout en bout pour les rendre méconnaissables. Cela décida son père à le faire étudier, tout d'abord, sous la direction de Renekin, organiste à l'église Saint-Pierre, puis avec Moreau, organiste à Saint-Paul. Renekin, ravi de l'heureuse nature de son élève, lui laissait un peu la bride sur le cou. Moreau, maître sévère, eut aimé le pousser vers les fortes études de la science musicale. Il accueillait avec froideur les essais fautifs du petit génie auxquels Renekin, au contraire, faisait fête et qu'il jouait sur son orgue. Grétry écouta Renekin plutôt que Moreau. Il suivait en cela le penchant d'un âge qui a coutume de préférer, quand il en a le choix, la facilité à la discipline. Malheureusement ce ne fut pas là chez lui une simple négligence de jeunesse et les années qui suivirent ne lui firent pas comprendre la nécessité des études sévères de son art. A Rome, où il va séjourner huit ans, son travail d'école demeurera superficiel et incomplet, si bien que, lorsqu'il abandonnera cette ville, son maître Casali, le recommandera à un confrère de Genève dans ces termes curieux : « Je vous adresse un de mes élèves, véritable âne en musique et qui ne sait rien, mais jeune homme aimable et de bonnes mœurs. » Âne est plus qu'exagéré et, sans aucun doute, celui qui n'était frappé chez un Grétry que de sa faiblesse en fait de contrepoint, se révèle à nous comme un pédant. Il n'en est pas moins vrai que Grétry avait réduit son apprentissage à un champ trop borné. Et la critique est obligée d'en faire la remarque à cause des vastes ressources d'invention et d’expression dont ces lacunes de la formation technique ont privé un génie merveilleusement doué par la nature.
Ne nous abusons point, au surplus, sur la signification et la portée de telles lacunes chez Grétry. On a vu d'autres grands musiciens avoir plus de génie que de métier et en être plus ou moins péniblement entravés dans la manifestation, la réalisation de ce génie même. Mais, chez eux, cette insuffisance technique était liée (chose assez étrange) à ce qu'on pourrait appeler une insuffisance de musicalité naturelle, de sens musical. Tel Berlioz. Il abonde en inventions éloquentes, poétiques, en grandes idées ; mais il écrit mal ; sa musique sonne durement; sa « pâte » est creuse, dure, coriace. Le cas de Grétry n'est pas celui-là. Il est pleinement, finement musicien. Tout ce qu'il écrit sonne joliment ; sa technique est pure; sa mélodie, qui est parfois de toute grâce et de toute beauté, et se recommande en général par une rare justesse d'accent et d'expression, se lie aux mouvements d'une basse facile, spirituelle, élégante. Sur quoi donc porte notre reproche ou, pour beaucoup mieux dire, notre regret ? Sur l'étroitesse, la maigreur relative de cette technique, sur un certain défaut de richesse, de variété dans les harmonies de cette lyre, Notre plaisir ne s'en trouve aucunement amoindri là où de plus opulentes combinaisons n'étaient pas requises. Mais, quand, ne nous contentant pas du plaisir de tant de morceaux, de scènes délicieuses, nous prenons un peu de recul pour voir d'ensemble soit l'œuvre, soit une œuvre de Grétry, nous ne nous consolons pas qu'il n'ait pas possédé le métier à ce degré qui fait les plus grands maîtres et les œuvres de tous points cuirassées contre les coups du temps. Il nous semble qu'il y était appelé, qu'il était né pour de plus vastes essors, des constructions plus larges et plus soutenues. Il y a un contraste sensible entre la force, la rondeur souvent magistrale de ses idées et l'exiguïté du domaine dramatique où elles se produisent et fleurissent avec ce bonheur. Il y a ses essais dans les grands genres (Céphale et Procrès, Andromaque, etc.), ou de superbes éléments d'invention n'atteignent pas à un effet digne d'eux, parce que le style du corps de l'ouvrage ne se soutient pas à leur hauteur. Il y a ses conceptions sur la musique dramatique, telles qu'il les a exposées dans ses Mémoires : conceptions auxquelles la hardiesse et même l'envergure ne sont pas ce qui fait défaut et où l’on sent bouillonner une certaine force intérieure, car le raisonnement abstrait n'eût pas suffi à les lui former. Il décrit, sous la forme d'un rêve d'avenir, mille enrichissements que la musique de théâtre pourrait recevoir, sans y altérer sa nature, de la main d'un grand symphoniste. Et quelqu'un a remarqué, non sans justesse, que ce rêve était une véritable prophétie qui allait se réaliser dans la personne de Mozart. Mais précisément je crois que Grétry, passant par une plus grande et plus complète école, eût été un Mozart français, le vrai pendant de Rameau.
II
Le plus ardent désir du jeune artiste était de vivre quelques années en Italie. La générosité du chanoine-Mécène et l'existence d'un collège liégeois à Rome lui en facilitèrent l'accomplissement. Ce collège donnait l'hospitalité à dix-huit jeunes étudiants et artistes nés à Liège et qui s'étaient distingués aux yeux de leurs concitoyens. C'est là que Grétry descendit, après un voyage fait à pied dont il nous a laissé l'agréable relation. Sa vie romaine, exempte des soucis pécuniaires et baignée du torrent de musique qui ne cessait de couler dans les huit théâtres et dans les innombrables églises de la ville, dut être fort heureuse. C'était un garçon sage, selon le témoignage que lui rendait, faute de mieux, son maître de contrepoint, et d'ailleurs un garçon de ressources. Ayant éprouvé le besoin de gonfler un peu sa bourse, il se présenta à un gentilhomme qui jouait de la flûte et qui s'était rendu célèbre parmi les musiciens romains pour la difficulté qu'il y avait à le satisfaire. Cet amateur avait coutume de commander à tous les artistes qui le visitaient un concerto de flûte, n'en était jamais content et renvoyait invariablement la musique à l'auteur avec quelques louis. L'avisé Wallon exprima le désir d'entendre préluder sur son instrument, un homme qui s'en servait si bien. Et ayant fixé dans sa mémoire tous les passages et roulades favorites du flûtiste, il les mit dans le concerto. Le gentilhomme trouva ses inventions admirables et le prit à ses gages, lui promettant une petite rente annuelle contre l’assurance de recevoir un concerto de flûte dans toutes les villes où il séjournerait — car il voyageait beaucoup.
Les Mémoires de Grétry nous offrent un amusant tableau de la vie musicale de Rome à cette époque, de la passion du public pour le théâtre et pour les concerts d'église. Ce qu'il n'y faut pas chercher, c'est un exposé de l'état de l'art, ni l'équitable mention des artistes qui l'illustraient alors dans ses divers genres. Grétry n'écrit pas un chapitre de l'histoire de la musique. Il nous entretient seulement des œuvres et des maîtres qui l’ont particulièrement séduit par leur affinité avec sa personnalité propre, par l'aide et le stimulant direct qu'il sentait devoir tirer d'eux pour le développement de sa nature. Entre toutes les sortes de musique, c'est la musique de théâtre qui l'a captivé à Rome ; dans la musique de théâtre l’opéra-bouffe, et, parmi les maîtres de l’opéra-bouffe, Pergolèse. L'influence de Pergolèse sur Grétry a été prépondérante. Une étude comme celle-ci, qui vise à l'exactitude, mais non à la minutie de la vérité, peut négliger la part des Galuppi, des Vinci, des Terradellas dans la formation de son art et dans l'excitation de son génie, pour s'en tenir à celle qui appartient au seul Pergolèse. C'est avec raison que le public du temps l'appelait le Pergolèse français. Il n'avait d'ailleurs pas attendu son séjour à Rome pour découvrir Pergolèse, puisqu'il le connaissait par la troupe italienne de Liège et que, d'ailleurs, la représentation de la Serva padrona à Paris, en 1752, avait fait révolution parmi les Français. Mais ce fut à Rome qu'il se pénétra profondément de ses leçons.
Leçons admirables, certes. N'est-ce pas pourtant une chose excessive qu'elles aient été, avec celles de la nature, les seules qu'eut reçues Grétry ? Comme, source et fond d'une culture musicale, la Serva padrona, c'est un peu mince. Pourquoi Grétry n'est-il pas remonté jusqu'à la grande école italienne immédiatement antérieure, jusqu'au grand Scarlatti, jusqu'à l'incomparable Stradella, dont l'étendue de génie sera suffisamment attestée par ce fait qu'il a tout ensemble inventé le style « bouffon » dont Pergolèse s'est divinement servi dans la Serva padrona et exercé sur l'esprit de Hændel une domination véritable? Mais il faut nous représenter notre jeune artiste comme un impatient, très pressé d'arriver, de tirer parti de l'extraordinaire faculté d'expression dramatique musicale qu'il sent s'agiter en lui. Or, pour l'enseignement de l'expression dramatique, dans le domaine du fin et du tempéré, il n'y a rien au-dessus de Pergolèse ; Grétry ne tardera pas à tirer fruits merveilleux des germes qu'il en reçoit.
Le sens que le français attache aux mots de bouffon, de bouffonnerie pourrait créer une erreur sur la nature de l’opéra-bouffe des Italiens. Il s'agit non d'un genre outré, mais d'un genre délicat qui se couronne de gaîté et convient aussi à l'expression des nuances. La grande séduction de l’opéra-bouffe (chez Pergolèse, Cimarosa, Rossini, on peut ajouter : chez Mozart dont les chefs d'œuvre contiennent de prestigieuses pages d'opéra-bouffe) c'est de parler une langue, mordante et légère à la fois, qui se prête aux accents de la sensibilité et aux jaillissements du rire, qui sait passer sans heurt, sans brisure, du plaisant an tendre, de la farce à la grâce, du rythme d'une forte animation comique à celui des tendres soupirs. C'est cette variété, ce tour mixte, cette légèreté enchanteresse qui font comprendre la boutade dc Stendhal : « L’opéra-bouffe est le chef-d'œuvre de l'esprit humain. » Il ajoutait que cette musique gaie avait le pouvoir de lui inspirer la mélancolie et les douces larmes, au lieu qu'une musique au ton tragique le trouvait plutôt rebelle et froid ; et ce n'était pas que sa sensibilité manquât de finesse, mais parce qu'elle en avait trop. On comprend très bien son impression, si on la rapporte au Barbier de Séville, le dernier en date des chefs-d'œuvre de l’opéra-bouffe et l'œuvre du plus puissant rieur qui ait manié ce genre. Elle apparaît plus naturelle encore, rapportée aux ouvrages de Pergolèse et de Cimarosa, qui n'ont pas la richesse et l'éblouissante fantaisie du Barbier, mais qui ont, me semble-t-il, plus de tendresse et de sentiment. J'appelle, par exemple, l'attention, dans la Servante maîtresse, sur l'air qui me paraît être le chef-d'œuvre de ce chef-d'œuvre, celui où Pandolphe, placé devant la folie où l'entraîne la coquetterie de la soubrette, l'envisage avec effroi, ivresse et philosophie tout ensemble. Quelle flexibilité de ton! Tour a tour colorée de pathétique et de gaîté, mais animée d'un bout à l'autre d'un mouvement, d'un rythme unique, coulante, facile, leste, sonnante, la musique reflète tous les aspects de l'objet qui l'inspire, de cette passion d'un vieillard amoureux : l'aspect pathétique et touchant, l'aspect hilarant et fol. C'est la nature même !
III
Voilà ce qui charma Grétry, le pénétra. Et je ne veux aucunement dire que cette séduction eut pour résultat de lui faire faire de la musique italienne à Paris. Rien ne serait plus éloigné de la vérité. Ce qu'il a reçu des Italiens, il l'a transformé, il l'a versé dans la propre tradition musicale de l'opéra-comique français. L'opéra-comique français avait assez d'analogie de nature avec l’ opéra-bouffe italien pour en subir l'influence (et il l'avait subie déjà avant Grétry). A d'autres égards, il différait de l’opéra-bouffe comme diffèrent les tempéraments et les humeurs des deux nations et il pouvait aisément supporter cette influence sans se dénaturer. Parti, comme le remarque Sainte-Beuve, dans son étude sur Piron, des plus humbles origines (le vaudeville et le théâtre de la Foire), ce petit genre de l'opéra-comique s'est élevé, dans la première moitié du XVIIIe siècle, à la dignité d'un véritable genre musical, d'une véritable forme de l'art. Les noms de Dauvergne, Duni (Napolitain), Favart, Philidor, Monsigny marquent les étapes de ce progrès qui atteint chez Grétry un degré particulier d'épanouissement. Grétry introduit dans l'opéra-comique des perfectionnements de déclamation, de diction qui tiennent à son étude des maîtres de l'Italie, un surcroît de coloris, de mélodieux, de largeur musicale ou se discerne le doux éclat d'un reflet romain.
Malheureusement, il n'y a pas, dans les opéras-comiques de Grétry que la musique de Grétry. En même temps que le genre recevait de lui du côté musical ce nouvel afflux de richesse, du côté littéraire il subissait l'influence et l'intrusion de la plus détestable mode sentimentale. Nous sommes en ces années que Rousseau domine avec ses niaiseries éloquentes et où ce qui passe pour la plus belle chose et la plus grande louange, c'est d'être « sensible ». Une épidémie de « sensibilité » sévit alors sur la société française. On se livre aux attendrissements et aux effusions du cœur. On pousse des soupirs au seul nom de la vertu. On croit, on s'amuse à croire qu'en fait de mœurs, de sentiments, d’émotions, de jouissances, de maximes morales, la « nature » vient d'être découverte et sentie pour la première fois. Et on s'extasie sur la bonté de la nature. A force de jouer ce jeu d'imagination, on s'y prend et on en devient un peu bête. Ecrivains secondaires et, par conséquent, plus à la merci de la mode que d'autres, les poètes qui fournissaient Grétry modelaient trop souvent leurs inventions et leur langage sur cette manie.
Mais Grétry était fort supérieur à ces fadaises. Il sut ne les point chanter avec fadeur. Pour cela, il s'inspira non d'elles-mêmes, mais des sentiments justes et vrais dont elles ne sont, après tout, que la caricature et comme la comédie. Il est très vrai que la « nature » en tout a du bon et qu'elle réclame sa part comme conseillère et maîtresse de la vie ; il est très vrai que la simplicité des mœurs et des penchants est une condition de bonheur, que la vertu est aimable, que l'honnêteté rend plus heureux que le vice, qu'il n'y a point pour l'homme de joies si sûres ni si enviables que les joies de l'affection et de l'amitié et que celles-ci, le méchant et le vaniteux ne les connaissent point. Mais, précisément parce que ce sont là les vérités les plus naturelles et les plus douces à sentir et qu'il n'est d'ailleurs donné qu'à des cœurs sincères et délicats d'en être pénétrés et de les mettre en pratique, il n'en est que plus hideux d'en faire une matière d'affectation, d'expansion indiscrète et d'emphase, un objet de montre et de vanité. Grétry les ressentait, non en mime, non en déclamateur et en précieux, mais en honnête homme et en poète et, à ces deux titres, avec noblesse et simplicité. Il exprima musicalement ce qu'il en éprouvait, sans maniérisme, avec ampleur, douceur et rondeur. Rien de significatif comme le fameux quatuor de son opéra Lucile : Où peut-on être mieux qu’au sein de sa famille ? Les paroles en seraient déplorables et à vous dégoûter de la famille. La musique en est franche, large, naturelle, discrètement robuste, pleine de carrure et de bonhomie. Elle peint, comme il doit être peint, le contentement de braves gens qui éprouvent, le verre en main, le plaisir de s'aimer et d'être en pleine confiance.
Chez certains successeurs de Grétry, on verra cette fadeur et cette niaiserie de la fausse sensibilité se communiquer à la musique. Chez lui, celle-ci est admirablement sauve. Mais il reste la partie parlée de plusieurs de ses ouvrages, qu'il faudrait refondre en bien des endroits (ce ne serait pas si difficile) pour les remettre en honneur.
IV
Il quitta Rome après y être demeuré huit ans et s'y être fait connaître par quelques productions (la plus importante est une cantate profane, les Vendangeuses, que je n'ai pu trouver). Diverses circonstances l'attirèrent à Genève où il fit représenter un opéra-comique, Isabelle et Gertrude, paroles de Favart, déjà mises en musique par Blaise : ces reprises étaient acceptées alors. Mais c'est à Paris que notre ambitieux voulait aboutir. Il profita du voisinage de Ferney pour rendre visite à Voltaire, auquel il n'hésita pas à demander un poème d'opéra-comique. Voltaire ne promit rien. Mais il ne perdit pas le souvenir de ce jeune homme qui montrait, avec une grande honnêteté de manières, une grande sûreté de soi-même et de l'esprit. Lorsque le bruit des applaudissements qui, moins de deux ans après, accueillirent le Huron, parvinrent à Ferney, il adressa au musicien, soudain devenu célèbre, deux projets d'opéra-comique, « l'un développé ayant pour titre le Baron d'Otrante et qu'il avait tiré d'un de ses contes, l'Education d'un prince ; l’autre, intitulé les Deux tonneaux, à l'état de simple esquisse. » Il recommandait à Grétry de lui conserver l'anonymat, le priant de présenter ces pièces aux comédiens italiens comme l'ouvrage d'un jeune homme de province. La commission fut si exactement faite que les comédiens n'ayant pas été satisfaits par les livrets, mais y trouvant les signes de véritables dispositions littéraires, firent engager l'auteur à quitter sa province et à venir à Paris pour y cultiver ses dons. Voltaire éclata de rire et il fut furieux. On lit dans une de ses lettres écrite peu après cet incident : « L'opéra-comique n'est autre que la foire renforcée. Je sais que ce spectacle est aujourd'hui le favori de la nation; mais je sais aussi à quel point la nation s'est dégradée. Le siècle présent n'est presque composé que des excréments du grand siècle de Louis XIV. Cette turpitude est notre lot dans presque tous les genres. » Cet hommage au siècle de Louis XIV, si supérieur dans l'ensemble pour tout ce qui tient aux arts, nous plaît fort. Mais le grand homme eût été plus équitable en appelant notre opéra-comique « la foire épurée ».
C'est une grande habileté de la part d'un artiste que d'acquérir l'appui des gens de lettres influents. Cette habileté ne fit point défaut à Grétry. Outre l’impression de supériorité que donnait sa personne, la nature l'avait doué d'une bonne dose d'entregent et de hardiesse. Diderot, Suard, l'abbé Arnaud, Grimm (qu'il savait flatter dans leurs idées), le comte de Creutz, ministre du roi de Suède à Paris, n'attendirent point qu'il eût réussi pour l'admirer et embrasser chaleureusement sa cause. La grande affaire pour lui c'était de trouver un poète et un livret. Légier, homme de lettres obscur, lui fabriqua certains Mariages samnites qui ne furent pas reçus au théâtre et échouèrent complètement dans une exécution privée chez le prince de Conti. Le musicien accusait les exécutants d'avoir mis de la malice à massacrer son ouvrage. Cette aventure eût suffi à éloigner pour longtemps tous les poètes d'opéra de ce collaborateur malheureux, sans le dévouement du comte de Creutz, avide d'une prompte revanche pour son ami, et dont l'insistance obtint de Marmontel un poème. Ce fut le Huron, tiré de l'Ingénu de Voltaire. L'ouvrage est médiocre, le sel et la fantaisie de Voltaire se sont évaporés sous les doigts pesants de l’adaptateur. Mais la musique triompha et d'un seul coup valut à Grétry la gloire. On sentit qu'un grand musicien était né. La première représentation du Huron est une date importante dans l'histoire de la musique française. Une personnalité musicale fraîche et nouvelle s'y révélait dans le cadre d'un genre familier dont elle respectait, tout en les rajeunissant, l'esprit et la tradition. Ce mélange, cette proportion heureuse de tradition et de nouveauté fut toujours la condition des grands succès dans les arts.
V
Grétry raconte que l'acteur Cailleau, de la Comédie-Italienne, enthousiaste du Huron, que le musicien lui avait fait entendre au clavecin, mais prévoyant la résistance de ses camarades, enleva leur suffrage par une joyeuse surprise. Il les réunit dans un dîner et, au dessert, se mit à fredonner de sa belle basse l'air devenu fameux : « Dans quel canton est l'Huronie? » De qui est cela? lui demandèrent-ils émerveillés... La pièce était reçue.
Cet air est déjà de la meilleure marque du maître. A côté de lui, il faut relever, dans le Huron, le madrigal si élégant et si franc : « Les joncs ne sont pas plus droits », la charmante ariette de Mlle de St-Yves : « Si jamais je prends un époux », enfin un morceau descriptif curieux et plein d'éclat : le récit fait par le brave petit Huron de la bataille dont sa vaillance a décidé le sort.
Lucile, jouée l'année suivante (1769), porta au comble la renommée de Grétry. Il faut malheureusement convenir que le poème (de Marmontel), qui tient pour une part au genre de la sensibilité larmoyante, ne contribua pas moins au triomphe de l'ouvrage que la musique, qui est belle et saine. Lucile, fille du riche gentilhomme Timante, va épouser par amour un charmant garçon de son monde. Mais son père nourricier, le paysan Blaise, invité à la noce, y arrive en trouble-fête. Jadis, sa femme, ayant vu mourir l'enfant que Timante lui avait confié, y substitua sa propre enfant pour ne pas perdre les mois de nourrice. Lucile est la fille de Blaise et le bonhomme, troublé de remords, vient décharger sa conscience de ce secret qui lui a pesé pendant dix-huit ans. Vous devinez qu'il ne suscite, comme il l'avait craint, aucun cataclysme domestique, que le mariage se fera quand même, et que tous ces gens lui seront reconnaissants de l'occasion qu'il leur a donnée de se montrer au-dessus des conventions, de suivre la nature et de s'en savoir gré.
L'air de Blaise : « Ah! ma femme, qu'avez-vous fait? » est d'ailleurs superbe et j'ai déjà mentionné le destin extraordinaire du quatuor : « Ou peut-on être mieux qu'au sein de sa famille? » Il resta très longtemps dans les mémoires. Quand Grétry, sur ses vieux jours, paraissait au théâtre, l'assistance l'entonnait en son honneur. Les soldats de Napoléon le chantaient pendant la retraite de Russie. Et, sous la Restauration, les musiques le jouaient pour accueillir la famille royale dans les lieux publics. On le trouve, paraît-il, dans de vieux recueils de cantiques, virginal refuge ou sont venus échouer, quand le feu primitif en était un peu éteint, tant d'airs d'opéras, tant de romances qui avaient jadis servi à l’expression de sentiments tout terrestres.
Je n'aurai garde de suivre Grétry à travers toute la série des opéras qu'il composa depuis ses débuts à Paris (1768) jusqu'à sa mort survenue en 1813. Série beaucoup trop longue, puisqu'elle renferme plus de cinquante pièces, un peu plus d'une par an, mais qui offre maints chefs-d'œuvre tels que Richard Cœur de Lion, Zémire et Azor, le Tableau parlant, la Fausse magie, L'Amant jaloux, et dans des ouvrages d'une valeur moins égale et moins soutenue (Silvain, le Magnifiquc, la Rosière de Salency, les deux Avares, le Jugement de Midas, Céphale et Procris, la Caravane du Caire, Colinette à la Cour, etc.) mille morceaux d'une venue et d'un tour admirables. Une analyse détaillée de toutes ces productions, analyse éclairée de fins et discrets jugements, a été donnée par Michel Brenet, au livre de qui je renvoie. Ce qui est plutôt notre affaire, c'est de caractériser par quelques traits généraux la nature de cet art et de ce génie.
VI
Lui-même, esprit curieux, poussé à raisonner et parfois à déraisonner par le commerce habituel des philosophes, va nous aider dans cette recherche. Il nous a donné une théorie de l'expression musicale dont l'intérêt serait déjà très vif, quand même elle ne nous expliquerait que sa manière personnelle d'inventer et de composer. Mais elle en offre en même temps un plus étendu. Nous y trouvons de vraies lumières sur la signification, la raison d'être, et ce qu'on pourrait appeler la genèse de la musique en général.
D'après Grétry, la musique est un art d'imitation. Il le formule avec toute la netteté possible. Et sa thèse sera certainement reçue comme le comble du paradoxe par les nombreux esprits qui se sont accoutumés à penser, tout au contraire, que la musique n'est pas un art d'imitation et que la place qui lui revient est a côté de ces arts, tels que l'architecture, la géométrie, qui créent ou composent des formes sans modèles dans la nature. La peinture, la statuaire reproduisent aux yeux des objets visibles. La poésie reproduit ces objets invisibles, mais parfaitement définis, qui sont les sentiments humains. Quels objets reproduit la musique? Quelles sont les choses données qu'imitent les formes sonores? Notre auteur va nous le dire.
La musique est l'imitation de la parole. Elle est sans doute l’imitation du sentiment, mais du sentiment manifesté et incorporé dans la parole. Elle imite le sentiment dans les inflexions du langage, du discours où il trouve son expression naturelle. Elle imite le mouvement et le rythme naturel du discours. Elle les imite en les rehaussant, en y ajoutant de l'accent, de la force, de l'intensité, un grand surcroît de pathétique sensible : c'est là son propre but. Mais elle les suit avec fidélité, elle se modèle sur eux. Il y a entre le discours chanté et le discours parlé, le même genre de rapport qu'entre l'agrandissement d'un graphique et ce graphique ou, mieux encore, qu'entre un dessin relevé par la couleur et le dessin sans couleur. Le chant est l'exaltation de la parole. Mais il n'est pas substantiellement autre chose que la parole, la parole élevée à son plus haut degré de puissance expressive, de force pénétrante. Grétry, on l'entend bien, a en vue ce que le chant doit être, ce qu'il est chez les musiciens qui observent la vérité et la nature, non chez les mauvais musiciens à qui la faculté de chanter pour ne rien dire n'a pas plus été refusée qu'aux mauvais écrivains celle d'aligner des mots creux. — Je ne crois pas qu'il applique ces observations à la musique de danse. Mais cette application se fait de soi-même. La musique de danse imite les mouvements et figures de la danse comme la musique chantée fait les mouvements et figures du discours.
II résulte de là que, si la musique peut être dite un art d'imitation, ce n'est pas dans le même sens que les autres arts ainsi dénommés. Elle ne peut, comme la sculpture, la peinture, la poésie, nous représenter par elle-même les objets qu'elle imite. Il faut que ceux-ci soient présents pour que nous les reconnaissions dans l’imitation musicale. Il faut que nous percevions les paroles, les gestes, les pas dansés pour que nous sachions exactement ce que la musique qui s'y ajoute veut dire. En un mot, l'imitation n'est pas pour la musique un but, Elle est un moyen, une condition, la condition qu'elle doit observer pour que son expression se lie à la propre expression des choses et la renforce.
Nous n'avons parlé que de la musique vocale et de la musique chorégraphique. Mais il est un autre genre de musique : la musique instrumentale pure, sans danse ni paroles, la sonate, la musique de chambre sous ses diverses formes, la symphonie. Comment appliquer à ce genre la théorie de l'imitation ? Quel objet peut-on dire qu'imite la musique instrumentale? En ce qui la concerne, ceux-là ne semblent-ils pas avoir raison à qui les idées musicales apparaissent comme des espèces de créations ex nihilo, d'inventions absolues, ne se modelant sur rien de donné ?
La difficulté n'échappe pas à Grétry. Et nous le voyons, au cours de sa carrière, la résoudre de deux façons successives, qui font réfléchir, mais ne peuvent aucunement nous satisfaire.
La première solution était expéditive. C'était la solution par le dédain. Grétry écartait le démenti que la musique instrumentale semblait infliger à ses principes en en faisant fi. Il déclarait n'y trouver qu'une forme inférieure et mal déterminée de l'invention musicale, comme une virtualité, un vagissement, un fantôme de musique, presque une fausse musique. A ceux qui en goûtent l'expression, il dit qu'ils se plaisent dans la métaphysique (au sens péjoratif) et le vague. L'émotion reçue de la musique instrumentale pure lui apparaît le fait d'une sensibilité dissolue.
Il faut bien convenir que, quand il tenait ce langage, il ne connaissait guère la musique instrumentale. Manquant de l'éducation technique particulière qu'elle demande, il n'éprouvait aucune impulsion à s’y essayer lui-même. Et son attention, toute aux choses du théâtre, ne s'était pas portée sur les chefs-d'œuvre qu'elle avait déjà produits, en Italie et en France, non dans la symphonie, qui n'était pas apparue encore, mais dans les genres du clavecin et de l'orgue. Plus tard, lorsque les symphonies de Haydn auront commencé leur tour d'Europe, il s'inclinera devant ces ouvrages admirables, il changera généreusement d'avis, il s'écriera que ceux-là ont bien tort qui font profession de ne pas savoir « ce qu'une belle sonate ou une belle symphonie veut nous dire ». Seulement, il inventera entre cette opinion tardive et ses opinions du début une espèce de conciliation. Il dira que la musique instrumentale, quand elle est belle, est comme une musique vocale qui s'ignore. Elle est faite pour des paroles qu'elle attend et qu'il sera bon d'y mettre. Le symphoniste (celui chez qui se sent une inspiration réelle, une vraie chaleur) s'inspire d'un poème virtuel ou latent qu'il s'agirait de dégager et de rendre explicite pour rendre à l'œuvre musicale tout son lustre, tout son accent.
Voilà qui sera, et à bon droit, jugé téméraire. L'idée de placer des paroles sur la musique instrumentale des maîtres est chimérique et le résultat qu'elle donnerait, à l'épreuve, serait, je crois, plus que bizarre. Mais il y a dans cette proposition, en elle-même singulière, un élément de raison, un fond d'observation juste. Grétry voit très bien que l'inspiration des symphonistes, dignes du nom de créateurs, ne jaillit pas, ne se forme pas dans le vide ; qu'elle naît d'un sentiment, d'une émotion, d'une image, d'une vision qui occupent l'esprit du musicien, qui ébranlent et échauffent son imagination et sont pour lui comme le modèle intérieur qu'il s'efforce de reproduire dans ses idées musicales. C'est d'ailleurs là une donnée de psychologie fort connue, quasi-évidente et confirmée par les confidences des maîtres sur leur manière de travailler. On en voit la conséquence : la musique instrumentale est, comme toute autre musique, une musique d'imitation. Seulement, à la différence de la musique vocale et de la musique de danse, l'objet qu'elle imite ne nous étant point expliqué ou présenté en lui-même, nous ne le reconnaissons pas. Il demeure indistinct. La signification de la musique est déterminée pour le musicien qui en est l'auteur ; elle ne l’est pas pour nous qui l'écoutons. La preuve, c'est que si nous chargeons cinq littérateurs, supposés également intelligents et sensibles, de dépeindre les sentiments exprimés dans la symphonie en ut mineur ou toute autre symphonie de Beethoven, nous obtiendrons cinq versions, non contradictoires assurément, mais très différentes. Tout le monde perçoit bien si la disposition d'âme reflétée dans une musique est plutôt gaie ou plutôt triste, plutôt agitée ou plutôt calme. Mais cela laisse encore bien de la marge à l'indétermination et au vague. La musique instrumentale est une imitation vague. Dans ce caractère de vague, Grétry avait tout d'abord trouvé une raison de mépriser le genre. Il s'aperçut qu'elle n'était point bonne. Et nous qui ne connaissons pas seulement Haydn, mais Mozart et Beethoven, nous savons que, traitée par eux, la musique instrumentale a produit des chefs-d'œuvre qui égalent en beauté les plus purs chefs-d'œuvre des autres arts. Nous n'avons aucun doute la-dessus. Mais alors comment ferons-nous pour nous débarrasser de l'étrange difficulté que cette certitude dresse devant nous, du véritable scandale esthétique ou, comme dirait un Allemand, de la choquante « antinomie » constituée par ce fait d’un genre artistique à la fois capable de la plus haute beauté et essentiellement vague ? La raison, le goût, l’exemple de tous les autres arts ne nous enseignent-ils pas qu’il ne peut y avoir de beauté que dans la précision ?
Le scandale se dissipe, l'antinomie se résout, si l’on fait attention qu'à côté de son élément expressif et pathétique, la musique instrumentale en renferme un autre, de nature toute différente, et qui y joue précisément un rôle analogue à celui des paroles par rapport à la musique vocale, de la danse par rapport à la musique de danse. Je veux parler des particularités de sa construction, soumise à des lois rigoureuses dont les modèles de l'architecture classique peuvent seuls (par analogie) donner une idée. Si la musique instrumentale demande, pour être belle, une grande vitalité d'inspiration, un puissant jet de lyrisme, il n'y a, d'autre part, rien de moins arbitraire que ses développements. Ceux-ci se font entre des lignes dont la courbe, déterminée dès le début par la fantaisie du musicien, ne peut pas ensuite être changée. Les idées initiales, les thèmes générateurs (toujours simples et courts chez les classiques) une fois posés, il ne peut pas en être introduit d'autres. Tout doit leur être emprunté, tout doit procéder d'eux : assises, contours et ornements de l'édifice musical. En d'autres termes, la musique instrumentale est, quant à sa forme, issue de la fugue. C'est la fugue libérée de ses servitudes formelles et de sa pesanteur scolastique, mais conservant sous cette variété et cette liberté extrêmement agrandies, ses traits essentiels. C'est l'alliance de la fugue avec la passion. Ce caractère de jeu serré et rationnel est ce qui compense tout ce qu'elle aurait d'indéterminé au point de vue expressif. Tandis que la force d'élan lyrique, de dynamisme vivant qui lui est communiquée par le coeur et le sang du musicien, touche le cœur et remue le sang de l'auditeur, la merveilleuse ordonnance de sa structure contente l'intelligence. Cet élément plus intellectuel, dont l'adjonction à la musique semble nécessaire et qui est représenté par les paroles ou par les figures de la danse, la musique instrumentale le tire d'elle-même, le fournit ou y supplée par la loi d'ordre si sévère à laquelle elle s'astreint.
On peut conclure de là qu'il y a, relativement aux autres genres musicaux, quelque chose d'artificiel dans sa nature et qu'elle sera toujours, plus ou moins, un genre d'initiés. Mais cette observation n'ôte rien au prix de ses chefs-d'œuvre.
Si Grétry eût vécu un peu plus tard et assisté à la grande floraison moderne de la symphonie, il aurait sans doute enrichi ses principes de compléments et de correctifs assez semblables à ceux que je me suis permis d'y ajouter et qui les eussent rendus vrais de la musique en général, comme ils le sont de la musique vocale. Dans leur application à celle-ci, ils me semblent d'une admirable finesse et il est curieux de voir le parti qu'il en tirait dans la pratique, les ressources d'invention qu'il y trouvait.
La musique est l'imitation de la parole. Mais c'est ce qu'elle ne pourrait être, si la parole n'avait déjà par elle-même quelque chose de musical. En réalité, la musique est déjà latente dans les paroles. « La parole est un bruit ou le chant est enfermé. » Il n'est que d'avoir l'oreille assez fine pour y saisir le chant. La parole, suivant les inflexions du sentiment qu'elle exprime, parcourt des intervalles, se pose sur divers points de l'échelle chromatique ; elle suit un rythme. Il s'agit de donner à tout cela la précision musicale, de fixer, d'arrêter ces intervalles existants, mais indécis, de déterminer ces points, de retenir le temps voulu la voix sur les plus caractéristiques, de dégager ce rythme. Naturellement, il n'est question que de la parole exprimant des sentiments de nature à être mis en musique, des sentiments empreints déjà d'un certain lyrisme, montés à un certain ton. Grétry trouvait cela au Théâtre-Français où il était assidu ; il notait par une suite de lignes montantes, descendantes, horizontales, la diction des acteurs, et, par un grossissement de son graphique, à l'aide des coups de pouce nécessaires, il faisait aboutir ses notations à la mélodie. C'étaient là ses études et comme ses cartons.
Assurément, cette minutie ne lui eût servi de rien, s'il n'avait eu le démon de l'invention musicale. Mais, comme il l'avait, il lui a trouvé dans ce mode de recherche un soutien et un guide merveilleux ; il lui a ménagé les efforts ; il l'a tenu en étroit contact avec la vérité et le naturel. Ces études de Grétry sur les inflexions de la parole sont à son inspiration mélodique ce qu'est à la plante grimpante la légère armature de fil de fer. On les comparerait encore à la carcasse des pièces d'artifice ; il fallait son génie pour y mettre le feu ; mais ce feu était dirigé à ravir et il ne s'en perdait pas une étincelle. Au surplus, la valeur de ce concours de méthode et de diable au corps trouve-t-elle sa preuve dans le résultat : Grétry a été le plus fertile entre les mélodistes français.
VII
C'est cette abondance mélodique qui, faute d'exécutions au théâtre, prête un grand charme à la lecture continue de ses meilleures œuvres. On assiste au jaillissement d'une onde fraîche, sans cesse renouvelée, largement épandue. La musique a eu des créateurs plus puissants, capables, certes, de frapper des coups plus forts. Elle n'en a pas eu qui donnassent davantage l'impression de n'être jamais à court. J'ai parlé d'un caractère de largeur. Ne croyons pas, en effet, parce que Grétry a été un musicien d'opéra-comique (le premier de nos musiciens d'opéra-comique) que son inspiration se meuve dans une sphère étroite. Je n'allègue pas ses essais dans le genre de la tragédie musicale où il a porté, avec beaucoup d'élégance et de sensibilité, des forces insuffisantes. Mais l'opéra-comique, tel qu'il le traite, si c'est souvent l'opéra-bouffe italien accordé au goût français, c'est souvent aussi la comédie moyenne, c'est-à-dire le genre qui comporte la plus grande variété de sentiments et de tons, le genre auquel songe Molière, dans son fameux parallèle de la tragédie et de la comédie. (Critique de I'Ecole des Femmes.) « Lorsque vous peignez des héros, fait-il dire à Dorante, vous faites ce que vous voulez ; ce sont des portraits à plaisir où l’on ne cherche point de ressemblance, et vous n'avez qu'à suivre les traits d'une imagination qui se donne l'essor et qui souvent laisse le vrai pour attraper le merveilleux. Mais lorsque vous peignez des hommes, il faut peindre d'après nature : on veut que ces portraits ressemblent et vous n'avez rien fait, si vous n'y faites reconnaître vos modèles. »
Peintre admirable de la cupidité effrontée dans les Deux Avares, de la vieillesse amoureuse et jalouse dans l’Amant jaloux de la tendresse et de la douleur paternelles dans Zémire et Azor, de l'amitié et de la fidélité chevaleresque dans Richard, du bonheur domestique dans Lucile, des élans, des gaîtés et des éphémères désespoirs de l'amour juvénile un peu partout, et, en vingt endroits aussi, admirable peintre de genre, dans des scènes de fêtes villageoises, dans des récits de batailles, de voyages, de tempêtes, de naufrages. J'ai nommé Molière et je ne dis pas que Grétry soit Molière. Mais il est au moins Regnard, un Regnard très fécond et du flux le plus aisé.
Comme tous les grands artistes, comme tous les esprits supérieurs, il a réuni et fondu harmonieusement dans sa personnalité les éléments les plus précieux des influences qu'il a subies : influences qui, à plusieurs égards, se fussent entre-détruites chez un esprit de second ordre. Sa musique est de Paris et de l'Ile-de-France, elle est de Rome (je ne parle pas de la Rome de Michel Ange, mais de celle de Pergolèse et du XVIIIe siècle) et elle est aussi de Liège, du pays wallon ; elle tient de cette dernière origine une naïveté, je ne sais quelle solidité de train qui, sans l'empêcher d'avoir beaucoup de vivacité et d'esprit, l'empêche d'en avoir trop. Voyez dans Richard (je prends volontiers mes exemples dans une partition que tout le monde a entre les mains), ces trois airs : « La danse n'est pas ce que j'aime... — Je crains de lui parler la nuit... — Un bandeau couvre les yeux ». C'est le génie de la vieille chanson française, avec la nuance d'espièglerie amoureuse chère à l'époque et un courant mélodieux tout italien. Cette fusion de qualités se retrouve dans des airs d'une note mâle. La chanson à boire de Blondel : « Que le sultan Saladin... » avec la placidité forte de son rythme, la franchise épanouie de son refrain, la perfection de sa ligne, est certainement une des choses les plus heureuses et les plus savoureuses qui existent dans toute la musique. Il suffit de rapprocher de ces morceaux, ceux-ci d'un ton plus relevé : « O Richard, ô mon roi » et « Si l'univers entier m'oublie... » pour avoir la preuve de cette variété que je signalais, comme la raison du haut rang où il convient de placer Grétry. Je m'abstiens de relever tous les témoignages que m'en fourniraient des partitions ignorées du public et peu accessibles. Mon but est de donner une impression générale, de faire naître une curiosité.
Il en était de cette facilité d'invention mélodique, comme il en est toujours de ce qui, dans les arts, donne cette belle impression du facile et du naturel : elle lui coûtait beaucoup de méditation et de peine. Il raconte que, pour trouver le motif si touchant et devenu si célèbre : « Une fièvre brûlante... », il se tortura sur son canapé de onze heures du soir à quatre heures du matin : un nouveau domestique, qu'il avait alors et à qui il commanda d'allumer le feu, croyait sa raison perdue. Un musicien, dit-il à ce propos, peut toujours faire à coup sûr « douze mesures d'harmonie tous les matins » ; mais pour découvrir une mélodie, pour mettre la main sur le point subtil, sur la source vive et cachée d'où doit jaillir l'accent vrai de la nature, s'il faut beaucoup de labeur aussi, c'est un labeur d'une autre sorte et l’on n'est pas sûr qu'il aboutira (je cite le sens). Remarque singulièrement précieuse et dont nos contemporains pourraient tirer grand profit. « Douze mesures d'harmonie », c'est sans doute une expression technique assez vague en elle-même, mais le sens n'en est pas douteux ; Grétry a en vue tout ce qui s'obtient par un travail de développement et de combinaison. Faut-il croire qu'il voue au dédain cette sorte de travail ? Il aurait le plus grand tort ; car !a composition musicale ne peut s'en passer et lui-même a pâti des inconvénients qu'il peut y avoir à n'y être pas un maître ; c'est son point faible. D'autre part, c'est une des particularités de la technique musicale que d'offrir mille ressources pour des développements opérés en quelque sorte à vide, sans idée qui vaille la peine d'être développée, et pour des combinaisons de sons et de formules susceptibles de se multiplier et de se raffiner indéfiniment sans aucun besoin, je veux dire sans aucune impulsion réelle d'inspiration et de vie. Il est assez humain que Grétry cherche comme une revanche de ses lacunes dans la constatation malicieuse de cette possibilité dont certains musiciens de son temps abusaient. Mais qu'eût-il dit, s'il eût vécu de nos jours! Qu'eût-il dit, s'il eût connu tels et tels musiciens contemporains, aspirants honorables, mais ratés au grand art, qui nous accablent, qui nous écrasent magistralement tout le long d'une heure de symphonie ou de cinq actes d'opéra, non point, comme le croit le bon public, par « abus de science », mais par le fait que leur dépense de « science » manque de raison d'être, n'étant motivée ni par la puissance de l'invention, ni par l'intensité du sentiment, ni par la pression d'aucune force vive de l'âme. Disons même que c'est à cause de cette absence de l'essentiel, que la « science » — mot d'ailleurs tout à fait impropre — paraît énormément ; là où il y a inspiration et maîtrise à la fois, elle existe, certes (et à un plus haut degré) mais on ne la remarque pas.
VIII
J'ai considéré Grétry dans la période fortunée et glorieuse de sa vie d'artiste. Elle dura un peu plus de vingt ans, de 1768 aux premières années de la Révolution. Les nombreux ouvrages qu'il donna pendant ce temps eurent des succès inégaux, mais plusieurs triomphèrent avec éclat et, en 1792, l'infatigable musicien comptait au total plus de victoires que d'échecs. Il a donc été un artiste exceptionnellement heureux. Cette partie de sa carrière fut, il est vrai, traversée par un évènement qui aurait pu la bouleverser : je veux dire la grande querelle de Glück et de Piccini, qui divisa le monde des musiciens et des amateurs en deux camps également acharnés à la lutte. Mais il eut le bonheur de se tirer indemne de ce tourbillon qui semblait ne devoir épargner aucune situation acquise, aucune réputation existante. Il en fut redevable pour une part à sa souplesse et à son savoir-faire personnels, pour une part bien plus notable, au mérite de ses ouvrages que recommandait, non le prestige de quelque artifice, mais le doux et solide éclat de la vérité. Le domaine de l'opéra-comique où il régnait ne fut pas enveloppé dans la bataille ou, du moins, n'en reçut pas de graves dommages.
La Révolution allait troubler beaucoup plus sérieusement ses intérêts. Ce n'est pas qu'il ait fait à son égard figure d'opposant ou seulement de boudeur, ni qu'il ait rien négligé pour obtenir la faveur de ses gouvernements successifs. Au contraire, on serait un peu gêné, dans la sympathie qu'il inspire par ailleurs, de l'empressement tenace qu'il a mis à se l'attirer et qui, à un certain moment, l'a conduit assez loin. Mais que voulez-vous? ce beau poète, parfait honnête homme dans le privé, bon mari, tendre père et homme d'esprit, c'est aussi un paysan, non moins entêté au gain qu'au travail et qui, sa besogne une fois faite et bien faite, ne s'embarrasse pas de délicatesses trop raffinées, quand il s'agit d'en tirer le légitime profit. Je tiens d'une tradition orale le trait suivant. Les jours où l’on donnait un de ses opéras, le compositeur, vêtu d'un manteau qui lui enveloppait à demi le visage, s'arrêtait devant les affiches de théâtre, en faisant les gestes d'un homme saisi et ravi de ce qu'il lit ; quand les passants s'étaient assemblés : « Hé quoi! s'écriait-il, on donne aujourd'hui l’Epreuve villageoise de Grétry, je cours retenir ma place. » Et il allait recommencer la scène à un autre « poste d'affichage », comme on disait alors. Cela est assez innocent. C'est tout à fait dans le même esprit d'innocence que notre homme fit largement le nécessaire pour réparer, aux yeux du sans-culottisme, le compromettant effet des faveurs dont la « tyrannie » avait couronné son talent. Lui qui, extrêmement sensible à l'élégance et à la grâce dans la société, avait plus que tout autre adoré la cour, qui en avait reçu des traitements délicieux, qui avait donné dans ses dédicaces au comte d'Artois, à la duchesse de Polignac, au duc de Choiseul, des modèles de flatterie fine et experte, peut-être se persuada-t-il réellement que « c'était aux sentiments de républicanisme qu'il avait sucés dès son enfance, qu'il devait l'amour de la liberté et l'horreur de l'esclavage » ; et « qu'il n'avait jamais pu tolérer la suffisance orgueilleuse des nobles fondée sur de faux préjugés ».
La chute de la royauté lui avait fait perdre les emplois (celui notamment de directeur de la musique de la reine) et pensions dont il subsistait, et il eut fallu être plus spartiate qu'on ne peut l'exiger d'un joueur de lyre pour ne pas désirer en obtenir quelque équivalent de la part du régime nouveau. Mais il y eut pis. A partir d'août 1792, la représentation des œuvres passées de Grétry devint à peu près impossible. Les bandes révolutionnaires s'étaient rendues maîtresses des salles de spectacles où elles accueillaient par des vociférations et des tumultes toute scène, tout propos évoquant, même de la façon la plus insignifiante et la plus anodine, et sans aucune intention particulière d'apologie, l'image des institutions politiques et sociales jetées par terre. C'est ainsi que « O Richard, ô mon roi » ne devait plus être chanté en public à cause du mot roi, et l’on conçoit que presque aucune des pièces de Grétry ne put trouver grâce devant une censure dont leurs auteurs n'avaient absolument pas prévu les susceptibilités toutes spéciales. La censure théâtrale révolutionnaire était littéralement placée au même point de vue (si l'on peut appeler cela y voir) que certain citoyen de nos jours qui, entendant un orateur politique faire allusion à « la noblesse des lieux » où il parlait (une région de la France chargée d’illustres et antiques souvenirs), l’interrompit rudement par ces mots : « il n’y a plus de noblesse ». Le Comité de Salut public édicta, entre autres mesures semblables, un ordre qui prescrivait de substituer la dénomination de « père sérieux » à celle de « père noble » dans le vocabulaire des théâtres. Bientôt les éléments turbulents de la foule ne tolérèrent plus sur la scène que des pièces politiques où leurs passions étaient flattées. Colinette à la cour, la Fausse Magie, ni Silvain n'étaient plus de saison. Les représenter devant les agitateurs et déclamateurs des clubs, n'eût-ce point été donner à des fauves des roses à dévorer ?
Grétry dut donc faire, comme les autres musiciens, de la musique révolutionnaire. Je n'inscrirai pas sous ce titre un Guillaume Tell paru en 1791, ouvrage inégal avec des parties énergiques qui se ressentent du sincère enthousiasme inspiré au compositeur, comme à tant d'autres, par un mouvement politique sur lequel on pouvait encore s'illusionner. Mais je relève dans la liste de ses productions, entre 1792 et 1794, Joseph Barra, « fait historique en un acte », un hymne pour la plantation de l'arbre de la Liberté, quelques morceaux pour l'opéra, le Congrès des rois, fait en collaboration avec plusieurs musiciens, enfin la Fête de la Raison ou la Rosière républicaine. Cette dernière œuvre est la seule qui jette une ombre sur la mémoire de Grétry. Elle respire un fanatisme que je ne crois pas sincère. On y voit un curé qui déchire sa soutane, son bréviaire et paraît vêtu en sans-culotte ; des femmes qui s'endorment à la récitation du Pater et de l’Ave Maria et se réveillent aux sons de l'hymne de la Raison. Ce spectacle fut donné en pleine Terreur. Et je préfère songer aux flétrissures que les Mémoires de Grétry ont infligées à ce régime.
IX
Il ne réussit d'ailleurs pas comme musicien révolutionnaire. Et, à voir ce que fut la musique de la Révolution, il faut l'en féliciter. A l'exception de la sublime Marseillaise, et des deux chefs-d'œuvre de Méhul : le Chant du départ et le Chant du retour (moins beau, mais bien fort et majestueux lui-même), l'histoire de l'art musical français n'offre rien de plus mauvais. Cherubini était un grand musicien, Gossec, un compositeur d'une verve fine et d'un habile tour de main, Lesueur, une nature d'artiste très intéressante et hardie. Mais leur musique civique, caractérisée par une grosse et creuse emphase qu'ils prennent pour de la majesté romaine, est insupportable. C'est quelque chose comme du Glück que le pompier du théâtre aurait refait à sa manière. Grétry ne pouvait se mettre à ce ton-là. Il avait trop longtemps vécu sous le règne du goût.
En outre, ces compositeurs apportaient une instrumentation plus riche et, il faut bien le dire, une écriture plus pleine que la sienne, qui avait toujours été maigrelette. Ces habitudes nouvelles contribuèrent aussi à détourner de lui le public. Pourtant, il se fit en 1797 une réaction en sa faveur. Lisbeth et Anacréon chez Polycrate (œuvre très intéressante quoiqu'on n'y retrouve plus la fleur de ses belles années) réussirent fort bien.
Pendant les dix dernières années de sa vie, il cessa à peu près de composer. La musique, disait-il, ne l’intéressait plus que par le côté théorique et philosophique et il se sentait obsédé par toutes les curiosités de l'esprit humain, Il se consacra à la méditation et se mit à écrire. Il le fit avec quelque naïveté, si l’on en juge par le titre d'un ouvrage paru en 1801 : De la Vérité : ce que nous fûmes, ce que nous sommes, ce que nous devrions être. Ces pages ont été réunies avec ses Mémoires et Essais sur la Musique publiés en 1789. Le tout forme trois assez gros volumes qui se lisent avec grand plaisir. Les Mémoires sont charmants. Les Essais, en dépit d'une certaine part de confusion dans les idées les plus générales, sont remplis de merveilles, particulièrement en ce qui concerne la musique vocale, la justesse de la mélodie, la prosodie et la déclamation, points dont le maître traite avec une finesse qui n’a pu être égalée. Quant à Grétry, métaphysicien, moraliste et organisateur de cités, c'est un disciple modéré de Jean-Jacques qui se répand dans un aimable fatras.
Il faut relever dans ses Mémoires une anecdote bien contée qui jette un jour très précis sur le caractère de Rousseau. Celui-ci, s'était fait présenter Grétry, à la première représentation de la Fausse Magie et, avec une grande effusion de sentiments, lui avait juré amitié immortelle. Comme ils demeuraient non loin l’un de l'autre, ils revinrent ensemble du théâtre. Les paveurs avaient laissé au milieu de la rue un tas de pierres que Jean-Jacques éprouvait de l’embarras à franchir et Grétry, plus jeune de près de trente ans, voulut l'y aider. Le philosophe se rembrunit, repoussa son aide et se sépara de lui sans mot dire, pour ne le revoir jamais.
La vie privée de Grétry avait été malheureuse. Marié à une femme aimante, simple et fidèle, il en eut trois charmantes filles, dont l'une, Lucile, était un petit génie musical, et que la phtisie emporta toutes trois avant la vingtième année. Dans les dernières années de son existence, il s'était installé à Montmorency dans le célèbre Ermitage de Rousseau, et c'est là que de nombreux visiteurs, parmi lesquels la reine Hortense et le jeune Boïeldieu, venaient rendre hommage à sa gloire. Le littérateur Bouilly, qui avait été fiancé à sa fille Antoinette, a tracé du vieillard ce portrait plaisant quoique un peu boursouflé : « Tout ce que l'esprit et la finesse ont de plus saisissant était empreint sur sa figure vénérable. A travers cette dignité d'un grand artiste habitué à d'éclatants hommages perçait une bonhomie qui charmait et rapprochait les distances. Un vieil accent liégeois, qu'il avait conservé depuis son enfance, donnait à ses paroles je ne sais quel attrait qui en doublait l'expression. Je croyais voir Anacréon ou bien Orphée ayant pris une nouvelle forme pour enchanter les mortels par les sons saisissants de sa lyre... »
Fétis, dans sa Biographie universelle des musiciens, nous donne de son illustre compatriote une impression différente. Il raconte que la société de Grétry était fort peu agréable, parce qu'il ramenait toujours la conversation sur ses ouvrages. Rien, en effet, de plus assommant, que cette manie si fréquente chez les artistes et qu'on excuse très volontiers de loin, mais qui ne se supporte pas de près. Il est probable que Fétis et Bouilly ont tous deux vu juste et qu'avec l'âge Grétry s'était amélioré en s'intéressant moins à lui-même. Cela aussi est fréquent.
Pierre Lasserre (1867-1930)
Homme de Lettres, critique littéraire,
docteur en philosophie
directeur de l'Ecole des Hautes Etudes
André Ernest Modeste GRÉTRY
par François-Joseph Fétis
in Biographie universelle des musiciens
et bibliographie générale de la musique
tome IV, 1866, pp. 102-109
GRÉTRY (ANDRÉ-ERNEST-MODESTE), né à Liège, le 11 février 1741, reçut le jour d'un musicien pauvre, qui était violoniste à la Collégiale de Saint-Denis. Une constitution faible, que divers accidents graves ébranlèrent encore, semblait le rendre peu propre au travail, et ne lui promettre qu’une existence courte et valétudinaire; cependant il vécut longtemps, fut rarement malade, et produisit un grand nombre d'ouvrages.
Dans son enfance, on ne connaissait guère d’autre éducation musicale que celle qu'on recevait dans les maîtrises des cathédrales ; aussi fut-il placé à la Collégiale comme enfant de chœur, à l’âge de six ans. Cette condition était fort pénible autrefois, parce que les maîtres de musique, imbus des préjugés d'une éducation despotique, croyaient ne pouvoir user de trop de sévérité envers leurs élèves ; dans la maîtrise de Liège, l'existence d'un enfant de chœur était un supplice continuel.
Une dureté excessive et déraisonnable de la part des maîtres n'est pas propre à hâter les progrès des élèves ; Il ne faut dons pas s'étonner si ceux de Grétry furent lents. On le crut incapable d'apprendre la musique, et son père fut obligé de le retirer de la maîtrise pour le confier aux soins d'un professeur habile, nommé Leclerc, qui fut depuis maître de musique à la cathédrale de Strasbourg. Celui-ci, aussi doux que le premier était brutal, rendit bientôt Grétry bon lecteur. Mais l'arrivée à Liège d'une troupe de chanteurs italiens, qui jouait les opéras de Pergolèse et de Buranello, fut l’évènement qui contribua surtout à développer en lui l'instinct de la musique; c'est en assistant aux représentations de ces ouvrages qu'il prit un goût passionné pour l'art dans lequel il s’est ensuite rendu célèbre.
Comme tous ceux que la nature a destinés à être compositeurs, Grétry commença à écrire presque dès l'enfance, et sans avoir appris les premiers éléments de la composition. Ses premiers ouvrages furent un motet à quatre voix, et une espèce de fugue instrumentale qu'il fit en suivant pas à pas une autre fugue dont il retourna le sujet. Ces premières productions parurent des merveilles aux amis de sa famille ; mais le fruit le plus avantageux qu'il en retira fut qu'on sentit la nécessité de lui donner un maître d'harmonie. Renekin, organiste de la Collégiale, lui en enseigna les principes, et peu de temps après le maître de chapelle de Saint-Paul, Moreau, commença à lui donner des leçons de contrepoint. Mais déjà il était trop tard pour qu'il pût donner à ses études l'attention nécessaire ; la fermentation de son imagination y mettait un obstacle invincible. « Je n'eus pas assez de patience pour m'en tenir à mes leçons de composition, dit-il ; j'avais mille idées de musique dans la tête, et le besoin d'en faire usage était trop vif pour que je pusse y résister. Je fis six symphonies ; elles furent exécutées dans notre ville avec succès.» (Essais sur la musique, t. 1er, p. 35.) Cette histoire est celle de tous les musiciens qui ont entrepris l’étude de leur art dans l'âge des passions, et lorsque le besoin de produire se fait déjà sentir ; elle explique les causes de l'ignorance où Grétry est resté toute sa vie des procédés de l'art d’écrire la musique, et de son peu d'aptitude à s'en instruire.
Un chanoine de la cathédrale de Liège avait suggéré au jeune compositeur la pensée d'aller à Rome. Le désir d'étudier n’était pas le motif le plus puissant pour l'engager à faire ce voyage. L'attrait d'un pays nouveau, le besoin de mouvement et d'agitation qu'on éprouve à dix-huit ans, et la persuasion qu'on est appelé à de hautes destinées, occupent surtout à cet âge. Quoi qu'il en soit, il fallait, pour entreprendre ce voyage, obtenir des secours du chapitre de Liège, car les parents de Grétry n'étaient pas riches. Une messe qu'il fit exécuter décida le chanoine à lui accorder ce qu'il désirait, et il partit, en 1760, pour la capitale du monde chrétien. Arrivé à Rome, il y fit choix de Casali pour maître de contrepoint, et étudia pendant quatre ou cinq ans sous la direction de ce professeur distingué, dont il ne paraît pas avoir apprécié le mérite. Sa manière d'écrire l’harmonie dans ses opéras, et son embarras visible lorsqu'il parle de cette science dans ses Essais sur la musique, prouvent que son temps fut assez mal employé. Ce n'était pas à être harmoniste qu'il était destiné : son génie le portait surtout à la musique dramatique et à l'expression des paroles.
Il avait composé quelques scènes italiennes et des symphonies qui furent entendues avec plaisir, et qui lui procurèrent un engagement pour le petit théâtre d'Aliberti, à Rome. L'intermède qu'il écrivit était intitulé Le Vendemiatrice : il fut bien accueilli par le public romain. Ce premier essai était de bon augure, et présageait au jeune musicien les succès qu'il a obtenus depuis. Ce fut peu de temps après que le hasard lui fit connaître le genre qu'il était appelé à traiter. Un secrétaire de la légation française lui avait prêté la partition de Rose et Colas. Charmé par la musique naturelle et gracieuse de Monsigny, et par le genre de l'ouvrage, Grétry sentit tout à coup sa véritable vocation : il s'éprit de passion pour l'opéra comique français. Paris pouvait seul lui offrir les moyens d'utiliser le talent qu'il tenait de la nature ; il le comprit et partit de Rome avec d'heureux pressentiments.
Grétry quitta l'Italie au mois de janvier 1767, après y avoir passé neuf ans, et se dirigea vers Genève. Il s'y arrêta dans l'intention de voir Voltaire et d'en obtenir un poème d'opéra comique. Quoique bien accueilli par ce grand homme, il n'en eut qu'une promesse vague pour un temps éloigné. Il y avait alors à Genève un Opéra-Comique français ; Grétry voulut y essayer son talent pour ce genre, et refit la musique d’Isabelle et Gertrude. L'ouvrage fut joué avec succès et eut six représentations, ce qui est beaucoup pour une petite ville comme était alors Genève. La nécessité de pourvoir à son existence l'obligeait à donner des leçons ; les femmes les plus distinguées de la ville voulurent l'avoir pour maître, en sorte qu'il jouissait d'une certaine aisance. Mais près d'une année s'était écoulée sans aucun résultat pour sa réputation; il avait vingt-huit ans et n’était pas connu. Voltaire lui conseilla d'aller directement au but et de se rendre à Paris, seul endroit, disait-il, où l’on peut aller promptement à l’immortalité. Grétry suivit ce conseil et arriva bientôt dans la grande ville, plein d'espérance et d'illusions qui ne tardèrent pas à se dissiper.
Ce qu'il y a de plus difficile pour un musicien qui veut travailler pour le théâtre, et qui n'est pas connu, c'est d'inspirer assez de confiance à quelque poète pour qu'il consente à hasarder le sort d'une pièce entre ses mains. Près de deux années furent perdues par Grétry en sollicitations infructueuses. Enfin Du Rozoy, dont le nom était aussi ignoré que le sien, écrivit pour lui les Mariages Samnites, ouvrage en trois actes, destiné à la Comédie Italienne, mais qu'on trouva d'un genre trop noble pour ce spectacle, et qu'on fut obligé d'arranger pour l’Opéra. Après bien des délais, le jour de la première répétition fut fixé. « C'est ici, dit le compositeur, qu'il faudrait une plume exercée pour décrire ce que j’entrevis de fâcheux sur la mine des musiciens rassemblés ; un froid glacial régnait partout : si je voulais, pendant l'exécution, ranimer de ma voix ou de mes gestes cette masse indolente, j'entendais rire à mes côtés, et l’on ne m’écoutait pas. » Ce fut encore pis le soir où la cour s'était rassemblée chez le prince de Conti pour entendre l'ouvrage avec l'orchestre : tout alla au plus mal, et chacun sortit persuadé que Grétry n'était point appelé à faire de la musique dramatique. Heureusement le comte de Creutz, envoyé de Suède, ne partagea pas l'opinion générale : il prit sous sa protection l'auteur des Mariages Samnites, et obtint de Marmontel qu'il lui confiât la petite comédie du Huron, la pièce, représentée le 20 août 1768, alla aux nues. La mélodie des airs du Huron est agréable et facile, et déjà l’on y remarque le talent naturel de l'auteur pour l’expression des paroles ; mais le peu d'élégance des formes musicales y est d'autant plus frappant que ce musicien arrivait d'Italie, où il avait passé près de dix ans, à l’époque où Piccinni, Jomelli, Majo et Galuppi produisaient des modèles de perfection en ce genre. On ne vit peut-être pas alors tout ce que Grétry pourrait faire par la suite ; mais on put juger de ce qui lui manquerait toujours.
Quelques mois après le Huron, parut Lucile, où l'on trouve un quatuor (Où peut-on être mieux qu'au sein de sa famille?) que tout le monde connaît, et qui est le seul morceau qu'on ait retenu. Mais le Tableau parlant, qui fut donné presque dans le même temps (1769), plaça dès ce moment Grétry au rang des meilleurs compositeurs français : cet ouvrage charmant a survécu aux diverses révolutions que la musique a éprouvées. Malgré les conditions désavantageuses de la comédie lyrique, où les airs se succèdent rapidement, et dans laquelle la même scène en contient plusieurs, malgré l'instrumentation faible et les formes vieillies de cette pièce, on l'écoute encore avec plaisir, parce que les mélodies en sont charmantes, naturelles, expressives. Rien de plus gracieux que le cantabile du duo de Colombine et de Pierrot : ce morceau serait un chef-d'œuvre, si la modulation en était plus variée, et si Grétry n'avait maladroitement parcouru deux fois la même série de tons, au lieu de transporter la réponse du thème principal à la dominante.
Trois opéras, Sylvain, les Deux Avares, et l’Amitié à l'épreuve, furent composés par Grétry dans l'année 1770. On a beaucoup vanté le premier, dans sa nouveauté ; le duo, Dans le sein d’un père, a eu surtout grand nombre d'admirateurs; néanmoins cet ouvrage m'a toujours paru languissant, et l’un des moins remarquables de l’auteur. Le duo même, quoiqu'on y trouve une belle phrase, manque de plan et n'est pas écrit dans les limites naturelles des voix. Le Sylvain est une des compositions de Grétry qui ont le plus vieilli ; il a disparu du théâtre depuis longtemps, et tout porte à croire qu'il n'y sera plus entendu. On ne joue plus les Deux Avares, parce que le genre de la pièce n'est plus à la mode ; mais on y trouve un duo du meilleur comique ; c'est celui, Prendre ainsi cet or, ces bijoux, un chœur de janissaires excellent (Ah ! qu'il est bon, qu’il est divin !), et plusieurs autres morceaux agréables. L'Amitié à l’épreuve n'a point réussi ; néanmoins la musique en est fort bonne : c'est un des ouvrages les mieux écrits de l’auteur.
Le succès de Zémire et Azor, qu'on joua dans l'automne de 1771, fut éclatant ; l’imagination de Grétry s’y montra dans toute sa fraîcheur; jamais il n'avait été plus riche de chants heureux que dans cet opéra. Rien de plus piquant qne l'air, Les esprits dont on nous fait peur ; rien de plus suave que le rondo, Du moment qu'on aime, etc. Malgré les transformations de certaines parties de la musique, de pareilles inspirations ne peuvent cesser d’être belles ni d'intéresser les artistes sans préjugés. Il y a aussi une multitude de phrases charmantes dans l’Ami de la maison ; c'est un tour de force que d'avoir pu intéresser par la musique dans une comédie aussi froide, aussi languissante. En voulant répéter cet espèce de défi dans le Magnifique, Grétry fut moins heureux. On a donné souvent des éloges à la scène de la rose ; ce qui n’empêche pas cette scène d'être longue et ennuyeuse. Il n'en est pas de même de la Rosière de Salency, qui fut jouée en 1774 ; là, tout est frais, élégant, dramatique. On connaît l'air, Ma barque légère; l'ouvrage fourmille de jolis traits qui ne le cèdent pas à celui-là. La Fausse Magie est une des mauvaises pièces que Marmontel a écrites pour Grétry. Il s'en attribuait tout le succès, et ne s'apercevait pas qu'elles ne devaient leur existence qu'à la musique. C'est l'esprit du musicien qui a soutenu la Fausse Magie et non celui du poète. Que de fois on est retourné entendre le duo : Quoi! c'est vous qu’elle préfère ! Sans ce duo et quelques jolis chants, personne n'aurait eu le courage d'entendre la pièce.
Grétry n'était pas né pour la tragédie lyrique. Il ne manquait cependant pas de force d'expression ; mais il ne pouvait soutenir un ton élevé pendant trois ou cinq actes. Céphale et Procris, qu'il donna an mois de mai 1775, Andromaque, jouée en 1780, Aspasie, et Denys le Tyran, tous représentés sans succès à l'Opéra, en sont la preuve. Le duo Donne-la-moi dans nos adieux (de Céphale) est cependant célèbre ; on y trouve plusieurs belles phrases, mais le morceau est mal disposé pour les voix et généralement mal écrit. D'ailleurs, ce n'est point assez d’un duo dans un opéra en trois actes.
La renommée de Grétry s'augmentait à chaque production de sa plume ; le Jugement de Midas (1778), L’Amant jaloux (même année), les Evènements imprévus (1779), Aucassin et Nicolette (même année), l’Epreuve villageoise (1784), et surtout Richard Cœur de Lion (1785), mirent le comble à sa gloire, et, dès lors, il n'eut plus de rivaux en France, pour l'opéra comique. Ces ouvrages sont si connus, qu'il est inutile de s'étendre sur leur mérite. Quant aux défauts que les musiciens peuvent y trouver, ils prennent en partie leur source dans le goût français de l’époque où leur auteur écrivait, et dans les moyens d'exécution dont il pouvait disposer. La Caravane du Caire, Panurge et Anacréon chez Polycrate, introduisirent à l'Opéra le genre de demi-caractère, et même le genre bouffe, car Panurge n'est qu'un opéra bouffon. Grétry était plus apte à traiter ces deux styles que celui de la tragédie ; aussi réussit-il complètement. Peu d'ouvrages ont été joués aussi souvent que ceux qui viennent d’être nommés ; la Caravane a été longtemps la ressource des administrateurs de 1'Opéra.
Au milieu des succès dont l'auteur de tant de productions voyait couronner ses travaux, un nouveau genre de musique, créé par Méhul et par Cherubini, s'était introduit sur la scène de l’Opéra-Comique. Cette musique, plus forte d'harmonie, plus riche d'instrumentation, et beaucoup plus énergique que celle de Grétry, devint tout à coup à la mode au commencement de la révolution, et fit oublier pendant plusieurs années le Tableau parlant, l’Amant jaloux et la Fausse Magie. Il n'y a point d'auteur qui se résigne de bonne grâce à l'oubli du public ; Grétry fut très-sensible à cette sorte de disgrâce, à laquelle il n'était pas préparé. Il n'aimait pas la musique nouvelle, mais il regrettait que des études plus fortes ne l’eussent point mis en état de lutter avec ses nouveaux adversaires : toutefois, comme on ne se rend jamais justice sur ce qui touche l'amour-propre, il ne se considéra pas comme vaincu, et il voulut rentrer dans la carrière en imitant, autant qu'il le pouvait, un genre qu'il dédaignait au fond de l’âme. C'est à ses efforts pour y parvenir qu'on doit Pierre le Grand, Lisbeth, Guillaume Tell et Elisea.
Quoiqu'on retrouve dans ces ouvrages des traces de son ancienne manière, on aperçoit facilement le tourment qu'il se donne pour être autre que la nature ne l'avait fait. Les mélodies de ces productions n'ont plus l'abandon, le naturel ni la verve qui distinguaient les œuvres de la jeunesse de Grétry ; en un not, il n'est plus qu'imitateur timide au lieu d'inventeur qu'il était.
La musique de Grétry était presque abandonnée, lorsque le célèbre acteur Elleviou entreprit de la remettre à la mode, et de la substituer aux grandes conceptions harmoniques alors en vogue, qui n'étaient pas de nature à faire briller ses facultés personnelles. Le talent dont il fit preuve dans Richard, dans l'Ami de la maison, dans le Tableau parlant et dans Zémire et Azor fut tel, que l'on ne voulut plus voir que ces ouvrages, qui étaient neufs pour une partie du public. Depuis lors, les œuvres de Grétry n'ont cessé de plaire au public français jusqu'a la nouvelle révolution qui, dans ces derniers temps, s'est opérée dans la musique dramatique. Les effets de celle-ci ont été d'accoutumer les spectateurs à de riches effets d'harmonie et d'instrumentation, et conséquemment de les rendre plus exigeants sous ces rapports. Rien ne pouvait nuire davantage à la musique de Grétry ; car ces parties de l'art musical sont précisément le côté faible de ses ouvrages. Le dédain qu'on affecte aujourd'hui pour les productions d'un homme de génie qui s'est illustré par de belles mélodies et par l'expression des paroles n'en est pas moins injuste. Au reste, Grétry attachait si peu d'importance à l’instrumentation de ses ouvrages, qu'il en chargeait ordinairement quelqu'un de ses amis. L'orchestre de ses vingt derniers opéras a été écrit par Panseron, père de l'auteur d'un grand nombre d'ouvrages pour l’enseignement du solfège, du chant et de l’harmonie.
Matroco, Colinette à la Cour, l’Embarras des richesses, le Comte d'Albert et sa suite, le Rival confident, les Méprises par ressemblance, le Prisonnier anglais, Amphitryon, et plusieurs autres opéras n'ont pas été mentionnés dans leur ordre chronologique, parce que, si l’on y retrouve quelquefois le musicien spirituel, si même ces partitions contiennent quelques airs remarquables, ils n'ont cependant rien ajouté à la réputation de leur auteur.
On a vu que la musique de Grétry brille surtout par le chant et par l'expression des paroles ; malheureusement toute qualité exagérée peut devenir un défaut : c’est ce qui a lieu dans les productions de ce musicien original. En s'occupant trop des détails, il négligeait l'effet des masses ; de là vient que sa musique, bonne pour les Français, n'a pas réussi chez les étrangers. Les observations minutieuses qu'il a faites sur ses propres ouvrages, dans ses Essais sur la musique, prouvent qu'il était bien moins préoccupé des formes musicales que du soin de rendre avec justesse un mot qui lui paraissait important. On en peut juger par ce qu'il dit d'un air de l'Amant jaloux. « L'endroit qui me paraît le mieux saisi dans l'air suivant, Plus de sœur, plus de frère, est la suspension après ses vers :
Mais si quelque confidente,
Malicieuse, impertinente,
Cherchait à tromper mon attente…
Les deux notes suivantes que fait l'orchestre en montant par semi-tons, expriment la mine que fait Lopez : j'aurais pu lui faire chanter ces deux notes sur une exclamation, Oh! mais le silence est plus éloquent. » Méhul disait avec justesse, en parlant de ces détails, que c'est de l'esprit, mais que ce n'est pas de la musique. On a dit spirituellement de Grétry : C’est un homme qui fait les portraits ressemblants, mais qui ne sait pas peindre. Ce qui a pu contribuer à empêcher ce compositeur de suivre les progrès de l’art dans l’effet musical, c'est le dédain qu'il avait pour toute autre musique que la sienne ; dédain qu'il ne prenait même pas la peine de dissimuler. Un de ses amis entrait un jour chez lui en fredonnant un motif : « Qu'est-ce que cela? demanda-t-il. — C'est, lui répondit son ami, un rondo de cet opéra que nous avons vu l’autre jour dans votre loge. — Ah ! oui, je m'en souviens ; ce jour où nous sommes arrivés trop tôt à Richard ! » Il s'agissait d'un des meilleurs ouvrages du répertoire de l'Opéra-Comique. L’excès de son amour-propre et ses opinions sur les œuvres des autres musiciens prenaient leur source dans sa manière absolue de concevoir la musique dramatique. Le savoir profond dans l'art d'écrire, la pureté de style, la qualité des idées mélodiques, abstraction faite de l'expression dramatique, enfin le coloris musical, n’étaient rien pour lui. On dissertait un soir, au foyer de l’Opéra-Comique, sur les instruments qui produisent le plus d'effet et, en général, sur les moyens d'exciter de fortes émotions par la musique de théâtre. Plusieurs compositeurs distingués assistaient à cette discussion ; chacun proposait ses vues et disait son mot ; les opinions étaient partagées. « Messieurs, dit l'auteur de l’Amant jaloux, je connais quelque chose qui fait plus d'effet que tout cela. — Quoi donc? — La vérité. » Ce mot peint Grétry d'un seul trait ; il est rempli de justesse ; mais celui qui le disait ne voyait pas que la vérité dans les arts est susceptible d'une multitude de nuances, et que pour être vrai il faut être coloriste autant que dessinateur, il n'était donc pas inutile de chercher à augmenter l'effet des couleurs musicales.
On connaît quelques mots de Grétry qui indiquent de la finesse dans l’esprit; il aimait à en dire, mais ses saillies manquaient quelquefois de justesse. Par exemple, interrogé par Napoléon sur la différence qu'il trouvait entre Mozart et Cimarosa, il répondit: « Cimarosa met la statue sur le théâtre, et le piédestal dans l’orchestre ; au lieu que Mozart met la statue dans l'orchestre et le piédestal sur le théâtre. » On ne sait ce que cela veut dire. Il faut que la statue et le piédestal ne soient point séparés. Grétry, qui n'était pas assez musicien pour concevoir la mélodie et les parties d'accompagnement d'un seul jet, séparait toujours deux choses qui ne doivent en faire qu'une. Nul doute qu'il n'ait voulu dire que l’instrumentation de Mozart l'emporte sur ses chants et sur l'expression dramatique : mais il se trompait. Il ne comprenait pas cette musique, trop forte pour lui, et n’était pas plus avancé, à cet égard, que le public de son temps. Malgré ses prétentions à l'esprit, sa conversation était plus fatigante qu'agréable, parce qu'elle n'avait et ne pouvait avoir que lui ou ses ouvrages pour objet. Il y revenait sans cesse, et l'habitude qu'il avait de vivre entouré d'amateurs passionnés de sa musique, qui ne l'entretenaient que de choses dont son amour-propre était flatté, lui rendait tout autre entretien insupportable. Bien qu'il attachât beaucoup d'importance à sa qualité d'écrivain, son ignorance en ce qui concerne l'histoire, la littérature et le mécanisme du style, était complète. En 1789, il publia à Paris un volume in-8°, sous le titre de Mémoires ou Essais sur la musique. Ce volume contenait l’histoire de sa vie et celle des ouvrages qu'il avait fait représenter jusqu'alors. En 1797 (an V) il obtint du gouvernement français la réimpression gratuite à l'Imprimerie Nationale de cet ouvrage, auquel il joignit deux nouveaux volumes. On a dit avec justesse que Grétry aurait dû appeler son livre Essai sur ma musique ; il n'y parle, en effet, que de ses opéras. Quoi qu'il en soit, Grétry n'a point écrit les trois volumes qui portent son nom ; il n'en a jeté que les idées informes sur le papier : ce fut un de ses amis, nommé Legrand, ancien professeur au collège du Plessis, qui leur donna la forme qu'ils ont aujourd'hui. Le premier volume, qui contient la partie historique de la vie et des ouvrages de Grétry, est le plus intéressant. Les autres ne renferment que de longues et faibles dissertations sur une métaphysique de l'art dont les musiciens ne sauraient rien tirer d'utile. Moes, ancien professeur de musique à Bruxelles, a donné une nouvelle édition des mémoires de Grétry, avec des notes, Bruxelles, 1829, trois vol. in-18. En 1802 (an X), Grétry a publié une Méthode simple pour apprendre à préluder, en peu de temps, avec toutes les ressources de l’harmonie, Paris, de l'Imprimerie de la République, in-8° de quatre-vingt-quinze pages. Ce livre est celui d'un écolier, et démontre la profonde ignorance de l'auteur sur la matière qu'il voulait traiter. Il lui prit aussi fantaisie d'écrire, vers le même temps, un livre qu'il publia sous le titre de la Vérité, ou ce que nous fûmes, ce que nous sommes, ce que nous devrions être (Paris, 1802, trois vol. in-8°). Il avait cru s’y montrer profondément versé dans les sciences politiques ; mais on a dit avec justesse qu'il y a justifié le proverbe: Ne sutor ultra crepidam. Ayant renoncé à la musique dans ses dernières années, il ne s'en occupait plus que d'une manière spéculative, et avait consigné ses réflexions sur cet art ainsi que sur beaucoup d'autres objets dans un ouvrage auquel il donnait le titre de Réflexions d’un solitaire. Deux ans avant sa mort, il en avait annoncé la publication prochaine à un de ses amis, et assurait qu'il travaillait au sixième volume! Soit qu'on n'ait point retrouvé son manuscrit, soit que, soigneux de sa gloire, ses amis l’aient condamné à l'oubli, ce livre n'a point paru.
Des honneurs de tout genre ont été accordés à Grétry, même pendant sa vie. Dès l’année 1785, la ville de Paris avait donné son nom à l'une des rues qui avoisinent le Théâtre Italien, et ce nom lui est resté. Son buste fut placé vers le même temps au grand foyer de l'Opéra. Le comte de Livry lui fit ériger, vers 1809, une statue en marbre qui a été placée sous le vestibule du théâtre de l'Opéra-Comique. Son portrait fut gravé, en 1776, et copié plusieurs fois. Plus tard, Isabey dessina de nouveau un portrait fort ressemblant de ce compositeur célèbre, qui fut gravé par Simon ; enfin, un autre portrait fut lithographié par M. Maurin, en 1829, d’après celui qui avait été peint par Robert Lefèvre pour la salle d'assemblée de l’Opéra-Comiqne, et fut publié par la deuxième livraison de la Galerie des musiciens avec une notice par l'auteur de ce dictionnaire. A l’âge de vingt-six ans, Grétry fut admis dans l'Académie des philharmoniques de Bologne. Lors de la formation de l’Institut, en 1796, on le choisit pour remplir une des trois places de compositeurs dans la section de musique de la classe des beaux-arts. Plus tard, il fut nommé correspondant de la société d’Emulation de Liège, membre de l’Académie de musique de Stockholm, et de plusieurs autres sociétés savantes. Le prince évêque de Liège lui avait donné le titre de conseiller intime, en 1784 ; une place de censeur royal pour la musique lui fut accordée vers le même temps, et à plusieurs époques il fut membre du jury de l’Opéra. Ayant été nommé, en 1795, inspecteur de l’enseignement au Conservatoire de musique, il en remplit d'abord les fonctions mais au bout de quelques mois, le besoin de recouvrer sa liberté lui fit demander sa démission. Napoléon lui accorda la décoration de la Légion d'honneur à la création de cet ordre.
Recherché par quelques hommes puissants de l'ancienne cour, il en fut comblé de bienfaits. En 1782, il lui avait été accordé une pension de mille francs sur la caisse de l'Opéra ; le roi lui en donna une autre de mille écus, vers le même temps, et la Comédie Italienne le mit au nombre de ses pensionnaires, en 1786. A ces revenus assez considérables se joignait le produit de diverses sommes qu'il avait placées sur l'État : la révolution de 1789 renversa l'édifice de sa fortune. Le succès éclatant de ses ouvrages, à l'époque où ils furent remis en scène, par Elleviou, et le produit considérable qu'il en retirait, joint à une pension de quatre mille francs qui lui avait été accordée par Napoléon, lui rendit l’aisance qu'il avait perdue, et il en jouit jusqu'à la fin de ses jours. Grétry avait été marié et avait eu plusieurs enfants ; l'une de ses filles, qui s'est fait connaître par la musique de deux petits opéras, annonçait d'heureuses dispositions ; mais elle mourut jeune, et son père eut le malheur de survivre à toute sa famille.
L'acquisition de l'Ermitage de J.-J. Rousseau, à Montmorency, que Grétry avait faite, le détermina à se retirer à la campagne, et à y passer la plus grande partie de ses dernières années. Il s’y plaisait et y retrouvait une gaieté qui l'abandonnait aussitôt qu'il se retrouvait à Paris. Un évènement funeste lui fit quitter brusquement ce séjour. Un de ses voisins, meunier de profession et au-dessus de son état par son éducation, fut assassiné dans son moulin, le 30 août 1811. Dès ce moment, Grétry ne fut plus tranquille chez lui. De retour à Paris, il eut recours aux ressources de la médecine pour rétablir sa santé, fort affaiblie depuis quelque temps, mais elles n'eurent d'autre résultat que de prolonger ses souffrances. Ne se dissimulant pas que sa fin approchait, il voulut qu'au moins elle fût douce, et demanda qu'on le ramenât à l'Ermitage ; ses forces s'affaiblirent insensiblement, et, le 24 septembre 1813, il cessa de vivre. Les poètes et les compositeurs, les professeurs du Conservatoire de musique, et les acteurs des principaux théâtres de Paris se joignirent aux membres de l'Institut pour honorer ses funérailles ; elles furent dignes de la renommée d'un tel artiste. Le 6 octobre, sa messe de Requiem fut exécutée à grand orchestre à l'église Saint-Roch. Le convoi parcourut une partie des rues de Paris, et s'arrêta devant les deux théâtres lyriques principaux avant de se rendre au cimetière de l'Est. Plusieurs discours furent prononcés sur sa tombe; son éloge, par Méhul, ne fut pas le moins remarquable de tous ces morceaux. Le soir même, on exécuta à l'Opéra-Comique une sorte d'Apothéose qui excita une vive émotion parmi les spectateurs. Pendant plusieurs jours, on ne joua à l’Opéra et à l’Opéra-Comique que des ouvrages composés par Grétry ; enfin, rien ne manqua aux honneurs qui lui furent accordés. Déjà, dès le mois de février 1809, la Société académique des Enfants d'Apollon avait rendu hommage aux talents remarquables de ce compositeur, en le nommant l'un de ses membres. Au mois de mars suivant, un concert composé seulement de morceaux de Grétry fut exécuté par les membres de cette société savante, et des discours, qui avaient pour objet son éloge, furent prononcés par Guichard et par Bouilly. Les détails de cette séance ont été réimprimés dans une brochure de vingt pages in-4°, sous le titre de : Hommage rendu à Grétry. Joachim Le Breton, secrétaire de la classe des beaux-arts de l'Institut royal de France, lut, dans la séance publique du 1er octobre 1814, une Notice sur la vie et les ouvrages d'André-Ernest Grétry, qui a été imprimée dans la même année par Firmin Didot (Paris, 1814, in-4° de trente-quatre pages. M. de Gerlache, premier président de la cour de cassation à Bruxelles, a publié une notice intitulée : Essai sur Grétry, lu à la séance publique de la Société d’émulation de Liège, le 25 avril 1821, Liège, 1821, in-8°. Une deuxième édition de cet essai a paru à Bruxelles, chez Hayez, en 1843, gr. in-8° de quarante-quatre pages, et l'auteur l'a reproduit dans son Histoire de Liège, depuis César jusqu'à Maximilien de Bavière, Bruxelles, Hayez, 1843, un volume in-8°. Diverses autres notices ont été données dans la Biographie universelle de MM. Michaud, dans la Biographie des contemporains, publiée par MM. Arnaud, de Jouy, etc., dans la Biographie universelle et portative des contemporains, de Raab, et dans plusieurs autres ouvrages du même genre ; l'auteur de ce dictionnaire en a donné une, accompagnée du portrait de Grétry et d'un fac-simile de sa notation, dans la deuxième livraison de sa Galerie des musiciens célèbres, Paris, 1828, gr. in-fol. André- Joseph Grétry, neveu du célèbre compositeur, a publié : Grétry en famille, ou anecdotes littéraires et musicales relatives à ce célèbre compositeur (Paris, 1815, in-12). Le comte de Livry avait fait paraître auparavant un Recueil de lettres écrites à Grétry ou à son sujet, Paris, Ogier, sans date (1809), in-8° de cent cinquante-sept pages. Le gouvernement de la Belgique ayant fait faire la statue de Grétry par M. Guillaume Geefs, sculpteur à Bruxelles, on en fit l'inauguration à Liège, sur la place de l’Université en 1842. A cette occasion, les écrits dont voici les titres furent publiés : 1° Grétry, par M. Félix Van Hulst, Liège, 1843, in-8°, avec portrait. 2° A toutes les gloires de l'ancien pays de Liège : inauguration de la statue de Grétry, 18 juillet 1842, par M. Polain, professeur de l’Université, membre de l'Académie royale de Belgique, ibid., in-8°. 3° La statue de Grétry, poème, par M. Etienne Henaux, ibid., 1842, in-8°. M. Flamant, époux de la nièce de Grétry, dans le dessein d'honorer la mémoire de son illustre parent, avait offert son cœur aux magistrats de la ville de Liège ; un procès fameux fut la suite de cette offre. M. Flamant, dans un volume qui a pour titre : Cause célèbre relative au procès du cœur de Grétry (Paris, 1825, in-8°), ainsi que dans plusieurs mémoires et brochures, a rendu compte des circonstances de ce procès ; il a donné aussi l’ Itinéraire historique, biographique et topographique de la vallée d'Enghien à Montmorency, précédé des mémoires de l'auteur et de l’histoire complète du procès relatif au cœur de Grétry (Paris, 1826, in-8°). Enfin, M. Frémolle, de Bruxelles, a fait imprimer une brochure sous ce titre : Hommage aux mânes de Grétry au moment de la restitution du cœur de ce grand homme à sa patrie (Bruxelles, 1828), opuscule qui contient des Réflexions historiques sur le compositeur.
Voici la liste des ouvrages de Grétry :
POUR L’ÉGLISE : 1° Messe solennelle à quatre voix, à Liège, en 1759. 2° Confiteor à quatre voix et orchestre, à Rome, en 1762. La Bibliothèque du Conservatoire de musique de Paris possède le manuscrit autographe de cet ouvrage. 3° Six motets à deux et trois voix, à Rome, 1763 et années suivantes. 4° De profundis (voyez le essais sur la musique, t. Ier, p. 78 et 79). 4° bis Messe de Requiem.
MUSIQUE INSTRUMENTALE : 5° Six symphonies pour orchestre, à Liège, en 1758. 6° Deux quatuors pour clavecin, flûte, violon et basse, gravés à Paris, 1768, et ensuite à Offenbach, comme oeuvre 1er. 7° Six sonates pour le clavecin, Paris, 1768. 8° Six quatuors pour deux violons, viole et basse, œuvre 3e, Paris, 1760. Les thèmes de ces œuvres de musique instrumentale se trouvent dans le neuvième supplément du catalogue de Breitkopf, Leipsick, 1774.
OPÉRAS : 9° le Vendemiatrice, intermède, au théâtre d'Alberti, à Rome, en 1765. 10° Isabelle et Gertrude, Genève, 1707. A Paris, à la Comédie-Italienne, 11° le Huron, en deux actes, 1768. 12° Lucile, en un acte, 1760. Le Tableau parlant, 1769. 14° Sylvain, en un acte, 1770. 15° Les Deux Avares, 1770. 16° L'Amitié à l'épreuve, en deux actes, 1771 , réduit en un acte, 1776, et remis en trois actes, en 1786. 17° Zémire et Azor, en trois actes, 1771. 18° l'Ami de la maison, en trois actes, 1772. 19° Le magnifique, en trois actes, 1773. 20° La Rosière de Salency, en quatre actes, puis en trois, 1774. 21° La Fausse Magie, en deux actes, 1775. 22° Les Mariages samnites, en trois actes, 1776, repris en 1782, avec des changements. 23° Matroco, en quatre actes, 1778. 24° Le Jugement de Midas, en trois actes, 1778. 25° Les Evènements imprévus, en trois actes, 1779. 26° Aucassin et Nicolette, en trois actes, 1780. 27° Thalie au Nouveau-Théâtre, prologue pour l'ouverture du théâtre Favart, en 1783. 28° Théodore et Paulin, en trois actes, représenté sans succès, le 18 mars 1783 ; remis au théâtre avec beaucoup d’effet, le 24 juin de la même année, sous le titre de l'Épreuve villageoise, en deux actes. 29° Richard Cœur de Lion, en trois actes, 1784. 30° Les Méprises par ressemblance, en trois actes, 1786. 31° Le comte d’Albert, en deux actes, 1787. 32° La Suite du comte d’Alberi, en un acte, 1787. 33° Le Prisonnier anglais, en trois actes, 1787, remis an théâtre, en 1793, avec des changements, sous le titre de Clarice et Bellon. 34° Le Rival confident, en deux actes, 1788, sans succès. 35° Raoul Barbe-Bleue, en trois actes, 1789. 36° Pierre le Grand, en trois actes, 1790. 37° Guillaume Tell, en trois actes, 1791. 38° Basile, ou à Trompeur trompeur et demi, en un acte, 1792. 39° Les Deux couvents, en deux actes, 1792. 40° Joseph Barra, en un acte, 1794, 41° Callias, ou Amour et Patrie. 42° Lisbeth, en trois actes, 1797. 43° Elisea, en un acte, 1799, au théâtre Feydeau. 44° Le Barbier de village, en un acte 1797. A l’Opéra : 45° Céphale et Procris, en trois actes, 1775. 46° Les Trois Ages de l’opéra, prologue dramatique, en 1778. 47° Andromaque, en trois actes 1780. 48° Émilie, en un acte 1781. 49° La Double Épreuve, ou Colinette à la cour, en trois actes 1782. 50° L’Embarras des richesses, en trois actes, 1782. 51° La Caravane du Caire, en trois acte, 1783. 52° Panurge dans l’île des Lanternes, en trois actes, 1785. 53° Amphitryon, en trois actes, 1788. 54° Aspasie, en trois actes, 1789. 55° Denis le Tyran, maître d’école à Corinthe, en trois actes, 1794. 56° Anacréon chez Polycrate, en trois actes, 1797. 57° Le Casque et les colombes, en un acte, 1801. 58° Delphis et Mopsa, en trois actes, 1805. Outre ces ouvrages, Grétry a écrit pour la cour, en 1777 : 59° Les divertissements d’Amour pour amour, comédie de Lachaussée, sur des paroles de Laujon. 60° Les Filles pourvues, compliment de clôture pour la Comédie-Italienne. 61° Momus sur la terre, prologue donné au château de la Roche-Guyon. Il a laissé aussi en manuscrit les partitions d’opéras non représentés dont les noms suivent : 62° Alcindor et Zaïde, en trois actes. 63° Ziméo, en trois actes. 64° Zeimar ou l’Asile, en un acte. 65° Électre, en trois actes. 66° Diogène et Alexandre, en trois actes. 67° Les Maures d’Espagne, en trois actes. L'auteur de l'article Grétry, dans la Biographie universelle et portative des contemporains, dit que Frey, éditeur de musique, a fait graver de nouveau, en 1825, trente-deux des meilleures partitions de ce compositeur célèbre : c'est une erreur. Les planches dont on s'est servi pour cette publication sont celles des anciennes éditions ; on a seulement rafraîchi les frontispices. Castil-Blaze a donné, en 1837, un choix de morceaux des opéras de Grétry, arrangés avec accompagnement de piano, sous le titre de : Grétry des Concerts.
François-Joseph Fétis (1866)