François BAZIN - Édouard BATISTE - Aimé MAILLART - Théodore MOZIN - Alexis de GARAUDÉ - Alexis ROGER - Eugène GAUTIER - Henri DUVERNOY - Alexandre MARCHAND - Victor MASSÉ - Renaud de VILBAC - Henri MERTENS - Eugène ORTOLAN - Léon GASTINEL - Louis DEFFÈS - Eugène CRÉVECOEUR - Jules DUPRATO - Auguste BAZILLE - Georges MATHIAS - Ernest CAHEN - Émile JONAS
1840
 |
François Bazin en 1866
( photo Pierre Petit, coll. Bnf-Gallica ) DR
|
François BAZIN (1816-1878)
par Edouard Noël et Edmond Stoulig (1878)
in Les Annales du théâtre et de la musique, année 1878
BAZIN (François-Emmanuel-Joseph), compositeur français, né à Marseille le 4 septembre 1819, mort à Paris, le 2 juillet 1878. — Fils d'un chef de division de la préfecture des Bouches-du-Rhône, François Bazin entra en 1836 au Conservatoire de Paris et y remporta successivement les premiers prix d'harmonie et d'accompagnement pratique, et en 1840 le grand prix de Rome. C'est le seul compositeur dont la cantate de concours, Loyse de Mont fort, ait été représentée à l'Opéra, où elle fut donnée plusieurs fois de suite. En Italie, Bazin se consacra plus volontiers à la musique religieuse ; mais de retour à Paris, il se mit à écrire pour le théâtre et fit représenter à l'Opéra-Comiqne : le Trompette de Monsieur le Prince, le Malheur d'être jolie, la Saint-Sylvestre, Madelon, les Désespérés, Maître Pathelin, le Voyage en Chine, l'Ours et le Pacha. Plusieurs de ses ouvrages ont obtenu beaucoup de succès. Après avoir eu l'honneur d'être attaché, dès le début de sa carrière, comme professeur adjoint de la classe d'harmonie au Conservatoire, il ne tarda pas à en devenir définitivement professeur titulaire. Son enseignement était très apprécié par les artistes. II a été résumé par lui en un traité d'harmonie qui est un chef-d'œuvre de clarté, de science et de précision. C'est le professeur dont les élèves avaient le plus de succès aux concours de fin d'année. "Esprit calme, correct et concis, disait sur sa tombe encore ouverte M. Emile Jonas au nom de la société des auteurs et compositeurs dramatique, François Bazin avait l'intelligence trop haute pour ne pas suivre avec intérêt les efforts et les recherches de la nouvelle école musicale. Son style clair, facile, presque familier, donnait à ses ouvrages cette grâce aimable qui caractérisait l'ancien opéra-comique, dont il était resté un des plus fidèles représentants." François Bazin était membre de l'Institut et officier de la Légion d'honneur.
Edouard Noël et Edmond Stoulig
Note de la rédaction de Musica et Memoria : François, Emmanuel, Joseph Bazin, est né le 4 septembre 1876, au domicile de ses parents, 9 cours Julien. Son père, Joseph, Emilien, Bernard Bazin était alors "secrétaire au Commissariat général de police" de Marseille et sa mère, née Thérèse, Magdeleine Amyot, sans profession. Son grand-père paternel, Jean, Joseph, Pancrace Bazin avait été autrefois "vérificateur des Douanes royales". Célibataire, il est mort le 2 juillet 1876 à Paris, se trouvant alors chez Gaston Le Couppey, 47 rue Laffitte. Au conservatoire de Paris, il a été précisément professeur adjoint d'harmonie et accompagnement à partir de 1837, avant d'être titularisé comme professeur à compter du 1er janvier 1849, puis de prendre la classe de composition le 1er octobre 1871. Parmi ses élèves figure son neveu, Joseph Célestin Bazin, né le 18 novembre 1843 à Saint-Malo, décédé le 12 novembre 1921 à Toulouse. Ayant débuté une carrière d'organiste dès 1862 à Rennes (Toussaints, Carmes), il s'engagea ensuite dans l'armée le 7 octobre 1870 où il fit carrière avant de prendre sa retraite en 1900 après avoir été nommé en 1898 au grade de Chef de bataillon au 83e Régiment d'infanterie. Retiré à Toulouse, il reprit ses activités d'organiste en 1901 à l'église Saint-Jérôme dont il fut titulaire durant vingt ans, jusqu'à son décès. On lui connaît de nombreuses pièces pianistiques de genre publiées, ainsi que quelques pages pour orgue et des mélodies. Le fils de ce dernier, Noël Bazin, né le 17 décembre 1892 à Castelsarrazin, sous-lieutenant dans le même régiment où son père avait autrefois exercé, fut tué au combat d'Arras, le 16 juin 1915 à l'âge de 22 ans.
 |
François Bazin, Cours d'harmonie
( Paris, Léon Escudier, coll. Max Méreaux ) DR
|
par Camille Le Senne (1914)
in Encyclopédie de la musique et Dictionnaire du Conservatoire
Fondé par Albert Lavignac (Paris, Librairie Delagrave, 1931)
Le 15 mai 1816, l'Opéra-Comique représentait un petit opéra-comique en un acte, le Trompette de M. le Prince, répété sous le titre de la Chambre, et dû à la collaboration de Mélesville et de François Bazin. Vingt-deux représentations dans l'année, avec le maintien de la pièce au répertoire pendant un assez long temps, marquèrent le favorable accueil fait au début du jeune compositeur. Lauréat de l'Institut, où il obtenait en 1839 le second prix, tandis que le premier était remporté par Charles Gounod, il avait mérité en 1840 la plus haute récompense, avait séjourné à Rome le temps réglementaire et revenait à Paris, plein d'une ambition légitime, que l'avenir devait satisfaire largement ; car il connut la fortune, le succès, les honneurs.
Cependant il ne fut qu'à moitié heureux en 1847. Le goût de l’époque ne poussait point l'art vers les complications musicales ; aussi on est surpris de voir reprocher à Bazin « la coquetterie pointue et maniérée de l'école actuelle » à propos de son opéra-comique représenté le 18 mai, le Malheur d'être jolie. Pour expliquer l'insuccès, il suffisait de s'en prendre à l'absurdité du livret. Le librettiste s'appelait Charles Desnoyers, alors secrétaire de l'administration du Théâtre-Français ; ce qui fit dire à un plaisant critique : « On voudrait que cette place lui donnât plus d'occupation! » Un autre ajouta : « Ce petit opéra... ne fera pas résonner longtemps, pour M. Bazin, la trompette de la renommée ; celle de M. le Prince aura pour lui plus de retentissement. » En effet, le Malheur d'être jolie, répété sous le nom d'Isolier, ne fut joué que cinq fois.
Madelon, qui s'appelait d'abord les Barreaux Verts, fut représentée le 26 mars 1852. Grâce à quelques coupures, Madelon, que personnifiait d'abord avec beaucoup de charme et d'entrain Mlle Lefebvre, remplacée peu après, pour cause de maladie, par Mlle Talmon, fut trouvée une cabaretière accorte, ayant le sourire aux lèvres et chantant de joyeux refrains ; on lui fit bon accueil, et la pièce, qu'on avait jouée 48 fois la première année, dura jusqu'en 1858, ou elle atteignit sa 76e et dernière représentation.
Une seule pièce de François Bazin s'est maintenue assez longtemps au répertoire : le Voyaye en Chine, joué en 1855 à l'Opéra-Comique. Il s'agit de l'entêtement féroce de deux Bretons dont l'un refuse sa fille à l'autre, qui l'attire sur son navire, lui fait croire qu'on est en route pour Pékin tandis qu'on navigue en vue de Cherbourg, et finalement lui arrache son consentement, comme rançon de délivrance, comme prix du retour à terre. Cette fantaisie, taillée quelque peu sur le modèle du Voyage à Dieppe, était pour Labiche et Delacour leur début de collaboration à l’Opéra-Comique. Dès le 5 mai, ils avaient lu aux artistes leur comédie, qui devait prendre rang après Fior d'Aliza. Victor Masset ayant tardé à livrer sa partition, le Voyage en Chine passa le premier et remporta dès le premier soir un éclatant succès. Le livret surtout réunit tous les suffrages : presse et public furent d'accord pour applaudir à la gaieté des situations et à l'esprit du dialogue. La musique ne déplut pas, si l'on en juge par le succès populaire qu'obtinrent les couplets des cailloux, la marche, le duo des Bretons : « La Chine est un pays charmant, » et le chœur du cidre de Normandie. Peut-être se montra-t-on moins sévère qu'on ne le serait aujourd'hui ; dans son compte rendu, pourtant, M. Auguste Durand qualifiait cette musique avec autant de justesse que d'esprit, en écrivant qu' « elle ne gênait aucunement la pièce ». Il laissait entendre ainsi que les mots l’emportaient sur les notes ; on en eut la preuve le jour où la partition parut chez Lemoine : par une exception flatteuse pour les librettistes, mais contraire aux usages, tout le texte parlé y avait été gravé!
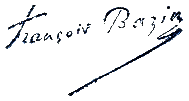 |
Signature autographe de François Bazin apposée sur son Cours d'harmonie
( coll. Max Méreaux ) DR
|
Une grosse part de la réussite revint d'ailleurs aux interprètes, qui, dans cette pièce, se passant de nos jours, avec des costumes modernes, trouvèrent, tous, des rôles appropriés à leur talent. Du côté des femmes, Mmes Cico, Révilly et Camille Gontié, une débutante dont le rôle de Berthe était la première création ; du côté des hommes, Montaubry, toujours élégant chanteur ; Couderc, excellent et trop tôt remplacé par Potel, le 13 janvier, à la quatorzième représentation. Prilleux, notaire prud'hommesque qui vantait si plaisamment le mérite de ses filles, « deux bonnes natures» ; enfin Sainte-Foy, de qui MM. Yveling Rambaud et E. Coulon ont pu justement dire dans leurs Théâtres en robe de chambre : « il faut lui rendre cette justice que, dans ces derniers temps, il a laissé de côté les traditions de la vieille école comique à laquelle il appartient de cœur, pour chercher des effets à la manière de la génération nouvelle. L'Opéra-Comique sans Sainte-Foy est un dîner sans vin. » Quant à Ponchard, il avait dû céder le 9 janvier le rôle du jeune Fréval à cause de la mort de son père, le vieux Ponchard, décédé à Paris le 6 janvier, à l'âge de soixante-dix-neuf ans.
Interrompu seulement au mois de juin pendant le temps des vacances, le Voyaye en Chine reparut, le 20 octobre, avec sa distribution originelle, sauf Mlle Marie Roze, qui remplaçait Mlle Cico et fut elle-même remplacée, le 23, par Mlle Dupuy. Le souvenir de tous les artistes qui avaient concouru au succès de l’œuvre est d'ailleurs consigné dans le toast «poétique » que porta Prilleux dans le banquet offert par les auteurs à l'occasion de la centième représentation :
 |
La Célèbre Romance de Maître Pathelin, devenue rapidement un classique de la chanson, était encore au répertoire dans les années 1930-1940 : Tino Rossi l'a enregistrée en 1936 sur disque 78 tours Columbia B.F. 29 avec l'orchestre de Marcel Cariven
( couverture partition coll. DHM ) DR
 François Bazin, Romance extraite de l'opéra-comique Maître Pathelin (transcription pour violon et piano par Max Méreaux) François Bazin, Romance extraite de l'opéra-comique Maître Pathelin (transcription pour violon et piano par Max Méreaux)
Fichier audio par Max Méreaux (DR) |
Déjà plus de cent fois, à bord de la Pintade,
Nous avons cru voguer vers l'empire chinois ;
Plus de cent fois déjà, Sainte-Foy fut malade,
Et nous a jugés plus de cent fois.
Notre excellente camarade
Révilly répéta plus de cent fois déjà :
«Je n'avais jamais vu Auguste comme ça! »
Cico, Roze, Dupuy, trois charmantes Maries,
Ont été tour à tour, toutes trois, applaudies :
Et Couderc, puis Potel, chacun en vrai Breton,
Aux oui de Montaubry ripostèrent des non !...
Nous voilà tous rentrés sains et saufs dans le port;
Mais le repos sied mal à des âmes vaillantes,
Car de l'oisiveté les heures sont trop lentes,
Et je suis sûr que quelque jour
Nous nous retrouverons sur la plage à Cherbourg.
Oui, j'en conçois l’agréable présage,
Sur la Pintade encor, passagers, équipage,
S'embarqueront plus de cent fois.
En attendant, messieurs, je bois
A mes compagnons de voyage.
Les vœux du « poète » ne furent pas pleinement exaucés. L'ouvrage était «bien parti », malgré une indisposition de Montaubry, qui, pendant la seconde représentation, forçait d'interrompre le spectacle et de rendre l'argent, — un peu plus qu'on n'en avait reçu, comme il arrive toujours en pareil cas. Dès la quatrième, le Voyaye en Chine dépassait le chiffre de 2.000, et, les recettes se maintenant au beau fixe, on atteignait la centième le 9 décembre 1866, c'est-à-dire, presque jour pour jour, un an après. Mais à partir de ce moment, l’élan se ralentit ; en 1868 il s'arrêta brusquement. Une reprise organisée neuf ans après, en 1876, ne fournit que dix-sept soirées, et, après avoir obtenu 132 représentations à l'Opéra-Comique, l’œuvre de Bazin ne fut plus jouée qu'en province et au Château-d'Eau.
Cependant il serait injuste d'oublier que l'année 1856 finit à l'Opéra-Comique par le grand succès d'une petite pièce, Maître Pathelin, paroles de Leuven et Ferdinand Langlé, musique de Bazin (12 décembre). Tout le monde connaît la farce de Maître Pathelin, ce chef-d'œuvre de la scène française au moyen âge, et son adaptation pour la Comédie française par Brueys et Palaprat. Ce qu'on sait moins, c'est que l'aventure avait fourni déjà la matière d'un opéra-comique en deux actes, joué le 21 janvier 1792 au théâtre Montansier, l'Avocat Pathelin, paroles de Patrat, musique de Chartrain. L'ouvrage eut du succès, et pourtant ne fut pas imprimé ; peut-être les préoccupations politiques du moment contribuèrent-elles à cet oubli ; ce qu'il y a de certain, c'est que le souvenir en disparut à ce point que Fétis, dans sa Biographie, ne l'a pas mentionnée parmi les œuvres dramatiques de Chartrain, lequel cependant fut loin d'en écrire un grand nombre. Plus heureuse, la partition de Bazin fut jouée et gravée ; nul biographe ne l'oubliera, car elle compte parmi les plus gaies de son auteur, et elle se maintint pendant quatorze ans au répertoire de la salle Favart, où elle faillit même être reprise pour les débuts de M. Boyer, fournissant un total de 235 représentations. Maître Pathelin a reparu au théâtre du Château-d'Eau, mais, hélas! sans la distribution primitive; on n'avait retrouvé ni Couderc, qui dans le rôle de Pathelin atteignait la perfection, ni Berthelier, qui devait devenir un des plus célèbres comédiens de notre temps, et qui débutait alors sous les traits d'Aignelet, déjà plein de gaieté communicative, de verve malicieuse et de fantaisie originale.
Camille Le Senne
Président de l'Association de la critique dramatique et musicale
par Jules Combarieu (1919)
in Histoire de la musique des origines au début du XXe siècle
Tome III (Paris, Librairie Armand Colin, n°743, 1919)
François BAZIN, né à Marseille en 1816 (mort en 1878), est aussi un élève d'Halévy (et de Berton), grand prix de composition en 1840 : musicien correct et facile, trop dépourvu de verve dans les petits sujets qu'il a traités. Sa Cantate de concours, Loyse de Montfort, exécutée à l’Opéra avec Mme Stolz dans le rô1e de Loyse, fit pressentir en lui, non sans raison, un musicien de l’école d'Auber. Son meilleur ouvrage est Maître Pathelin (1856), condensation en un seul acte par de Leuven et Ferd. Langlé de la farce célèbre qui avait déjà été traduite pour la Comédie-Française.
On peut signaler, dans Maître Pathelin, comme heureusement écrits, les couplets de l’avocat, ceux du berger Aignelet, le duo de bé, bé, la marche comique accompagnant, à la fin de l’acte, l’entrée du tribunal. Le trompette de M. le prince (1846), un acte, de Mèlesville, dont la scène est à Etampes au temps de la Fronde, contient, avec des couplets de table, un quintette et un trio assez bons. Dans le Malheur d'être jolie (1847), un acte de Ch. Desnoyers, dont l’action se passe sous Charles VII, il y a de jolis couplets archaïques — Adieu vous dis, mes amours — avec une assez poétique intervention des cors à l'orchestre. Il y a aussi un solo de cor (acte III) dans la Nuit de Saint-Sylvestre (1849), et quelques jolies pages, comme le chœur des gardes de nuit à la fin du ler acte, et le duo du duel (II). Madelon, 2 actes (1852), n'eut pas plus de succès que les Désespérés, un acte de Leuven et Jules Moineaux (1859) sur ce canevas étrange : deux individus, un lord anglais attaqué par le spleen, un joueur de serpent qui vient de perdre sa place à l’église, sont désespérés et se pendent ; une jeune fille, en gaulant des noix, les ramène à la vie, et leur fait promettre de ne plus recommencer! Bazin fut plus heureux avec le Voyage en Chine, opéra-comique en 3 actes de Labiche et Delacour (1865) : vaudeville employant de faciles moyens de provoquer le rire (bégaiement d'un prétendant qui, pour se guérir, se met des cailloux dans la bouche, et les avale dans un accès d’émotion, entêtement d'un Breton, un notaire ridicule...) ; musiquette d'opéra-bouffe dont le type est la valse et le chœur du 2e acte, dans le salon du Casino de Cherbourg.
Jules Combarieu (1859-1916)
Musicologue, Docteur ès lettres
Édouard BATISTE (1820-1876)
 |
Édouard Batiste
( Archives de la Manufacture d'orgues Casavant Frères, Ltd, numérisation Agnes Armstrong, Altamont, New York, avec son aimable autorisation )
|

|

|
Eglise Saint-Nicolas-des Champs, Paris 3e arr., et son grand-orgue de tribune Clicquot (1777) - Gonzalez (1930),
58 jeux sur 5 claviers de 56 notes et pédalier de 32 notes, dans buffet XVIIe et XVIIIe siècles avec des parties plus anciennes datant de 1571.
in Saint-Nicolas-des-Champs, par l'Abbé Louis Le Rouzic, Editions Lescuyer, Lyon, 1948 (DR)
|
Oncle maternel de Léo Delibes qu’il guida et conseilla lors de ses premières années parisiennes, célèbre organiste et professeur d’harmonie renommé, Edouard Batiste, délaissé de nos jours, a principalement écrit une musique pour orgue dans un style symphonique très en vogue à l’époque, utilisant parfaitement toutes les ressources et possibilités de l’orgue " moderne ". Récitaliste très populaire, il savait orner ses programmes de transcriptions de marches de Schubert, Chopin, Mendelssohn et même de fragments de symphonies de Beethoven. Ses improvisations étaient également remarquables, même si d’aucuns estiment que le répertoire utilisé, à l’image d’un Lefébure-Wély, faisant appel à des pièces imitatives telles que des " tempêtes " ou des pastorales ", était très éloigné de la liturgie et du cadre sacré !
Antoine-Edouard Batiste est né à Paris le 28 mars 1820. C’est son père Jean Batiste, baryton et compositeur de la Chapelle impériale de Napoléon Ier, puis chanteur de grande renommée à l’Opéra-Comique qui lui enseigne les premiers éléments de musique. Sa sœur Clémence (1808-1886), de 12 ans son aînée, future mère du compositeur Léo Delibes, est également musicienne. Elle joue fort bien du piano et n’hésite pas à donner quelques leçons à son tout jeune frère. Dès l’âge de 8 ans en 1828 Edouard Batiste est admis au Conservatoire de Paris comme Page de la Chapelle royale. Devenu plus tard professeur dans ce même établissement il ne le quittera plus jusqu'à sa mort. Il y fait d’ailleurs d’excellentes études auprès de Leborne et Bienaimé (solfège), Le Couppey et Dourlen (harmonie et accompagnement), Benoist (orgue), Cherubini et Halévy (composition), qui lui valent de nombreuses récompenses : 1er prix de solfège en 1833, 1er prix d’harmonie et accompagnement en 1837, 1er prix de contrepoint et fugue en 1839, 1er prix d’orgue la même année, et enfin un 1er second Prix de Rome en 1840 avec la cantate Loyse de Monfort, écrite sur des paroles d’Emile Deschamps et Emilien Pacini.
Dès 1836, encore étudiant au Conservatoire, il est engagé comme professeur, tout d’abord accompagnateur des classes de chant et de déclamation lyrique, et professeur adjoint de solfège (1836), puis professeur titulaire à partir de 1839. A ce titre il enseigne plusieurs matières : classe de chœurs pour hommes (1839), de chant simultané (1850), de solfège collectif (1852) et enfin d’harmonie et accompagnement pour les femmes (1872). Edouard Batiste est l’auteur d’une nouvelle édition des Solfèges du Conservatoire par Chérubini, Catel, Méhul, Gossec, Langlé... (Paris, Heugel, 1865-1869, 10 volumes), ainsi que d’une autre édition, également annotée par lui, et intitulée Leçons sur toutes les clefs et à changement de clefs, édition populaire sans accompagnement (Paris, Heugel, s.d., 80 p.), et d’un Petit solfège harmonique, ou Traité d’harmonie élémentaire, (Paris, Heugel, s.d.). Ses travaux et publications sur l’enseignement lui valent plusieurs médailles et resteront longtemps aux programmes des conservatoires nationaux et autres écoles de musique. Encore de nos jours les Editions Musicales Alphonse Leduc proposent à la vente son Petit solfège mélodique, théorique et pratique, comprenant 100 leçons mélodiques et progressives sans accompagnement, dont 90 en clé de sol 2e, et 10 en clé de fa 4e (HE 3213), ainsi que ses Leçons de solfège sur toutes les clés et à changements des clés (HE 6266).
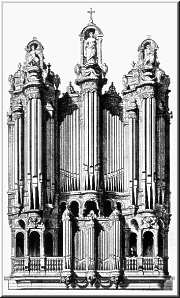 |
Eglise Saint-Eustache : grand orgue reconstruit en 1877-79 par Joseph Merklin, dans un buffet de Baltard daté de 1854
( dessin )
|
Parallèlement à ses activités pédagogiques, Edouard Batiste suit une brillante carrière d’organiste, tout d’abord à St-Nicoles-des-Champs, puis à St-Eustache. En 1842, il est en effet nommé à St-Nicolas, à la suite du départ de Paul Charreire pour la cathédrale St-Etienne de Limoges. Située rue St-Martin, en plein cœur de Paris dans le troisième arrondissement, cette église du XVe siècle bénéficie d’un grand orgue du facteur François-Henri Clicquot, installé en 1773 dans un buffet de 1571. Modifié par la suite par Dallery, Ducroquet et plus récemment (1930) par Victor Gonzalez, cet instrument est composé actuellement de 58 jeux, répartis sur 5 claviers de 56 notes et un pédalier de 32 notes.
Le 1er juillet 1854, Edouard Batiste quitte St-Nicolas pour St-Eustache, succédant là à Florimond Ronger, plus connu sous le nom de Hervé comme auteur d’opérettes frivoles! Il a d’ailleurs disputé cette place à César Franck , mais l’a emportée sans doute grâce à l’appui de l’Association des Artistes Musiciens du baron Taylor, dont il est membre. Cette institution, fondée en 1843 pour venir en aide aux musiciens et leur assurer une retraite minimum, organise de nombreux concerts dans la capitale qui attire un public important. L’église St-Eustache, également très ancienne (XVIe), est dotée alors d’un grand orgue qui vient tout juste d’être reconstruit par Ducroquet et inauguré le 1er mai 1854, à la suite de l’anéantissement dans l’incendie de 1844 de l’ancien orgue de l’abbaye Saint-Germain des Près remonté ici en 1802. A l’époque de Batiste, cet orgue de 68 jeux, répartis sur 4 claviers manuels et Pédale de 32 pieds, installé dans un buffet monumental dû à l’architecte Baltard, est considéré comme le meilleur spécimen de la facture d’orgue moderne et le plus bel instrument parisien. De nos jours, ce même buffet accueille à présent un orgue Van den Heuvel (1989) de 101 jeux (deux consoles de 5 claviers de 61 notes et un pédalier de 32 notes).
A peine installé à St-Eustache, Edouard Batiste assiste le 30 avril 1855 à un événement considérable qui déplace les foules et auquel il participe d’ailleurs aux claviers de son orgue, Listz, pressenti par Berlioz, ne pouvant se déplacer de Weimar et Saint-Saëns ayant décliné l’invitation : la première, audition dans cette église, du Te Deum de Berlioz. L’organisation de ce concert, prévu pour l’ouverture de l’Exposition Universelle, est gigantesque : plus de 900 exécutants, dont 600 voix d’enfants ; les journaux de Paris et de province en font une publicité énorme ; l’église est archi-comble ! Berlioz écrit le soir même à Liszt : C’était colossal, babylonien, ninivite... Pas une faute, pas une indécision..., et plus tard il précisera que le Judex crederis, le finale de son Te Deum, est sans aucun doute ce que j’ai produit de plus grandiose. Quelque temps plus tard, en 1862 à l'occasion de la fête de la translation des reliques de Saint Eustache, la " Société chorale du Conservatoire impérial de musique " que dirige Edouard Batiste, chante pour la première fois à l'église St-Eustache la Messe à 3 voix égales de François Bazin. Le succès de cette audition est si important que l'année suivante, le dimanche 2 août 1863 à dix heures, une seconde exécution est donnée dans cette même église, avec Batiste au grand orgue, et la participation de MM. Barbet, Fontange et Chevalier, qui chantent les solos, et de Louis Hurand, maître de chapelle de la paroisse, qui assure la direction.
Edouard Batiste restera titulaire du grand orgue de l'église St-Eustache jusqu'à sa mort arrivée le 9 novembre 1876 à Paris. C’est Henri Dallier, un autre lauréat du Prix de Rome, qui recueille sa succession.
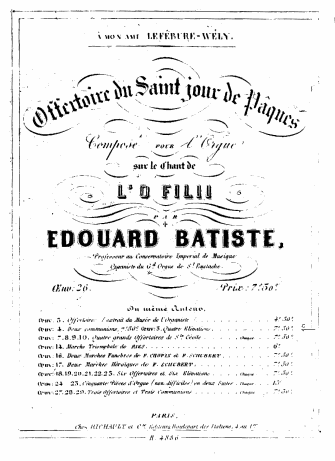 |
 |
Offertoire du Saint jour de Pâques, composé pour l'orgue sur le chant de l'O Filii, par Edouard Batiste et dédicacé « A mon Ami LEFEBURE-WELY »,
couverture et première page.
( Paris, Richault R 4886, vers1855, collection Alain Vernet )
|
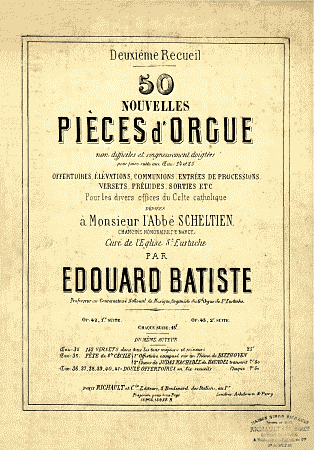 |
 |
Édouard Batiste,  Graduel pour orgue, extrait de 50 Nouvelles Pièces d'orgue non difficiles, Élévations, Communions, Entrées de Processions, Versets, Préludes, Sorties, etc, pour les divers offices du Culte catholique,dédiées à Monsieur l'Abbé Scheltien, chanoine honoraire de Nancy, Curé de l'Église St Eustache, Paris, Richault et Cie Éditeurs, s.d. [ca 1870] Graduel pour orgue, extrait de 50 Nouvelles Pièces d'orgue non difficiles, Élévations, Communions, Entrées de Processions, Versets, Préludes, Sorties, etc, pour les divers offices du Culte catholique,dédiées à Monsieur l'Abbé Scheltien, chanoine honoraire de Nancy, Curé de l'Église St Eustache, Paris, Richault et Cie Éditeurs, s.d. [ca 1870]
( coll. Max Méreaux. Fichier audio par Max Méreaux ) DR
|
On doit à Edouard Batiste un grand nombre d’œuvres pour orgue principalement publiées à Paris chez Richault, notamment une Communion en la majeur, op. 24 n° 2, un Offertoire-fantaisie-orage en ut mineur, op. 23 n° 6, un autre Offertoire du Saint Jour de Pâques (sur O Filii), op. 26... Sa musique d’orgue est en partie rééditée par les Editions Chanvrelin (Paris), sous le titre de " Pièces d’orgue ".
 |
Eglise Saint-Eustache (XVIe siècle).
(© cip, 1999 )
|
Ce recueil de 62 pages contient 9 pièces : Elévation (mi b majeur), 7 Offertoire (fa majeur, mi majeur, la mineur, mi b majeur, si mineur, la mineur, sol majeur) et une pièce sans titre (mi mineur). Pour le service religieux, il a également écrit des œuvres vocales bien oubliées de nos jours, parmi lesquelles un Ave Maria pour soprano, ténor ou basse, et un O Salutaris pour ténor ou soprano, tous deux édités dans les " Collections de la Maîtrise, publiées sous la direction et avec notes de MM. L. Niedermeyer et J. D’Ortigue " (Chant - Petite Maîtrise, 4e année), éditées à Paris, Au Ménestrel - Heugel et Cie. Le musicologue Pierre Guillot souligne que « la musique d'orgue d'Edouard Batiste offre, par son écriture essentiellement pianistique (gammes diatoniques et chromatiques montantes et descendantes, véloces, sur tout le clavier, octaves successives à l'une ou aux deux mains, arpèges très fréquents et vifs - voire incessants dans certaines pages - dans des tonalités peu aisées à l'orgue parce que les mouvements de mains ne sont pas aussi libres qu'au piano à cause du clavier supérieur [fa # majeur ou do # majeur par ex.], longs traits de pédalier, changements de claviers extrêmement rapides - l'Offertoire pour le jour de Pâques en est un bel exemple -) des difficultés importantes et nombreuses à vaincre (on est loin du "style lié" et statique propre à l'orgue et qui était alors pourtant prôné précisément pour freiner ce pianisme à l'orgue) qui peuvent décourager les organistes peu rompus à la technique pianistique, nonobstant la question esthétique qui est une autre affaire et non secondaire. »
Edouard Batiste, dont seule la musique d’orgue subsiste, a également composé des pièces pour piano et des mélodies. Il lui arrivait en effet souvent d’animer des soirées mondaines, très en vogue dans la haute bourgeoisie sous le Second Empire. Il n’était pas rare qu’il passât la nuit aux claviers de son piano, interprétant quelques romances et autres danses (Valses, Polkas, Mazurkas...)
Il est bien connu que nul n’est prophète dans son pays et l’œuvre pour orgue d’Edouard Batiste, si elle est quelque peu délaissée en France, est cependant toujours interprétée à l’étranger, notamment en Grande-Bretagne, en Italie et aux U .S.A. C’est ainsi que dernièrement l’organiste Willibald Guggenmos interprétait le 9 décembre 2000 à Sabato (Italie) ses Trois Elévations op. 5, lors du 3ème Festival International d’orgue ; que Riccardo Villani, organiste de Santa Maria del Rosario à Milan, jouait à Sabato également, le 1er septembre 2001, son Deuxième Offertoire; et que quelques jours plus tard, le 11 septembre, James Hammann, organiste, professeur d’orgue et d’histoire de la musique à l’Université de la Nouvelle-Orléans, donnait son Offertoire en la bémol, op. 23 n° 2, à la St.Michael’s Episcopal Church de Little Rock (Arkansas, U.S.A.).
La discographie d’Edouard Batiste est peu abondante et ne concerne que quelques pièces pour orgue. Mentionnons tout d’abord un enregistrement ancien chez Erato (33 tours) par Pierre Guillot, dans " L’orgue bourgeois sous le Second Empire : Lefébure-Wély, Batiste " : Offertoire de Ste-Cécile en ré majeur, op. 8 n° 2, Communion en la majeur, op. 24 n° 4, Elévation en la mineur, op. 19 n° 2, Offertoire en ut majeur, op. 24 n° 2, Offertoire-fantaisie-orage en ut mineur, op. 23 n° 6, Verset en ut majeur : musette op. 24 n°12. Ce même Offertoire-fantaisie-orage a été également enregistré en 1996 par Daniel Kern à l’orgue de la cathédrale de Tours (collection " La Route des Orgues ", Ligia Digital, Lidi 0104050-97). On trouve aussi deux CD de Christopher Herricks : l’un enregistré en 1992 à l’église St-Bartholomé de New-York, contenant notamment le Grand Offertoire en ré (Hypérion CDA66605, Organ Fireworks IV), l’autre enregistré en 1998 au Temple de Londres, avec l’Offertoire en sol majeur (Hypérion CDA67060, Organ Dreams 1), et un CD de l’organiste de la cathédrale Notre-Dame d’Anvers, Stanislas Deriemaeker, intitulé " Symphonic organ music from Belgium and France ", comportant, entre autres œuvres, l’Elévation en la bémol majeur, op. 23 (René Gailly International Production, CD 87 110).
Après avoir ajouté qu’Edouard Batiste était également membre (1873) de la " Commission pour l’examen de devis relatifs à la construction d’orgues d’églises " de la Ville de Paris, aux cotés de l’abbé Jourdan, vicaire général, Ballu et Bazin, membres de l’Institut, Davioud, inspecteur général d’architecture..., terminons cette esquisse biographique en rapportant ici les paroles prononcées par Ambroise Thomas, alors directeur du Conservatoire de Paris, lors du décès d’Edouard Batiste, publiées dans Le Journal de musique du 18 novembre 1876 :
Elève distingué de Cherubini et d’Halévy, il reste un des plus purs représentants de cette noble et grande école d’harmonie qu’on appelle aujourd’hui classique, par opposition à une certaine école de contre-point romantique, qui semble marcher au chaos et n’a plus guère d’harmonie que le nom. Batiste laisse des modèles parfaits d’harmonie élégante, riche et colorée, ingénieuse, mais toujours rigoureusement pure dans plusieurs de ses ouvrages, notamment dans la réalisation des basses chiffrées des solfèges d’Italie, un travail délicat qui demandait, avec la connaissance de la tradition des grands compositeurs italiens du siècle passé, la main assurée d’un maître.
Denis HAVARD DE LA MONTAGNE
Paru en 2004 : Édouard Batiste, 5 Pièces pour l'office et 2 grandes transcriptions de Beethoven (Allegretto de la 7° Symphonie et Final de la 9° Symphonie "Hymne à la joie"), par Yannick Merlin, préface de Pierre Guillot, Delatour France, DLT0480.
____________
1) On sait que Manet à la fin de sa vie, la maladie l'handicapant quelque peu pour réaliser de grandes oeuvres, se contentait de peindre des petites natures mortes ou des portraits au pastel des nombreuses femmes qui le visitaient. C'est ainsi qu'il immortalisa Emilie Ambre, mais également une autre comédienne Jeanne Marsy, des jeunes-filles du monde Suzette Lemaire et Isabelle Lemonnier, une commerçante de lingerie de luxe Mme Guillement, et deux femmes qui vivaient de leurs charmes : Irma Brunner et Valtesse de la Bigne.
[ Retour ]
2) Né le 31 août 1786 à Angers, mort le 9 avril 1889 à Paris, Chevreul fut directeur de la Manufacture des Gobelins de 1824 à 1883, membre de l'Académie des Sciences (1826), professeur de chimie au Muséum d'histoire naturelle à compter de 1829, puis nommé directeur en 1864. On lui doit notamment une théorie des couleurs, l'analyse des corps gras et l'invention des bougies stéariques.
[ Retour ]
1841
Aimé MAILLART (1817-1871)
 |
Aimé Maillart (1817-1871)
( photo Pierre Petit )
|
 |
1er couplet de l'air Ne parle pas, Rose, je t'en supplie..., extrait de l'opéra Les Dragons de Villars d'Aimé Maillart (1856). Ph. Maquet, éditeur à Paris.
( Coll. D.H.M. )
|
Louis-Aimé Maillart, né à Montpellier le 24 mars 1817, d’une famille de comédiens, a fait toutes ses études au Conservatoire de Paris à partir de 1833, dans les classes de Leborne, Halévy, Elwart, Reicha et Guérin pour le violon. Premier prix, avec Deldevez, de contrepoint et de fugue en 1838, puis Premier Grand Prix de Rome en 1841 pour sa cantate Lionel Foscari, il connut le succès le 15 novembre 1847 avec la création à l’Opéra de son opéra en trois actes Gastibelza ou le Fou de Tolède. Puis vinrent d’autres succès avec Le Moulin des tilleuls, en un acte, donné à l’Opéra-Comique, le 9 novembre 1849, La Croix de Marie, en trois actes, jouée dans le même théâtre en 1852 et surtout l’opéra Les Dragons de Villars, en trois actes, sur des paroles de Lockroy et Cormon (Théâtre Lyrique, 19 septembre 1856) qui fut son plus grand succès lyrique et fit longtemps partie du répertoire des théâtres français. Cette œuvre fut programmée en Belgique, Espagne, Allemagne, Angleterre et même en Pologne. Plusieurs mélodies charmantes de cet opéra sont restées longtemps dans toutes les mémoires : Espoir charmant; Ne parle pas, Rose; Oui, c’est moi qu’il a choisie... Les Pêcheurs de Catane, drame lyrique en trois actes, écrit sur un livret de MM. Cormon et Carré, donné en première audition au Théâtre-Lyrique le 14 décembre 1850, au cours de laquelle Melle Baretti et M. Peschard firent leurs débuts, et l'opéra Lara, en trois actes (1864), furent également bien accueillis par le public et la critique. On lui doit aussi plusieurs cantates et des œuvres sacrées.
Décoré de la légion d’Honneur en août 1860, fuyant Paris devant l’invasion allemande, Aimé Maillart est mort à Moulins (Allier), le 26 mai 1871.
Louis Bethléem dans son livre " Les opéras, les opéras-comiques et les opérettes "1 dit qu’Aimé Maillart " maladif et dépourvu d’ambition... travaillait peu. Inégal et fougueux, mais dramatique et inspiré, il avait quelques analogies avec Verdi. Ses élans de passion intense, ses sursauts un peu désordonnés et un profond sentiment mélodique, semblaient pourtant l’appeler à la scène lyrique. "
Denis HAVARD DE LA MONTAGNE
 |
Signature autographe (1865) DR
|
 Aimé Maillart, Romance extraite de l'opéra-comique en 3 actes Les Dragons de Villars (Paris, Brandus & Cie, 1877/coll. Bnf-Gallica) DR.
Aimé Maillart, Romance extraite de l'opéra-comique en 3 actes Les Dragons de Villars (Paris, Brandus & Cie, 1877/coll. Bnf-Gallica) DR.
Fichier audio par Max Méreaux (DR.)
Partition au format PDF
___________________________
1) Paris, Editions de la « Revue des lectures », 1926. [ Retour ]
 |
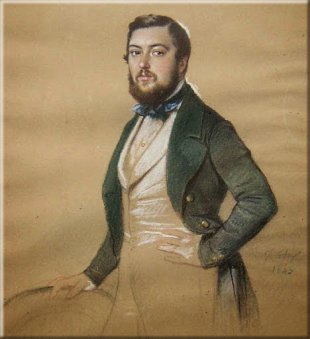 |
Benoit Mozin, portrait par Leprince, 1823
( coll. famille Piet )
|
Théodore Mozin peint en 1843 par Antoine Etex (1808-1888)
( coll. famille Piet )
|
Théodore MOZIN (1818-1850)
La
courte vie de ce musicien ne lui a pas laissé le temps de
marquer de son empreinte la musique française de cette
première moitié du dix-neuvième siècle en
pleine période romantique. 1818 : Victor Hugo termine ses
études au lycée Louis-le-Grand, Beethoven achève
sa Sonate pour le piano-forte op.
106 et Lamartine termine sa tragédie Saül ;
1850 voit paraître l’édition originale des
Mémoires d’outre-tombe
de Chateaubriand, mourir Balzac le
19 août et Berlioz composer La
Menace des Francs, pour
double-choeur et orchestre... On sait peu de choses sur Mozin, les
archives sont avares de renseignements à son sujet !
Heureusement ses traits ont été à tout jamais
fixés sur une estampe réalisée peu de temps
avant sa mort et conservée dans le fonds du Conservatoire.
Voici cependant des détails qui permettront de mieux situer le
personnage dans le contexte de l’époque.
Né à
Paris (9e ancien) le 25 janvier 1818, Désiré Théodore
Mozin bénéficia dès sa plus tendre enfance de
l’enseignement de son père Benoît, membre de la
Société Académique des Enfants d'Apollon, qui,
après avoir effectué des études musicales sous
la direction de Gossec jusqu’en 1787, se livrait à Paris
à l’enseignement du piano pour lequel il composa bon
nombre de pages. Celui-ci, dit « Mozin jeune »
(Paris, 21 mars 1769 – Sèvres, 1er décembre 1857)
avait autrefois professé le piano au Conservatoire de Paris
dès son ouverture en 1795 jusqu'en 1802, avant de se livrer à
l’enseignement privé. On raconte à son propos
que, passionné par le jeu, Mozin jeune « gagnait
beaucoup d’argent par ses leçons [...] et dissipait en
un instant à la roulette ce qu’il avait amassé
par son travail, puis recommençait de nouvelles économies
pour les soumettre aux mêmes chances du hasard ! »
(Fétis). Son oncle, André-Pierre Mozin, également
musicien de métier, avait aussi enseigné le piano au
Conservatoire de Paris, de 1795 à 1800.
Théodore
Mozin alla parfaire son éducation musicale au Conservatoire de
Paris à l’époque où Charles Gounod, né
la même année que lui (17 juin), le fréquentait
également : Halévy y enseignait le contrepoint,
Paër et Lesueur la composition. Premier prix d’harmonie et
accompagnement en 1836 (classe de Dourlen), de piano en 1837 (classe
de Zimmerman), de contrepoint et fugue en 1839, il avait également
obtenu cette même année 2ème
prix d’orgue dans la classe de Benoist. En 1841, après
avoir suivi les classes d’Halévy et de Berton, Mozin se
présenta au Concours de composition musicale de l’Institut
et décrochait un second Premier Grand Prix. Le sujet imposé
cette année était Lionel
Foscari, un poème du marquis
de Pastoret.
Le
27 février 1837 Mozin était nommé professeur
adjoint d’étude du clavier au Conservatoire de Paris,
tout en y poursuivant ses études. Le 1er
octobre 1848, Cherubini, alors directeur de cet établissement,
le nommait professeur de solfège. Mozin habitait à
cette époque au numéro 15 de la rue de la
Grange-Batelière,
dans le neuvième arrondissement, là même où
était casernée en 1775 la compagnie-colonelle des
Gardes suisses. Peu de temps après, le 16 novembre 1850,
Théodore Mozin s’éteignait en son domicile
parisien, tout juste âgé de 32 ans et laissant une
veuve, Marie-Rose Fossé, originaire d'Allonville (Somme) et
épousée le 18 février 1843 à Paris (12e
ancien), qui lui survivra près d’un demi-siècle
jusqu’au 12 juillet 1895! Quant à son père,
Benoît Mozin, il lui survivra encore durant 7 ans, avant de
s'éteindre à l'âge de 88 ans.
Selon
Fétis, on doit à cet artiste de nombreuses pages pour
le piano, parmi lesquelles Variations
brillantes sur un thème original
op. 2 (Lemoine), Premier Prélude
op. 10 (Lemoine), Six Fantaisies sur
« la Sirène »
op. 11 (Brandus.), Valses élégantes
et brillantes op. 15 (Lemoine),
Etudes spéciales
op. 16 (Lemoine), Etudes de salon
op. 17 (Lemoine).
Théodore
Mozin était le frère du peintre paysagiste Charles
Mozin (1806-1862), auquel on doit notamment Le
Boulevard des Italiens qui nous
donne la physionomie exacte de Paris au lendemain de la Restauration,
ainsi que plusieurs autres toiles immortalisant à partir de
1825 le port de Trouville-sur-Mer. Le petit-fils de ce dernier,
Charles Théodore Malherbe (1853-1911), fit à son tour
une carrière musicale : compositeur, rédacteur en
chef du « Ménestrel » et bibliothécaire
de l’Opéra de Paris (1899-1911).
Notre lauréat
du Prix de Rome n'a pas laissé de descendance, ayant eu le
malheur de perdre ses deux fils dans leur plus jeune âge :
tous deux prénommés Charles, nés en 1848 et en
1850, ils décédèrent le premier à l'âge
de 14 mois en 1849, le second à 7 mois, en 1851.
Denis
Havard de la Montagne
(2004-2014)
Alexis de GARAUDÉ (fils, 1821-1854)
Brillant premier prix du Conservatoire de Paris à l’âge de 11 ans, lauréat du Prix de Rome de composition musicale à 18 ans, accompagnateur à la Société des Concerts du Conservatoire et à l’Opéra-Comique, organiste, compositeur, Alexis de Garaudé, dont Fétis disait qu’il " possédait un des plus beaux talents qu’on ait connu pour l’accompagnement ", n’a cependant pas eu le temps d’écrire de grandes œuvres la mort l’ayant ravi à l’âge de 32 ans. Curieusement d’ailleurs, les deux Second Grand Prix de Rome de l’année 1841, Théodore Mozin et Alexis de Garaudé moururent tous deux prématurément au même âge ! Cependant, le nom de Garaudé est encore largement connu de nos jours par les élèves de musique, notamment par son Solfège des enfants à une voix qui figure toujours dans les catalogues des éditions Leduc (AL 14281) et Billaudot (GB 5609), mais l’auteur de cet opus 27 est son père.
 |
Alexis de Garaudé père (1779-1852), auteur de nombreux solfèges fort connus
( portrait par Pierre Roch Vigneron, BNF Richelieu )
|
Prénommé également Alexis, il arrive souvent que les deux soient confondus, quoique la carrière artistique du père fut beaucoup plus longue, celui-ci étant décédé à l’âge de 73 ans. Choron et Fayolle, dans leur " Dictionnaire historique des musiciens, artistes et amateurs, morts ou vivans [sic] qui se sont illustrés en une partie quelconque de la musique et des arts qui y sont relatifs " (Paris, 1810), nous apprennent qu’Alexis Garaudé père, né le 21 février 1779 à Nancy, où son père remplissait une charge au Parlement, s’était vu contraint " par la suite de la révolution, de tirer parti d’un art qui n’était entré dans son éducation que comme objet d’agrément. " C’est ainsi qu’il vint à Paris, entra au Conservatoire qui venait d’ouvrir ses portes et prit des leçons de chant auprès de Crescentini et de Garat, et d’harmonie auprès de Cambini et de Reicha. Il fit parti, en qualité de chanteur, du personnel de la Chapelle impériale puis royale (1808-1830) et enseigna au Conservatoire de Paris la vocalisation à partir de 1816 et le chant en 1835 avant de prendre sa retraite le 1er avril 1839. Il est l’auteur de pages pour piano, de musique de chambre, de nombreuses mélodies (près de 200 publiées par ses soins ou par Imbault à Paris), de pièces religieuses, dont une Messe solennelle à 3 voix, d’un opéra La Lyre enchantée et surtout d’un grand nombre d’ouvrages pédagogiques, dont certains sont encore utilisés de nos jours. Parmi ceux-ci, on relève une Méthode de chant (Paris, l’Auteur, 1809) totalement refondue et augmentée par la suite (1825), une Petite Méthode de chant dédiée aux Dames. A l’usage de la Maison royale établie à St Denis pour l’éducation des filles des membres de la Légion d’honneur (Paris, Au bureau du Journal d’Euterpe, s.d. [ca 1820]), Soixante solfèges progressifs à deux voix égales, avec accompagnement de piano ou harpe, ou nouveau cours de lecture musicale précédé de principes de musique par demandes et réponses (Paris, chez l’Auteur, rue Vivienne, rotonde Colbert, escalier E, 25 décembre 1831), L’Harmonie rendue facile ou théorie pratique de cette science (Paris, l’Auteur, 1835), une Méthode complète de piano (Paris, l’Auteur, 1840). Peu de temps avant sa mort, arrivée à Paris le 23 mars 1852, il avait effectué un voyage en Espagne qui lui inspira un ouvrage intitulé L’Espagne en 1851, ou impression de voyage d’un touriste dans les diverses provinces de ce royaume (Paris, E. Dentu, 1852, in-8°, 256 pages).
Parmi ses nombreux élèves que Garaudé père forma au Conservatoire de Paris et dans son Ecole de chant français et italien de la rue des Petits-Champs puis de la rue de Marivaux,se trouve une demoiselle Clotilde Colombelle qu’il dirigea durant 7 ans. Née à Paris le 26 mars 1804, elle entra au Conservatoire de cette ville où elle obtint un 1er prix de solfège en 1818 et un 2e prix de chant l’année suivante. Elle débuta ensuite, avec succès, une carrière en Italie sous le nom de Mlle Coreldi, au Théâtre Saint-Charles de Naples puis à la Scala de Milan où elle fut engagée comme prima donna, mais elle mourut à Milan dans sa vingt-deuxième année le 5 février 1826. Dans une lettre du 10 mai 1831, son professeur de chant écrivait :
 |
Cours de chant dans une classe d'école sous la Restauration. Dessin ornant la couverture d'un ouvrage de solfège de Garaudé père intitulé : Enseignement mutuel et populaire de la musique dans les classes nombreuses des collèges, écoles primaires, normales et communales, pensionnats, &a, contenant 285 solfèges à 1,2 ou 3 voix, et 50 choeurs à 2,3 ou 4 voix, dont 42 choeurs (Paroles et Musique d'Alexis de Garaudé) et 8 choeurs d'Église pour Messes, Saluts et Messes de Requiem, par Alexis de Garaudé, Membre des Conservatoires de France et d'Italie et de plusieurs Académies Royales des Sciences et Belles-Lettres, &a.
( s.d. [ca 1820], BNF Richelieu )
|
" ...c’est en 1817 (elle avait alors 14 ans) que j’ai commencé à poser sa voix et à la développer avec les plus grands ménagements par tous les exercices préparatoires de l’école de Crescentini, dont je m’honore d’avoir suivi les conseils. L’étude de beaucoup de cantabiles expressifs, genre dans lequel elle excellait particulièrement, a précédé celle qui fait acquérir l’agilité. Je lui ai enseigné progressivement les principaux airs et duos du répertoire français et italien, ainsi que ses rôles, en Italie, où elle n’a cessé de recevoir mes conseils que lors de la maladie qui la fit périr à vingt-deux ans, en 1826, en excitant les plus vifs regrets des Milanais, qui lui firent des funérailles d’une pompe extraordinaire. J’ajouterai qu’elle débuta au théâtre San Carlo, à Naples, deux mois après son départ de Paris, par le rôle de Cenerentola, qu’elle n’avait jamais étudié, et qu’elle joua ainsi à l’improviste avec le plus éclatant succès. D’ailleurs Naples manquait alors de maîtres de chant, même du troisième ordre, et il est plus que notoire que j’ai seul dirigé sa carrière théâtrale, qui fut, hélas ! trop courte pour sa fortune et pour ma réputation ! "
Alexis de Garaudé père non seulement mena au succès sa jeune et brillante élève, disparue si précocement, mais fut également le père naturel de ses deux fils. Le puîné, Charles Gabriel Sylvestre Colombelle, naquit à Paris le 6 janvier 1823. Entré au Conservatoire, il obtint un 1er prix de solfège en 1836 à l’âge de 13 ans, mais sa destinée nous est inconnue. L’aîné, Alexis Albert Gauthier Colombelle, né à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) le 27 octobre 1821, se fera appeler du nom de son père. Il effectuera plus tard, le 21 décembre 1844, une demande de changement de nom afin de porter officiellement le patronyme de " de Garaudé ". Tout comme sa mère, il eut un destin tragique.
Alexis de Garaudé fils reçut ses premières leçons de musique de la part de ses père et mère, puis entra au Conservatoire de Paris en avril 1829. Il n’avait pas encore atteint ses 8 ans. Il fit dans cet établissement, où son père enseignait, de longues études musicales durant 12 ans, couronnées par les 1er prix de solfège (1833) dans la classe d’Alexandre Goblin, de contrepoint et fugue (1837) dans la classe de Fétis, et d’orgue (1838) dans la classe de François Benoist. Elève de Fromental Halévy pour la composition, il remporta en 1840 une mention honorable au Concours de Rome avec la cantate Loyse de Montfort sur un poème d’Emile Deschamps, et en 1841 un deuxième Second Grand Prix avec la cantate Lionel Foscari sur un poème du Marquis de Pastoret. Cette même année, en compagnie d’autres organistes les plus en vue de Paris (Léfébure-Wély, Fessy, Séjan, Boély, Miné...), il est désigné par la Commission de réception du grand orgue de 32 pieds construit par MM. Cavaillé-Coll père et fils dans l’église royale de Saint-Denis, pour visiter l’instrument et le faire entendre les 21 et 23 septembre. Accompagnateur à l’Opéra-Comique et à la Société des Concerts du Conservatoire où il avait été admis comme sociétaire le 20 mai 1849, il mourut à Paris, le 6 août 1854 à l’âge de 32 ans. Habile musicien, on lui doit quelques pièces pour piano et surtout des transcriptions d’oeuvres d’Halévy et de Meyerbeer, notamment de ce dernier La Marche du sacre du Prophète, arrangée pour piano par A. de Garaudé (Paris, Brandus, s.d.).
Denis Havard de la Montagne
1842
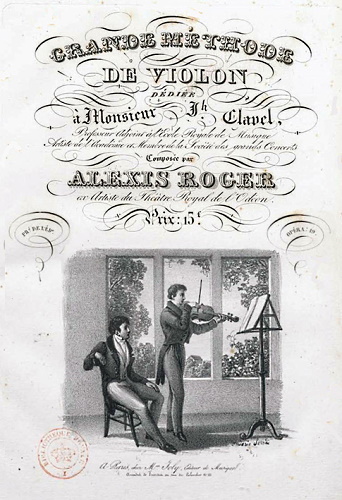 |
Alexis Roger, Polonaise du 2e Duo extrait de la Grande Méthode de violon "dédiée à Monsieur Joseph Clavel, professeur adjoint à l'Ecole Royale de Musique, artiste de l'Académie et membre de la Société des Grands Concerts, composée par Alexis Roger, ex artiste du Théâtre royal de l'Odéon"
Partition au format PDF.
(Paris, 1830, chez Mme Joly, éditeur de musique, arcades de l'Institut ou 21 rue du Colombier/coll. BnF-Gallica) DR.
 Fichier audio par Max Méreaux, avec correction de fautes de gravure dans la partition : à la première mesure du 2e système de la 3e page (p.80), au premier violon, le fa avant dernière note est un fa bécarre ; à la dernière page, (p 81) dans les 3 dernières mesures du 2e système et dans la première mesure du 3e système, au second violon, tous les si sont des si bécarres (DR.) Fichier audio par Max Méreaux, avec correction de fautes de gravure dans la partition : à la première mesure du 2e système de la 3e page (p.80), au premier violon, le fa avant dernière note est un fa bécarre ; à la dernière page, (p 81) dans les 3 dernières mesures du 2e système et dans la première mesure du 3e système, au second violon, tous les si sont des si bécarres (DR.)
|
Alexis ROGER (1814-1846)
Voilà encore un artiste emporté par la maladie à l’âge de 32 ans, dont la destinée qui s’annonçait brillante a été brutalement interrompue. Ses ouvrages sont inconnus et son nom même est ignoré des biographes! Seul Fétis dans sa Biographie universelle des musiciens, écrite à partir de 1837 et rééditée par la suite, nous livre quelques détails empêchant ainsi ce Premier Grand Prix de Rome de composition musicale de rejoindre à tout jamais la cohorte des anonymes. Lors de sa mort prématurée, Raoul Rochette, Secrétaire perpétuel de l’Académie des Beaux-Arts, après avoir souligné les qualités artistiques du musicien, s’exprimait en ces termes : " L’Ecole de Rome a perdu M. Roger, qui était arrivé à la quatrième année de sa pension, et qu’une maladie de poitrine a conduit lentement au tombeau, malgré les soins de sa famille, qui du moins l’ont entouré dans ses derniers moment. "
Originaire de la Mayenne, où il était né le 11 juin 1814 à Château-Gontier, on peut croire qu’Alexis-André Roger subit dans cette ville l’heureuse influence de Jules Parisot. Organiste de l’église St-Jean à partir de 1821, et maître de musique du collège, celui-ci créa en effet à Mayenne un important foyer musical duquel sortirent de bons élèves. Quoi qu’il en soit son niveau était suffisamment élevé pour être admis dès l’âge de 14 ans au Conservatoire national supérieur de musique de Paris en août 1828. Il intégrait la classe d’harmonie de Dourlen, avant de rejoindre celle de contrepoint de Reicha (1830), ainsi que celle de piano de Zimmermann (1831) et d’orgue de Benoist (1831). Ses camarades avaient pour noms Marmontel, Boieldieu fils, Macé, Danjou, Alkan aîné... Un second prix d’accompagnement lui fut décerné en 1832 et un second prix de fugue en 1834. Elève de composition de Lesueur, puis de Paër, il se présentait au Concours de Rome en 1838 mais le sujet imposé, La Vendetta, sur une poésie du comte de Pastoret, ne lui porta pas chance et il n’obtenait cette année-là qu’une mention honorable. Sa santé précaire le retarda dans ses études qu’il dut parfois même interrompre quelque temps. Devenu l’élève de Lesueur, Paër étant décédé en 1839, Alexis Roger se présentait à nouveau au Concours de l’Institut en 1842 et remportait cette fois-ci le Grand Prix, devant Victor Massé, avec sa cantate La Reine flore. Il partit alors pour la Villa Médicis où il arriva le 2 janvier 1843. A cette époque le voyage en diligence prenait plusieurs jours mais permettait aux nouveaux pensionnaires de découvrir avant leur arrivée dans la Ville éternelle de nombreux sites propices à la méditation artistique. Ils empruntaient généralement l’itinéraire suivant : Paris, Lyon, Avignon, Arles, Marseille, Monaco, Gênes, Pise, Sienne, Rome... Tout comme les autres pensionnaires du Gouvernement, il séjournait ensuite à Vienne puis en Allemagne, à l’issue de ses deux années passées à la Villa Médicis et alors qu’il achevait ce long périple de quatre années passées loin de chez lui, Atropos le prit. C’était en 1846, on donnait cette année là en première audition à la Salle Favart La Damnation de Faust sous la direction de Berlioz lui-même.
Si comme nous l’avons dit précédemment les ouvrages d’Alexis Roger sont méconnus et probablement conservés dans quelque bibliothèque poussiéreuse, on sait cependant qu’il est l’auteur d’une Grande méthode de violon publiée en 1830 à Paris, chez la veuve Joly, éditeur de musique, 23 Quai Conti.
Denis HAVARD DE LA MONTAGNE
Eugène GAUTIER (1822-1878)

|
Eugène Gautier, vers 1870
(coll. BnF-Gallica) DR.
|
 Eugène Gautier, La Clé d'or, comédie lyrique, transcription pour piano par Henri Carré (Paris, G. Hartmann, 1877 ; coll. BnF-Gallica) Eugène Gautier, La Clé d'or, comédie lyrique, transcription pour piano par Henri Carré (Paris, G. Hartmann, 1877 ; coll. BnF-Gallica)
Fichier audio par Max Méreaux (DR.)
Partition au format PDF
|
|
Annales du Théâtre et de la Musique (1878)
GAUTIER (Jean-François-Eugène), compositeur
français, né à Paris en 1822,
mort à Paris, le 1er avril 1878. Après avoir remporté le premier prix de
violon au Conservatoire, Eugène Gautier étudia la composition avec Halévy, mais
n'obtint, au concours de l'Institut, en 1842, qu'une seconde nomination. Il
renonça, dès lors, à poursuivre plus longtemps la chimère du prix de Rome et à
conquérir un titre qui, pas plus à cette époque qu'aujourd'hui, ne créait un
privilège au profit du lauréat. Mais, dévoré d'activité, son instrument d'une
main, sa plume de l'autre, il se jeta hardiment dans la mêlée, où il devait
rencontrer plus de déboires que de réelles satisfactions. Tour à tour premier
violon à l'Opéra-Comique et à l'Opéra, chef d'orchestre à l'Opéra-National, qu’Adolphe
Adam venait de fonder, il consacra, dès ce moment, les loisirs que lui
laissaient ces fonctions à écrire des opéras, dont quelques-uns ont réussi,
mais qui ne sauveront pas pour cela de l'oubli le nom de leur auteur. Son
premier ouvrage, écrit en collaboration avec Laurencin et Cormon comme
librettistes, fut donné à Versailles en 1845. Nous n'en connaissons que le
titre il l’Anneau de Mariette. Associé à un compositeur populaire,
Pilati, il improvisa un opéra de circonstance, les Barricades de 1848,
pour le Théâtre-Lyrique qui voulait lutter d'actualité avec les autres scènes
parisiennes pour célébrer la révolution de février. Il ne nous est rien resté
de la musique, dont le compositeur a dû se servir pour les ouvrages qu'il a
donnés depuis. Parmi ces derniers, nous citerons Choisy-le-Roi, Flore
et Zéphyr, Jocrisse, Murdoc le Bandit,
Schahabaham II qui n'eurent qu'un faible
retentissement et attirèrent peu l'attention du public et de la critique. Son
véritable succès date du Mariage extravagant, représenté à l'Opéra-Comique le 20 juin 1857, dont la musique prétentieuse n'en porte pas moins la marque d'études fortes et
consciencieuses, et qui n'a cessé depuis lors de faire partie du
répertoire de la province. Mais jusqu'à présent, Gautier n'avait donné au
théâtre que des ouvrages en deux actes au plus. Son amitié avec Roqueplan
l'avait récemment improvisé journaliste. Dans ses feuilletons de musique, il se
plaignit amèrement d'être délaissé, et ne vit pas sans envie les succès de ses
jeunes confrères. Il brûlait du désir de se mesurer dans un cadre plus large et
de donner enfin la mesure de ce qu'il pouvait faire. Octave Feuillet lui
fournit cette occasion en écrivant pour lui et sur sa sollicitation le livret
de la Clé d'or, dont le sujet ne comportant que l'étude psychologique
d'un cas particulier, n'offrait au
musicien que des situations assez vagues et mal définies. Gautier n'en jugeait
pourtant pas ainsi mais, rêvant depuis quelque temps une révolution musicale,
dont le but, pour son esprit obscur, résidait plus dans les mots que dans les
idées, il croyait avoir trouvé le sujet à l'aide duquel il allait pouvoir du
même coup exposer et développer ses théories confuses.
Nous n'avons pas besoin de rappeler
l'accueil glacial fait par le public à cet ouvrage, qui avait attendu dix ans
avant de pouvoir être représenté. Ces événements sont encore trop près de nous.
Il n'en est pas moins vrai que ce fut un coup terrible pour le compositeur et
qui empoisonna ses derniers jours. Il contracta de cet insuccès une sorte d'amertume qui ne contribua pas peu à assombrir ses
idées souffrant depuis longtemps d'une maladie nerveuse à laquelle il devait
succomber, le mal ne fit que s'accroitre, et il est mort ces jours derniers,
emportant sans doute avec lui l'idée qu'il n'était qu'une victime de
l'injustice des hommes. Ce n'est pourtant pas que Gautier ait manqué de talent.
Son œuvre, relativement restreinte, accuse un travail suivi, des études
consciencieuses mais sa pensée se dégage lente et pénible de tout ce qu'il
écrit. Sa phrase est indécise et son style est sans originalité et sans charme.
Dans les quelques ouvrages dont nous rappelons plus haut les titres, il a fait
preuve de qualités plus ingénieuses que hardies il s'est plus inspiré d'autrui
que de lui-même, et, en cherchant à s'approprier les traditions des maîtres, il
a marché toute sa vie à leur remorque sans parvenir à se créer un caractère
propre. Sincèrement épris des grandes choses, aimant passionnément son art, ce
qui a manqué à cet artiste pour que sa personnalité se dégageât de la
médiocrité où elle a constamment végété, c'est le souffle, c'est l'émotion,
c'est l'inspiration surtout, c'est enfin ce qui ne s'apprend sur les bancs
d'aucune école et que le travail le plus acharné ne saurait procurer. Gautier
laisse, dit-on, une Histoire générale de la musique que la mort ne lui a
pas donné le temps d'achever. Nous ignorons ce que peut être cet ouvrage mais
nous doutons qu'il soit possible d'y trouver un enseignement utile et des
aperçus nouveaux sur l'art. Comme critique musical au Journal officiel, comme
professeur d'histoire musicale au Conservatoire, chaire qui avait été créée
exprès pour lui il y a quelques années, Gautier a toujours envisagé les choses
et les hommes par leurs petits côtés. Il a dû faire de même pour l'histoire.
Edouard Noël et Edmond
Stoulig
|
|
Le Constitutionnel (édition du lundi 15 avril 1878)
journal politique, littéraire et
universel
« En 1822, quand je
naquis, la France était tranquille, mais triste comme un officier à la
demi-solde. » Ainsi, débutent les Souvenirs de M. Robert [Maître de musique,
1795], charmant récit publié,
en 1873, par Eugène Gautier, dans les colonnes du Figaro [éditions des 12 au 15
août 1873].
Lorsqu'il fut question,
en 1828, de choisir un état au futur, auteur, du Mariage extravagant et
du Docteur Mirobolan, sa mère, dont la mémoire était encore hantée par
la sanglante épopée de l'empire, et qui se souvenait aussi au privilège,
accordé aux lauréats de l'Institut, de ne point partir pour la guerre, déclara,
un beau jour, à son mari étonné, qu'elle voulait faire de leur fils, un
musicien. Fit-elle bien ? Fit-elle mal ? se demande Eugène Gautier. La pauvre
âme ! Ce n'est pas à moi de répondre. Quoi qu'il en soit poursuit-il, que son
nom soit béni ! C’est elle qui m'apprit, avec ma croix de Dieu, le respect de
moi-même et l'amour, du labeur, quotidien, et aussi que c’est seulement en
travaillant plus que les autres qu'il est permis de tâcher d'arriver parmi les
premiers de sa classe.
La chose une fois
décidée, Mme Gautier demanda, dans le quartier de l'Ecole de Médecine, l'adresse
d'un bon professeur. Cette adresse lui fut ainsi donnée : M. Robert, professeur
de musique, rue Dauphine, maison des Messageries. Le lendemain, « frisé comme
un Jésus et revêtu d'une veste et d'un pantalon de drap olive, costume dans
lequel la pureté des lignes et la grâce des contours avaient été sacrifiées à
la prescience d'une croissance rapide », Eugène Gautier, accompagné de sa mère,
escaladait les cinq étages de l'humble maestro qui allait lui donner les
premiers préceptes de l'art d'Orphée et de Meyerbeer. Il avait alors huit ans. Trois
ans après, M. Robert présentait son élève au Conservatoire.
Je jouai dans cette
mémorable circonstance, continue Gautier, un morceau de Kreutzer et l'Orage
de Steibelt. Le style suranné de mon exécution produisit sur le comité des
études un effet de stupeur, que M. Robert prit pour le comble de la
satisfaction. L'examen fini, Cherubini éleva, la voix : chi è, dit-il dans
son italien mâtiné de français, il maestro di cè joune homme ?
M. Robert se leva
— C'est moi, dit-il, avec
une révérence et un sourire.
Zé né vi en fais pas
monne coumplimente, reprit rudement Cherubini.
Et le maître et l'élève
se retirèrent l’un suivant l'autre.
Un professeur, à la
fois plus expérimenté et plus jeune, fut donné à Eugène Gautier qui, l’année
suivante, obtint premier prix de solfège et entra dans la-classe d'Habeneck. Il
y remporta, en 1836, le second prix de violon et, en 1838, le premier. Il fut
alors reçu dans la classe d'Halévy, et, moins heureux dans le concours pour le
prix de Rome qu'il ne l'avait été dans le concours instrumental, une maladie
l'empêcha, en 1843, de couronner peut-être par un premier prix le vaillant
effort qui, en 1842, lui avait déjà fait atteindre le second prix. Il dut
renoncer à la lutte. Sa composition était pourtant si avancée et d'un tel
mérite qu'Aubert lui fit espérer qu'on l’exécuterait a la solennité des prix. Nouveau
mécompte ! Sa composition ne fut point exécutée.
Ainsi commençait pour
lui cette rude bataille où il conquit un nom, mais où il devait périr à 56 ans.
D'abord il fallait vivre. Habeneck, dont il avait gagné l'estime et
l'affection, l'attacha comme second violon à l'orchestre de l'Opéra. Plus tard,
Eugène Gautier y obtint un premier pupitre et fut admis, aussi, comme premier
violon à la Société des concerts du Conservatoire. Organiste vers 1845, à
l'église Saint-Louis-d'Antin, il devint, en 1857, maître de chapelle à l'église
Saint-Eugène, qu'il parvint à élever au rang des premières maîtrises, et qui a
cru devoir acquitter sa dette de reconnaissance en lui faisant de belles funérailles.
C'est ici que se place
un des plus amers épisodes de sa-vie. Nous ne ferons, qu'y glisser ; mais, pour
nous qui le connaissions alors et qui, depuis, ne l'avons point quitté, cet
épisode, qui pouvait devenir l'événement capital de son existence, y a toutefois
joué un tel rôle, quelque restreint que les circonstances l'aient fait, qu'il
nous est impossible de le passer sous silence. Par une rencontre de fatalités,
un projet de mariage qui, sans nul doute, s'il se fût réalisé, eût adouci, pour
sa nature douloureusement nerveuse, les chocs inévitables de la carrière
d'artiste, échoua tout à coup, et le laissa lui-même, comme il me l'a dit
souvent, aller à la dérive.
O tranquille et
mélancolique Hollande ! s'écrie-t-il dans sa Visite du musée instrumental du
Conservatoire. Pays de la famille, et du coin du feu, Hollande que j'ai
traversée à une époque de ma vie, que le charme d'un souvenir mêlé de tristesse
éclaire d'un reflet lumineux et pâle comme un de tes soleils d'argent ! Ce
retour vers le passé, dit-il ailleurs, ce pèlerinage vers des lieux chers à la
jeunesse envolée, qui ne l'a pas fait au moins une fois dans sa vie ? Puis, à
l'occasion d'une Promenade sur un ancien boulevard, il ajoute ces mots
qui peignent si poétiquement et si sincèrement sa blessure toujours ouverte :
Nous trouvions doux d'y venir à la fin du jour, et là, seul, assis sur le
revers d'un fossé, d'y ouvrir, au soleil couchant, comme dit Jean-Paul Richter,
cet herbier du souvenir tout rempli de plantes desséchées et de fleurs fanées. Dans
l'intéressante étude qu'il publia ici même, en décembre 1873, sur Monteverde
dont il était allé copier l’Orfeo à la bibliothèque de Bruxelles, on
trouve encore ces lignes attristées : parmi les blondes beautés de la Belgique,
je me suis surpris à chercher, comme autrefois, la fiancée promise à chacun. La
mienne, depuis vingt ans, est couchée dans le tombeau. Nous avons lu de lui des
vers touchants et plus précis encore sur cette pensée constante. Que sont-ils
devenus ?
Mais la fournaise est
ouverte. Eugène Gautier s'y jette. Il a vingt-trois ans.
Le seuil ne dut pas lui
en paraître bien redoutable. Du reste, ce n'était pas encore Paris, c'était
Versailles. L'Anneau de Mariette, un acte de Laurencin et de Cormon,
voilà le premier pas. Et quelle odyssée, ou plutôt quel Roman comique !
Pas de chemin de fer : le simple et illustre coucou ! Mais aussi quel orchestre
! L'orchestre de l'Académie royale de musique, s'il vous plaît. Habeneck en
tête ; puis Meifred, puis Tulou, puis les autres ! Et c'était notre compositeur
de vingt-trois ans qui conduisait l’exécution. Quel succès ! succès de
camarades, je le veux bien. Quel réconfort, toutefois, et quel aiguillon pour
l'auteur ! Il faut, pourtant, que trois années s'écoulent et qu'une révolution
se fasse pour qu'il conquière définitivement une place au théâtre. Les
barricades de 1848 à propos fait en collaboration avec Pilati et joué sur
la scène de l'Opéra national, est son premier pas sur une scène parisienne. Le
deuxième est le Marin de la garde, petit acte représenté en 1849 au
théâtre Beaumarchais.
Mais un nouveau théâtre
va suppléer avec éclat, l'Opéra national dont les artistes, ayant à leur tête
Eugène Gautier que l'on trouvait toujours quand il s'agissait de provoquer
l'ouverture ou la réouverture d’un théâtre de musique, avaient inutilement
obtenu de Limnander qu'il laissât ses Monténégrins à la jeune scène où,
du premier coup, Maillart s'était fait un nom avec Gastibelza, et où Gautier
tint l'archet de second chef d'orchestre.
Le Théâtre Lyrique est
fondé, sous la direction des frères Seveste qui devaient, l'un après l'autre
succomber en pleine réussite. De 1851 à 1853, Eugène Gautier y fit représenter
six ouvrages en un acte, dont deux, Flore et Zéphire et Schahabaam
eurent un succès plus que deux fois centenaire. L'esprit, la mélodie vraie,
l'accent de la scène, l'harmonie toujours en situation, telles furent, presque
immédiatement, les qualités maîtresses du jeune compositeur, on pourrait dire
les fées qui dotèrent son berceau. Plus tard, dans la Bacchante, dans le
Trésor de Pierrot et surtout dans la Clé d'or, elles s'adjoignirent
le style et l'émotion ; mais elles conservèrent toujours la première place et
comme la part léonine dans l'œuvre, hélas interrompue d'Eugène Gautier.
Murdock le bandit (23 octobre 1851), Choisy-le-Roy
(1852), l'Ouverture, les Entr'actes et les morceaux de chant du Lutin de la vallée,
opéra-ballet improvisé en quelques jours avec la « furia della gioventu » pour les débuts de Mme
Guy Stephan, une danseuse del primo cartello qui émigrait de l'Opéra et
dont le succès, au Théâtre-Lyrique, raffermit ce théâtre encore chancelant,
puis le Danseur du roi, que le talent de Saint-Léon, trahi par une
danseuse médiocre, ne pût faire réussir : tels furent les ouvrages par lesquels
Gautier préludait aux deux brillantes réussites qui allaient lui ouvrir, sous
la direction restée célèbre de M. Emile Perrin, les portes de l'Opéra-Comique.
Dès l’année 1850, il
avait donné démission de chef de pupitre à l'orchestre, de l’Opéra-Comique,
comme il le fera plus tard à la Société des concerts, et il était entré comme
chef du chant du Théâtre italien. Ces diverses fonctions qu'il traversait sans avoir
l'intention de s'y fixer, lui faisaient connaître et pratiquer les lois et les
conditions de la musique de théâtre, la structure des morceaux d'ensemble et le
maniement des masses.
Il fit jouer cinq ouvrages
à la salle Favart, trois en un acte, le Mariage extravagant, le
Docteur Mirobolan, Jocrisse, et deux en deux actes, la Bacchante
et le Trésor de Pierrot. La Bacchante fut jouée sous la direction
de Nestor Roqueplan, et, malgré l'originalité de la partition et le brillant
gosier de Mme Cabel, fut littéralement écrasée par l'implacable locomotive du Pardon
de Ploërmel [de
Meyerbeer],
qui pourtant n'arriva pas lui-même à toucher barres.
Le Trésor de Pierrot, une œuvre aussi exquise
dans son genre que Philémon et Baucis dans le sien, fut encore moins heureux
que la partition de Gounod ; car il ne trouva pas 'pour se relever devant le public,
un directeur, même temporaire, comme M. Emile Perrin, et une cantatrice même
passagère, comme Mlle Chapuis. Par surcroît de malheur, le Trésor de Pierrot
n'a pas été gravé.
Eugène Gautier qui
avait le flair et le pressentiment des modes au théâtre, voulait donner, pour
finale à son Jocrisse, un bal d'incroyables. Privée de cette coda,
toute nouvelle alors, la partition ne put obtenir l'effet de contraste que
l'auteur se proposait.
Il faillit en être de
même du Docteur Mirobolan, dont on voulait enlever le pimpant finale :
la soupe vous attend. Mais l'inflexible attitude d'Eugène Gautier fit conserver
ce morceau dont le retranchement, il faut bien le reconnaître, tout en mutilant
la partition, ne l'aurait point empêchée d'atteindre, à l'éclatante réussite
qu'elle a obtenue. L'introduction, — une scène de Molière en musique, — le duo
de Crispin et de Dorine, où l'on entend les baisers sonores de l'amour joyeux
et bien portant, et qui figurera, un jour, sans pâlir, à côté du célèbre duo
des Deux Avares ; les couplets si amusants et si naïvement colorés de
grand Simon ; enfin le mélodrame archaïque qui accompagne si agréablement la
rencontre des deux médecins ; ces différents morceaux et aussi l'interprétation
hors ligne de ces quatre artistes exceptionnels : Couderc, Lemaire, Berthelier
et Mlle Lemercier ; tout s'était réuni pour faire à la pièce un solide rempart
contre les suites de toute maladroite coupure.
L'existence déjà si
occupée d'Eugène Gautier va prendre un développement encore plus large. En
1864, il est chargé du cours d'harmonie pour les femmes au Conservatoire ; et
Nestor Roqueplan, qui rédigeait le feuilleton-théâtres au Constitutionnel,
lui demande sa collaboration pour les choses de musique. C'est alors que le
sentiment critique et littéraire qui existait à l'état latent chez Eugène
Gautier et dont j'avais surpris déjà mainte lueur, se développa tout à fait. Un
écrivain coloré, spirituel, imprévu, sortit presque sans transition des
inexpériences et des tâtonnements de la veille. Gautier prit place tout à coup,
parmi les plus brillants peintres de la plume, parmi les humoristes les plus
piquants.
Il se rattache évidemment
à la nouvelle école ; mais il y apporte son propre esprit et une sincérité d'émotion
qui l'empêche de tomber dans la virtuosité. Il rencontre, comme Dickens, de
vraies trouvailles d'images et de détails. Veut-il peindre le sacristain de
l'église Saint-Gervais ? La forme de son vêtement, dit-il, le faisait ressembler
parfaitement à un corbeau, oiseau qui, comme chacun le sait, est vêtu, hiver
comme été, d'une culotte courte, d'une veste et d'un habit noirs, le tout
taillé à la française. Ailleurs, il appelle les moineaux : ces gamins de l'air.
Son cocher de Trouville dont la casquette de loutre couvrait un front chagrin
et qui, comme Rachel, ne voulait pas être consolé, est un croquis d'une vérité
moqueuse qui, une fois entrevu, ne vous sort pas de l’esprit. Et les souliers
des paysannes normandes ! De bons souliers plats et lacés, souliers sans
sexe, que peuvent se prêter le mari et la femme ; honnêtes chaussures faites
pour défendre le pied et non pour le faire regarder. Puis, les bonnets ! Non
pas, dit-il, ces bonnets parisiens, papillons toujours prêts à s'envoler ; mais
ces chastes bonnets normands qui, sans laisser voir un seul cheveu, enserrent
le crâne comme un morion. Bonnets que le devoir attache ; frères endimanchés et
pas fiers des bonnets de coton de la semaine.
Le Figaro, le Moniteur
universel, le Pays, le Gaulois, publièrent de ses articles et
les mirent à la meilleure place. Une récompense honorifique était due à tant de
travaux et de succès. En 1867, il reçut la croix.
Les désastres du pays,
en 1870 et en 1871, eurent nécessairement leur contrecoup dans les travaux de
l'esprit, et surtout dans les œuvres de l'imagination ; mais se roidissant
contre les difficultés de toute sorte dont se trouvaient menacées les études
qui lui étaient chères, n'ayant pu toutefois obtenir la classe de composition
qui lui semblait devoir être le juste couronnement de ses effort, Eugène
Gautier accepta d'échanger les tranquilles fonctions de professeur d'harmonie
contre le cours hasardeux et absorbant de l'histoire générale de la musique.
Ce qu'il a dépensé de
recherches, d'intuition, de rapprochements, d'interprétation, dans cette
nouvelle tâche ne se peut dire et ne se comprendra que lorsqu’enfin on se sera
décidé à publier le texte de ses leçons. Mais, lui, il ne sera plus là avec sa
triple science de diseur, de chanteur et de pianiste pour animer et faire
vivre, de sa voix, de son regard et son jeu, les citations musicales, les trésors
archaïques qui en forment la substance. Il avait préparé pour le cours qui
allait s'ouvrir, six leçons que la mort ne lui a pas laissé le temps de
prononcer.
Ses nombreux auditeurs
étaient devenus ses amis, et l'injuste fiasco de la Clef d'or, qui leur
a enlevé si cruellement leur professeur, les a frappés eux-mêmes comme s'ils
recevaient une blessure. Nous touchons, en effet, au fatal dénouement de cette
existence vaillante et surmenée. La non-réussite de la Bacchante avait
déjà mutilé la main droite d'Eugène Gautier, et lui avait arraché pour ainsi
dire son archet si expressif. La chute de la Clef d'or, au théâtre de la
Gaîté devenu le Théâtre-Lyrique, alla plus avant. L'organisation tout entière,
déjà ébranlée, fut profondément atteinte. Il ne devait pas survivre à ce
dernier coup. Dans cette œuvre qui allait nous le prendre, il avait mis non toute
la complexité de son talent, mais le côté moins connu qu'avaient développé en
lui la fréquentation et l'analyse des maîtres.
Un très curieux article
qu'il publia dans le Gaulois, résume, avec une netteté magistrale, le
but nouveau qu'il se proposait : la comédie lyrique. La musique du théâtre de
Scribe est faite, disait-il. Il reste à faire la musique du théâtre des Musset,
des Sandeau, des Dumas fils, des Octave Feuillet. La comédie moderne,
ajoutait-il, avec les types nouveaux, les émotions nouvelles résultant du nouvel
état des choses peut devenir une mine précieuse d'où un nouveau théâtre musical
peut sortir. Et il, citait la Dame aux camélias, la Maison de
Pénarvan, le Roman d'un jeune homme pauvre, Dalila.
N'est-ce pas aussi un
type adorable à mettre en musique, s'écriait-il, que cette Suzanne de la
Clef d’Or tombant du haut de son rêve, avec ses fleurs, d'oranger et son
voile blanc au front, dans les bras de cet enfant du siècle, Raoul d'Athol, qui
se croit sceptique et blasé, et dans le cœur duquel, sans autre coquetterie que
son amour, sans autre adresse que sa beauté, elle se taille tranquillement un
idéal à sa guise, plus confiant et plus amoureux qu’elle n'avait osé l’espérer
?
Cet idéal, Eugène
Gautier y consacra toute l'énergie, toute la tendresse de ses dernières pensées,
toute la science des timbres et des tonalités, cette palette de la musique, qui,
sans la contenir tout entière, en étreint aujourd'hui une si grande part. L'ouverture,
le duo du second acte, les deux airs si admirablement dits et chantés par
Bouhy, le rondo même où Mlle Marimon faisait surtout éclater la virtuosité,
mais où le musicien avait jeté toutes les étincelantes illusions de l'amour,
ces cinq morceaux qui n'ont pu sauver la pièce, mais qui feront vivre la
partition constituent le texte même dont l'article publié dans le Gaulois
n'est que l'éloquent sommaire et font comprendre toute la désespérance qui dut
s'emparer du pauvre et grand, artiste quand il vit crouler cette œuvre édifiée
par lui avec tant de passion et d'étude. Dès que les répétitions
passèrent du foyer au théâtre, il eut le pressentiment du désastre et il me dit
: « Cette pièce, me tuera. »
— Vous êtes
merveilleusement armé pour la bataille du théâtre, lui avais-je dit quelques
jours auparavant. Un seul point, en vous, reste à découvert, le cœur. Et c'est
justement là que les coups sont mortels. Il a succombé le 1er avril 1878, à
cinq heures du matin. L'avant-veille, il avait demandé et reçu les sacrements.
Il laisse entre les
mains de sa sœur une très habile adaptation française de l’ldomenée de
Mozart, la partition manuscrite d'une messe solennelle qui a été souvent
exécutée par la maîtrise de Saint-Roch, la partition inédite et non jouée de la
Pagode qui avait été écrite pour le Théâtre-Lyrique, et les matériaux tout
prêts d'un nouveau volume qui peut faire suite à Un Musicien en vacances.
Henry Trianon
(1811-1896)
Administrateur de
l’Opéra-Comique (1857)
Conservateur de la
Bibliothèque Sainte-Geneviève, Paris
Auteur dramatique,
librettiste
|
1843
Pas de premier prix
Henri DUVERNOY (1820–1906)
 |
Henri Duvernois en 1852
( portrait de Marie Alexandre Alophe, 1852, BNF Richelieu )
|
Pianiste, organiste, compositeur, professeur de solfège puis d’harmonie au Conservatoire de Paris, Henri Duvernoy appartient à une vieille famille protestante de Montbéliard (Doubs), où elle est attestée dès le XVIIe siècle avec Joseph Jérémie Duvernoy, né vers 1670, apothicaire. L’un de ses descendants, Aleksandr Lvovitch Duvernoy (1839-1886) enseignera à l’université de Moscou. Une autre branche s’alliera avec la famille des industriels Peugeot par le mariage de Louise Duvernoy avec Jules Peugeot, le fondateur avec son frère Emile de la célèbre société " Peugeot Frères " en 1857. Une autre branche, celle qui nous intéresse, issue de Charles Frédéric Duvernoy, gantier et bourgeois de Montbéliard aux XVIIIe siècle, donna naissance à toute une dynastie de musiciens parisiens avec ses deux fils Frédéric et Charles. Le premier (1765-1838), corniste émérite, enseigna son instrument au Conservatoire de Paris, fut cor solo à l’orchestre de l’Opéra de Paris et à celui de la Chapelle impériale et est l’auteur d’une Méthode pour cor mixte. Le second (1766-1845) est le père d’Henri. Clarinettiste, tout comme son frère il quitta Montbéliard pour Paris au moment de la Révolution pour entrer dans la musique de la Garde nationale (1790) et y épousa en 1819 Sophie Rosenstiel. Egalement professeur au Conservatoire de Paris, il joua dans l’orchestre du Théâtre Feydeau durant 25 ans. Il a laissé 2 Sonates pour clarinette avec accompagnement de basse et des airs variés.
Né le 16 novembre 1820 à Paris, Henri Louis Charles Duvernoy entrait au Conservatoire de cette ville en octobre 1829, à l’âge de 9 ans. C’est là qu’il fit toutes ses études musicales durant quatorze années. Elève d’Aimé Leborne, Pierre Zimmermann, Victor Dourlen, Fromental Halévy et François Benoist, il remporta cinq premiers prix : solfège (1833), piano (1838), harmonie (1939), contrepoint et fugue (1841) et orgue (1842). L’année suivante, il se présentait au Concours de Rome avec la cantate Le Chevalier enchanté du Marquis de Pastoret qui lui valut un premier Second Grand Prix. Le jury particulièrement sévère cette année ne décerna aucun Premier Grand Prix, récompensant uniquement l’œuvre de Duvernoy et celle d'Alexandre Marchand !
 |
Pièce pour piano Mousse de Champagne, rondoletto brillant, par Henri Duvernoy,
dédiée "A mon jeune ami Gabriel Grovlez" [1879-1944, futur chef d'orchestre à l'Opéra de Paris
et à celui de Chicago]
( "Piano-Soleil", supplément musical du "Soleil du dimanche", 23 août 1891, coll. D.H.M. )
 Fichier audio par Max Méreaux (DR.) Fichier audio par Max Méreaux (DR.)
|
Professeur adjoint de solfège au Conservatoire de Paris à partir de novembre 1839, il fut nommé titulaire d’une classe en octobre 1848 puis enseigna l’harmonie à compter de novembre 1878, avant de prendre sa retraite deux années plus tard, à la fin de l’année 1880. Fétis nous indique que " dans cette position, il a eu pour élèves un grand nombre d’artistes qui depuis lors se sont distingués comme chanteurs et comme instrumentistes. " Le journal " La France musicale " du 19 juillet 1863 soulignait déjà la qualité de son enseignement et de deux de ses ouvrages : 25 Leçons de solfège à changements de clefs (Paris, L’auteur, 1857), qui sera adopté par le Conservatoire de Paris, ses succursales de Toulouse, Marseille, Metz et Lille, ainsi que par les Conservatoires de Bruxelles et de Liège, et Solfège artistique avec accompagnement de piano, divisée en 2 parties (Paris, L’auteur, 1860) :
" M. Henri Duvernoy, l’un des professeurs les plus distingués du Conservatoire, auteur d’un solfège à changements de clefs et d’un solfège artistique, récemment couronnés par l’Académie des Beaux-Arts de l’Institut de France, vient d’obtenir un beau et légitime succès. Sur cinq élèves présentés au concours de solfège du Conservatoire, qui a eu lieu le mercredi 15 juillet courant, deux des concurrents, MM. Bonnange et Forestier, ont obtenu la 1re médaille (le premier à l’unanimité) ; le jeune Souplet, âgé de dix ans à peine, a mérité la première des secondes médailles, et MM. Rauch et Singer ont eu chacun une 3e médaille. "
Ce même journal notait dans son édition du 18 juillet 1869:
" M. Henri Duvernoy, l’un des professeurs les plus distingués et les plus consciencieux de notre Conservatoire, vient d’obtenir, au concours du 15 juillet courant, un nouveau succès dans la personne de ses élèves, succès parfaitement justifié, qui témoigne de l’excellence de son enseignement et des heureux fruits que l’on doit recueillir de l’étude sérieuse et approfondie de ses remarquables ouvrages didactiques. Sur quatre élèves présentés au concours par cet habile professeur, et qui, pour la première fois, prenaient part à cette difficile épreuve, trois d’entre eux ont mérité des récompenses. Une seconde médaille a été décernée à l’élève Chizalet, deux fois lauréat du Conservatoire de Toulouse, et qui possède une très bonne organisation musicale. Quant à MM. Willemotte et Cros, qui, bien que très jeunes encore, ont prouvé qu’ils étaient des lecteurs intelligents et exercés, ils ont obtenu chacun une troisième médaille, vaillamment disputée à des concurrents nombreux, comptant déjà plusieurs années de classes. Le chiffre des concurrents était de 37. "
On doit encore à Duvernoy d’autres ouvrages didactiques : 400 Dictées musicales, divisées en 2 volumes (Benoit, s.d.), 600 Dictées musicales, divisées en 3 volumes (L’auteur, 1882-1883), Ecole concertante de solfège, 20 études de style et de perfectionnement pour 2 voix égales, sans accompagnement, à l’usage des Conservatoires, des écoles de musique et des orphéons (Benoit, s.d.), Leçons manuscrites de solfège, 1er et 2e livres (Leduc, 1906-1907), Solfège progressif, sans accompagnement (C. Alard, s.d.), 15 Vocalises pour voix de soprano ou ténor. Ces ouvrages de grande qualité valurent à son auteur d’être nommé Officier d’Académie (1875), de l’Instruction publique (1881) et chevalier de l’ordre de Léopold (Belgique). En 1870, il fut chargé par le directeur du Conservatoire de Paris, Auber, d’établir un rapport sur l’enseignement du solfège dans cet établissement à la Commission de révision des études de l’Académie des Beaux-Arts et le 29 janvier 1872 il était nommé membre du comité d’examen de piano.
Parallèlement à ses activités pédagogiques auxquelles il consacra 41 années de sa vie, Henri Duvernoy, 1er prix d’orgue dans la classe de Benoist, assuma des fonctions d’organiste. Tout d’abord au temple des Billettes de la rue des Archives à partir de 1849, il touchait dans cette église luthérienne l’ancien orgue Cavaillé-Coll de l’église Saint-Roch qui avait été installé là en 1842, inauguré la même année par Sigismund Neukomm. Cet instrument, remplacé en 1982 par un Mülheisen, fut transporté ensuite (1988) dans la chapelle des catéchismes de la basilique Sainte-Clotilde. Quelques années plus tard, Henri Duvernoy fut nommé au temple de la Rédemption, rue Chauchat. Seconde église, après celle des Billettes, attribuée en 1841 au consistoire de l’Eglise évangélique luthérienne de Paris, elle avait été construite en 1842 sur un ancien entrepôt des Douanes et bénéficiait d’un orgue Cavaillé-Coll. Enfin, en 1858 il passa au temple de Penthemont situé rue de Grenelle dans le septième arrondissement. Ancienne église du couvent des Bernardines avant la Révolution, elle avait été ouverte au culte réformé en 1846 et un orgue neuf d’Aristide Cavaillé-Coll y avait été construit. Henri Duvernoy joua sur cet instrument de 21 jeux, répartis sur 2 claviers et un pédalier, durant plusieurs décennies. Aux Billettes, il avait succédé à son oncle par alliance Georges Kuhn qui avait été nommé à ce poste d’organiste au début des années 1830. Né le 26 novembre 1789 à Montbéliard où il est mort, célibataire, le 16 septembre 1858, ancien élève de Catel et de Cherubini au Conservatoire de Paris, Kuhn avait enseigné le solfège et le chant dans cet établissement entre 1822 et 1848 puis était retourné à Montbéliard laissant ses claviers à son neveu. Il est l’auteur d’un Solfège des chanteurs avec accompagnement de piano ou Méthode analytique de musique en trois parties (L’auteur, 1851), d’un Te Deum des églises évangéliques (1847), de choeurs et de romances. En 1846, Henri Duvernoy et son oncle Georges Khun furent chargés par le consistoire de Montbéliard de réformer le chant des psaumes et des cantiques à l’usage des temples du culte évangélique de France, ce qui aboutit à la publication d’un Nouveau choix de psaumes et de cantiques harmonisés à quatre voix, et composées en partie par MM. Kuhn et Henri Duvernoy (Paris, 1848, 2 volumes).
En dehors de ses publications pédagogiques et de son travail sur la liturgie protestante, Henri Duvernoy a beaucoup composé pour le piano. On lui doit en effet plus d’une centaine de pages pour cet instrument, ainsi que de nombreuses mélodies. Il est décédé à Paris le 24 janvier 1906, alors veuf depuis 23 ans. Caroline Kuhn, qu’il avait épousée le 28 août 1845 à Paris, était en effet décédée depuis le 8 novembre 1882. Fille de Léonard Kuhn, professeur de musique à Montbéliard, elle était la nièce de l’organiste des Billettes Georges Kuhn, tous deux fils de Jean-Georges Kuhn (1759-1840), également professeur de musique à Montbéliard.
Deux frères d’Henri Duvernoy firent aussi carrière dans la musique : Charles (1796-1872), ténor à l’Opéra-Comique, enseigna le chant au Conservatoire de Paris (1841) et Frédéric (1800-1874), élève de cor de Dauprat dans ce même Conservatoire, fit partie de l’orchestre du Théâtre-Italien et de celui de l’Opéra. Deux fils de Charles devinrent à leur tour d’éminents musiciens : Alphonse (1842-1907), pianiste et compositeur, élève de Bazin et de Marmontel au Conservatoire de Paris, enseigna le piano (classe des femmes) dans cet établissement à partir de 1886 et épousa en 1881 Maria-Anne Viardot, élève et fille de la célèbre cantatrice Pauline Viardot ; Edmond (1844-1926), marié en 1875 à Adèle Kahn (1853-1912), « Mlle Franck » de l'Opéra-Comique où il se produisait à la même époque comme baryton. Il enseigna aussi le chant au Conservatoire de Paris à compter de 1887.
Denis Havard de la Montagne
 Henri Duvernoy, La Danse des Kalmouk, “caprice de genre” pour le piano, op. 84, dédicacée “à Mademoiselle Marie Delanoue” (Paris, 1869, Alphonse Leduc). Fichier audio par Max Méreaux (DR).
Henri Duvernoy, La Danse des Kalmouk, “caprice de genre” pour le piano, op. 84, dédicacée “à Mademoiselle Marie Delanoue” (Paris, 1869, Alphonse Leduc). Fichier audio par Max Méreaux (DR).
Alexandre MARCHAND (1819-1891)
 |
Mélodie Le Bonheur, paroles de François Fertiault, musique d'Alexandre Marchand
( Paris chantant, Lavigne éditeur, 1845 ) DR
 Fichier audio par Max Méreaux avec transcription pour clarinette Fichier audio par Max Méreaux avec transcription pour clarinette
et réalisation accompagnement au piano (DR.) |
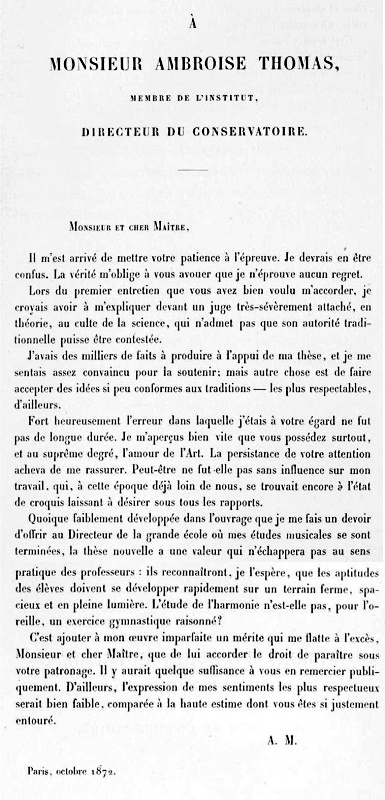
|
Couverture et dédicace du Principe essentiel de l'harmonie d'Alexandre Marchand
(coll. Max Méreaux) DR.
|
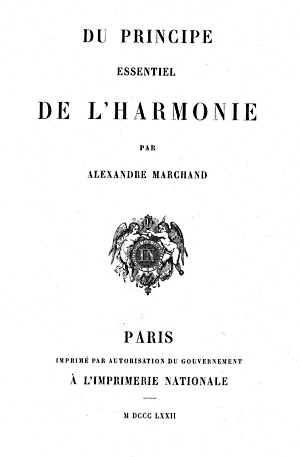
Voici un lauréat du Prix de Rome curieusement oublié de la plupart des biographes, chercheurs et autres musicologues. Pierre Constant, lauréat de l’Institut, dans son irremplaçable et remarquable étude sur Le Conservatoire national de musique et de déclamation (Paris, Imprimerie nationale, 1900), dans laquelle il dresse notamment la liste de tous les lauréats de ce prix des origines (1803) à 1900, le passe sous silence. Et pourtant, son prédécesseur Théodore de Lassabathie, dans son Histoire du Conservatoire impérial de musique et de déclamation (Paris, Michel Lévy Frères, 1860) le mentionne bien ! Serait-ce le simple fait que l’intéressé, rare exception parmi tous les récipiendaires, ne soit pas issu du Conservatoire de Paris, mais d’un conservatoire étranger qui le fasse ainsi "oublier" par certains? Mais, heureusement, son nom n’a pas été également omis dans les comptes-rendus parus dans la presse musicale de l’époque (Le Ménestrel, La France musicale). Bien que sa destinée soit encore mal connue, il est de notre devoir de donner ici les quelques éléments biographiques découverts à ce jour.
Nicolas, Alexandre Marchand est né le 21 mai 1819 à Bourmont (Haute-Marne). Fils d’Auguste, Louis Marchand, originaire de Paris, professeur de mathématiques, notamment au Collège de Bourmont, et de Marie, Jeanne Sablon, il vint au monde en l’absence de son père retenu au Collège de Semur-en-Auxois (Côte-d’Or) dont il était alors le Principal. La famille résidait à ce moment chez le grand-père maternel, Claude Sablon, lui-même Maître de pension.
C’est au Conservatoire royal de musique de Bruxelles, sous la direction de Fétis, qu’Alexandre Marchand effectua ses études qui furent couronnées en 1843 par un 1er prix de composition. Dans cet établissement il enseignait l’harmonie depuis quelques années en tant que professeur adjoint. La même année, il s’inscrivait à l’Institut de France au Concours de composition musicale, mais le sujet imposé, la cantate Le Chevalier enchanté, paroles du marquis de Pastoret, n’inspira guère les candidats ! Aucun premier Grand Prix ne fut décerné par le jury, qui accorda seulement un second Grand Prix à Henri Duvernoy et une mention honorable à Alexandre Marchand.
En 1854, sans doute déçu de ne pouvoir vivre de sa musique, il entra comme Sous-chef au Ministère du Commerce à Paris, poste qu'il occupa pendant 29 ans, avant de prendre sa retraite en juillet 1883. Néanmoins, il n'abandonna pas pour autant la composition : en 1872, il faisait paraître à Paris (Imprimerie nationale) un ouvrage pédagogique Du principe essentiel de l’harmonie, qui créa quelques remous dans le monde musical. Pougin, continuateur de la Biographie des musiciens de Fétis, écrivait à ce sujet que c’est "un ouvrage théorique qui bouleverse peut-être un peu trop les idées reçues dans la matière, et dont les tendances sont hardies au point d’en paraître audacieuses", ajoutant : "Sans être l’ennemi de tout progrès en matière de science musicale et sans se confiner dans une routine obsolète, je crois que l’on ne saurait accepter, même en partie, le système et les théories de M. Marchand sans en faire l’objet de l’examen le plus scrupuleux." La bibliothèque du Conservatoire de Bruxelles détient un recueil de mélodies, (27e volume) de ce compositeur (B Bc 25.108), qui est sans doute également l’auteur "d’une sorte d’arrangement à trois voix de La Marseillaise", donné à Dijon en septembre 1890 "avec un beau succès" [Le Ménestrel, 27 septembre 1890].
En 1845 à Paris, l'éditeur Lavigne avait publié l'ouvrage Paris chantant. Romances, chansons et chansonnettes contemporaines, genre alors très en vogue. On y relèvait déjà trois oeuvres d'Alexandre Marchand, écrites sur des paroles de François Fertiault : L'Enragé ou les tortures de Franchol, N'ouvre pas ton coeur et une mélodie intitulée Le Bonheur. Cette même année l’éditeur parisien D. Grue publiait de son
côté Prends garde !, pastorale et Si j’étais une hirondelle, Sérénade.
Plus tard, on trouve Jean Sévère, Turlurette et La Blanchisseuse,
d’après Les Chansons des rues et des bois de Victor Hugo (1866, H.
Lemoine), Fleur d’amour, romance dédicacée « à Mademoiselle
Marguerite Sion » (Paris, Souchet, 1876), Français ! Aux urnes !,
chant patriotique (incipit : « Entends la voix du pays qui t’appelle »
(id.), Vin du Midi, chansonnette, paroles d’Emile Jacob (id.), Le Printemps,
deux strophes des Dogmes nouveaux, poème d’Eugène Nus, harmonisées pour
4 voix d’hommes (Paris, L’Orphéon, 1881), Le Soldat de la réserve, chant
de l’armée territoriale, chœur à 4 voix d’hommes (incipit : « Adieu
Marie, femme chérie ! ») (l’auteur, 1881).
Alexandre Marchand, célibataire, est mort le 11 mars 1891 en son domicile parisien du dix-septième arrondissement.
Denis Havard de la Montagne
(2010, révision en 2017 et 2022)
1844
Victor MASSÉ (1822-1884)
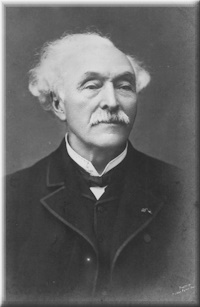 |
Victor Massé (1822-1884),
Grand Prix de Rome 1844,
professeur de composition
au Conservatoire de Paris,
membre de l'Institut,
auteur d'une vingtaine d'oeuvres
lyriques à grand succès
(photo Pierre Petit, coll. DHM) DR.
|
VICTOR
MASSE
(vu en 1873)
Massé (Félix-Marie-Victor) naquit à Lorient (Morbihan) le
7 mars 1822.
Il entra, le 15 octobre 1834, au Conservatoire de Paris oh
il obtint de nombreux succès qui furent couronnés, dix ans après, par le
premier grand, prix de composition de l’Institut.
M. Massé alla passer deux ans à Rome, parcourut ensuite
l’Italie et l’Allemagne et revint à Paris. Quelques compositions de peu
d’importance, des romances, des mélodies sur quelques Orientales de Victor Hugo,
ne laissèrent pas d’attirer sur lui l’attention qu’éveilla tout à fait, en 1852,
la Chanteuse voilée, opéra-comique
en un acte, représenté à l’Opéra-Comique, le 26 novembre 1850. La musique
gracieuse du compositeur, dont cet opéra a été le coup d’essai théâtral,
contribua principalement au succès, de l’ouvrage ; on a remarqué l’ouverture
qui se compose d’un solo de cornet à pistons d’une grande suavité, d’un joli
boléro et d’un allégro d’un caractère espagnol plein d’entrain. La cantatille à
deux voix : Tous les soirs sur la grande
place, romance : D'une lampe
mourante, le grand duo de la scène de la pose du modèle
entre Vélasquez et Palamita, le boléro : L’air au loin
retentit du son des castagnettes, sont les morceaux les plus applaudis
de ce charmant ouvrage.

|
Les noces de Jeannette, réduction pour piano, fragment, récitatif
(coll. DHM) DR.
|
L’année suivante, les Noces de
Jeannette, opéra-comique en un acte, fut
représenté le 4 février à l’Opéra-Comique ; il eut un grand succès, et plusieurs
airs en sont restés populaires.
Le livret, qui est de MM. Michel Carré et Jules Barbier,
met en scène une jeune fille sage et laborieuse qui parvient à force de
tendresse et d’adresse à ramener au devoir un paysan son fiancé, ivrogne,
colère et brutal. Il y a dans cette jolie pièce une sensibilité vraie, de la grâce,
mais quelquefois aussi un peu de trivialité. La scène dans laquelle Jeannette
raccommode l’habit que Jean a déchiré dans un accès de mauvaise humeur, est
touchante, et la romance : Cours, mon aiguille, dans la laine, est devenue
populaire. Les vocalises en duo avec la flute, imitant le chant du rossignol
ont produit de l’effet, surtout lorsqu’elles étaient chantées par Mme Miolan-Carvalho.
La scène du raccommodement des deux époux : Allons,
rapprochons-nous un peu, Je sens mon coeur tressaillir d’aise…, a été traitée
avec infiniment de goût. Parmi les ouvrages de M. Victor Massé, celui-ci a
obtenu le succès le plus décidé et le plus durable.
Galathée, opéra-comique en deux actes, de MM.
Jules Barbier et Michel Carré, fut jouée â l’Opéra-Comique le 14 avril 1852, et
réussit. Plusieurs morceaux d’une facture facile et gracieuse ont contribué à
répandre la réputation de leur auteur, entre autres les couplets de Ganymède : Ah ! qu'il est
doux de ne rien faire, et le brindisi chanté par Mme Ugalde : Ah ! verse
encore, Vidons l’amphore !
Je me contenterai de mentionner la Fiancée du
diable
(trois actes, 1854), la Favorita e la Schiava (1855), et Miss Fauvette, un acte (1855).
Dans les Quatre Saisons (3 actes, 1855),
le titre de la pièce n’est motivé que parce que le mariage de Simonne avec
Pierre se prépare au temps de la moisson, est rompu pendant les vendanges, se
renoue en hiver, est conclu au printemps. La partition est la plus riche en
motifs et en effets saillants de celles que le compositeur ait données au
théâtre. L’ouverture a du caractère, surtout dans la première partie. Le chœur
des moissonneurs : Les blés sont coupés ; l’air de chasse ; le chœur des vignerons ;
les couplets du vin nouveau ; le tableau de la veillée d’hiver, où le
compositeur a introduit les refrains populaires : Il court, il
court le furet, Nous n'irons plus au bois, enfin le chœur
du printemps forment la partie descriptive de l’ouvrage, et c’est la mieux
traitée. Mais le public reste indifférent à tous ces hors-d’œuvre et intermèdes
qui déguisent mal le défaut d’intérêt de l’action. Cependant la grande scène du
final du second acte est dramatique et fort belle, et dans le même ordre
d’idées je rappellerai aussi le duo du troisième acte entre Simonne et Pierre.
Tous les ouvrages de M. Massé sont traités avec esprit,
sentiment, et une parfaite intelligence du sujet. La Reine Topaze (Théâtre
Lyrique, 1856) fut pour le compositeur l’occasion d’un succès complet qu’il
n’avait pas obtenu depuis les Noces de Jeannette. La partition se
compose d’un grand nombre de morceaux parmi lesquels on en distingue cinq qui
ont particulièrement fixé l’attention soit par leur mérite intrinsèque, soit
par la brillante exécution de Mme Miolan-Carvalho, qui a déployé dans le rôle
de la reine Topaze toutes les merveilles de son organisation vocale et de son
talent. L’ouverture a une sonorité étrange, bien appropriée à une action qui
doit se passer au milieu d’une tribu de bohémiens.
Le motif du petit sextuor : Nous sommes
six seigneurs, est une belle inspiration. L’air de l’Abeille, indépendamment
de la mélodie qui est gracieuse, est accompagné ingénieusement par un trémolo
de violons à l’aigu ; l’effet de ce procédé est charmant. Le boléro, déjà
entendu dans l’ouverture, est chargé de vocalises qui ont été l’occasion d’un
nouveau triomphe pour la cantatrice. On a intercalé dans le second acte de
l’ouvrage l’air du Carnaval de Venise avec les
variations de Paganini. Mme Carvalho les a exécutées avec une facilité, une
ténuité de sons, une finesse de détails tout à fait extraordinaires. Enfin, au
troisième acte, il y a un trio scénique bien réussi entre Annibal et les deux
bohémiens.

|
 Victor Massé, mélodie Que le jour me dure..., pour voix et piano, poésie de Jean-Jacques Rousseau (Paris, L. Grus, 1873) Victor Massé, mélodie Que le jour me dure..., pour voix et piano, poésie de Jean-Jacques Rousseau (Paris, L. Grus, 1873)
fichier audio par Max Méreaux avec transcription pour clarinette et piano (DR.)
Partition au format PDF
(© ) DR.
|
La musique des Chaises à porteurs (1858) a de
l’élégance. On a remarqué les couplets du chevalier, le duo des Chaises entre le
chevalier et le financier, et un joli quatuor.
La Fée Carabosse (1859) tomba et aussi la Mule de
Pedro, opéra en deux
actes (1863). Les couplets que chante Pedro, en l’honneur de sa mule, sont
d’une facture habile et plusieurs fois répétés dans le cours de l’ouvrage. On a
remarqué aussi le chœur des toreros et la romance de Gilda : Chaque jour je
me le rappelle. Si cet ouvrage avait été donné à
l’Opéra-Comique, il eût obtenu un brillant succès, mais le cadre de l’Opéra est
trop vaste pour un aussi mince canevas et les qualités mêmes du compositeur,
qui sont l’élégance, l’esprit et le sentiment, sont des obstacles là où doivent
dominer l’ampleur, l’effet et la passion.
On crut qu’une revanche serait prise par M. Massé avec Fior d’Aliza, opéra-comique
en quatre actes et sept tableaux représenté en 1866. C’est un ouvrage qui
renferme des morceaux excellents et des mélodies fort agréables, mais que les
défauts du livret ont malheureusement déjà écarté de la scène. Le sujet de la
pièce a été tiré du roman si connu de M. de Lamartine, Grazielia. Les principaux
événements amenés dans un livre avec des ménagements et des circonstances qui
les préparent, les motivent et les rendent vraisemblables, sont ici dans la
pièce brusques, décousus et sans intérêt. L’ouverture offre des effets de rythme
piquants et se termine par une saltarelle animée. Dans le premier acte, on a
remarqué la romance : C’est l’amour, dont
l’accompagnement imitatif est d’une grâce ingénieuse, et le quintette du châtaignier.
Les formes du final sont belles, mais trop pompeuses pour le cadre étroit de
l’action. Dans le second acte, il y a une farandole accompagnée de tambours de
basque d’un charmant effet. Dans le troisième, la saltarelle, dont le motif
termine l’ouverture, revient à l’occasion de la noce de la fille du geôlier, et
elle a été fort applaudie. C’est le principal morceau de chant de l’ouvrage. On
a remarqué aussi l’air de la jeune bohémienne, qui a de l’originalité. Je
citerai encore, dans le quatrième acte, la marche funèbre. Le rôle de Fior
d’Aliza a été admirablement interprété par Mme Vandenheuvel-Duprez.
Ce compositeur, plein de talent et doué d’une imagination
charmante, ne fut pas plus heureux lorsqu’il donna à l’Opéra-Comique le Fils du
brigadier (1867). La scène se passe en Espagne, pendant le siège de
Burgos. C’est une sorte de mélodrame dans lequel sont encadrées plusieurs
scènes très comiques, mais, en somme, le livret n’a pas été goûté. Quant à la
musique, elle est pleine de motifs ingénieux et colorés. Toute la première
partie de l’ouverture est charmante. Il était difficile de mieux poétiser la
formule militaire et banale de la retraite. Je signalerai dans le premier acte
une valse chantée, la-romance : Trembler quand on est militaire ; un refrain
populaire : Les Flamands, les Saxons, et un rondo
bouffe ; dans le troisième acte, un bon trio et la romance : O mon enfant, pardonne-moi, qui précède le
final. M. Victor Massé a
écrit un opéra intitulé Paul et Virginie, j’espère que le
livret n’en compromettra pas le succès comme l’ont fait ceux de ses derniers
ouvrages.
Depuis 1860, M. Victor Massé est chef du chant à l’Opéra où
il a remplacé Dietsch. Il a été élu membre de l’Académie des beaux-arts.
Félix Clément
in Les musiciens
célèbres…
(Paris, librairie Hachette,
1873)
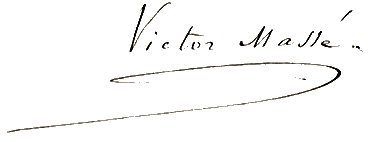
|
| Signature autographe, 1877 (DR.)
|
Note
Musimem : Félix-Marie, dit Victor Massé, né le 7 mars 1822 à Lorient (Morbihan),
perdit tôt son père qui s’était noyé. Sa mère, née Jeanne Lément s’installait
alors à Paris et le jeune Victor entrait à l’« Institution royale de
musique classique et religieuse » de Choron, puis à la fermeture de cette
école en 1834 rejoignait le Conservatoire de Paris où il obtint plusieurs
récompenses : 2ème prix de solfège 1837, 1er prix de
piano 1839 (classe de Zimmerman), 1er prix d’harmonie et
accompagnement 1840, 1er prix de contrepoint et fugue 1843 (classe
de F. Halévy), second grand prix de Rome en 1842 et 1er grand prix
en 1844. Chef des chœurs de l’Opéra (1860), professeur au Conservatoire de
Paris (1866), membre de l’Institut (1872), il s’était marié en 1854 à Paris
avec Zélie-Zoé Mayer (1816-1885). Leur fille aînée, Jeanne Massé (1848-1910),
pianiste, élève de Liszt et de Charles Delioux, prit alliance en 1871 avec le
librettiste et écrivain Philippe Gille (1830-1901) ; ce sont les parents
du pianiste Victor Gille (1884-1964), 1er prix de piano en 1902 et
filleul de Mme Léo Delibes. D’une relation avec Charlotte Jaeger (née en 1942),
Victor Massé eut une fille née hors mariage en 1868 : Madeleine Jaeger.
Première femme à obtenir, entre 1878 et 1891, de nombreuses récompenses au
Conservatoire de Paris (solfège, piano préparatoire, piano supérieur, harmonie,
accompagnement, contrepoint et fugue), elle fit une brillante carrière de
pianiste concertiste. Décédée en Suisse en 1905, elle avait épousé (1891) le
compositeur Henry Jossic (1865-1907). Décédé le 5 juillet 1884 à Paris IXe, Victor
Massé fut reçut chevalier de la Légion d’honneur en 1856, puis officier en 1877.
LES MAITRES DE L'OPÉRA-COMIQUE
VICTOR MASSÉ
(vu en 1897)
II nous souvient, à
assez longue distance, que le fin dilettante Blaze, dont les jugements étaient
marqués au coin d'un si original et si suggestif éclectisme, disait que la
musique d'Auber voulait être entendue comme veulent être vues les femmes de
trente ans : le soir, à la clarté des lustres et des bougies. Il ne savait trop
ce qu'en déshabillé du matin de semblables partitions pouvaient valoir ; mais,
après dîner, quand l'actrice était jolie et la pièce amusante, on aurait eu
mauvaise grâce de prétendre faire le difficile. D'après lui — et nous
partageons, dans une certaine mesure, son avis—il n'y avait que le spirituel
auteur des Diamants de la Couronne pour découvrir de pareils diamants et
les façonner avec cet art. « Vous aurez beau chercher, ajoutait-il, vous ne
trouverez pas, dans son répertoire, un opéra, si faible qu'il puisse être, où
ne se rencontre quelque rare pièce du genre que des plaisantins ont appelé
depuis, par dérision, le genre éminemment national. » Ce don que possédait
Auber, Victor Massé, quelque bonne fée aidant, l'avait reçu à son berceau. Il
était né musicien et eut cette heureuse veine de ne voir contrarier sa vocation
par aucun des siens. Aussi ses premiers pas dans la carrière furent-ils marqués
par de hautes et légitimes satisfactions d'amour propre. Elève de Zimmermann,
il obtenait, à peine au sortir de l'enfance, comme le Joseph, de Méhul,
le premier prix de piano ; et, cinq ans plus tard, stylé à souhait et l'esprit
nourri du substantiel enseignement de son maître Halévy, qui avait reconnu en
lui un sujet d'élite pour lequel il s'était pris d'affection, il emportait,
haut la main, le premier prix de l'Institut : le prix de Rome, rêve de tout
musicien que la gloire de ses devanciers tente irrésistiblement.
La première œuvre qui
attira l'attention sur Victor Massé, à son retour de la Villa Médicis, où il
séjourna réglementairement deux années, fut la Chanteuse voilée,
représentée à l'Opéra-Comique le 26 novembre 1850. Le livret qui lui servit de
thème ne manquait ni d'ingéniosité ni de charme. On y faisait figurer, en
première ligne, le grand peintre Vélazquez, épris d'une camériste de Séville,
la belle Palamita, qu'il enlevait galamment, aux mélodieux frémissements de sa
mandoline, tout comme eût fait l'irrésistible Almaviva. Au lieu d'avoir affaire
au bougon Bartholo, de Beaumarchais, Vélazquez se prend de partie avec
Perdican, un alguazil qui n'entend pas raillerie sur le chapitre de ses amours.
Mais la lutte n'est pas égale entre les deux rivaux, et, après maints incidents
esquissés d'un trait vif, l'alguazil réintègre son poste, et Vélazquez n'a plus
qu'à fixer sur la toile les adorables traits de sa bienaimée, de même que
Raphaël immortalisa ceux de sa « boulangère » : la divine Fornarina.
La Chanteuse voilée produisit l'effet d'un
coup de maître. Nous n'en jugerions pas apparemment de même aujourd'hui, si
l'Opéra-Comique nous la laissait entendre. Il y a gros à parier que l'opinion
de la critique d'alors, très favorable à cette œuvre d'essai, ce qui n'est pas
d'usage courant, serait loin d'être partagée par nos « aristarques » de l'heure
présente. Songez que ces premiers et aimables juges allèrent jusqu'à dire qu'il
y avait, dans la partition de Victor Massé, « exubérance musicale » ! Voilà,
certes, ce qu'on peut appeler un heureux défaut ! Ce qui n'aida pas peu au
succès de la Chanteuse voilée, ce fut aussi, il faut bien le constater,
le précieux concours qu'elle trouva de la part de ses interprètes. C'est MlIe
Lefebvre, devenue depuis Mme Faure, la femme du célèbre baryton, qui créa, en
perfection paraît-il, le rôle de Palamita ; et, dans celui de Vélazquez,
brilla, à son habitude, l'excellent ténor Audran, le père de l'auteur de la
Mascotte.
Les Noces de Jeannette datent du 4 février
1853. Nous avons idée que Victor Massé n'espérait guère, en écrivant cette
paysannerie assez lâchée de style, mais d'une alerte et pittoresque allure,
qu'elle résisterait mieux que ses Saisons, d'un si beau jet mélodique,
aux outrages du temps ; et peut-être a-t-il gémi, dans son for intérieur, de
cette extraordinaire veine, car il était homme de jugement et ne s'illusionnait
point sur la valeur intrinsèque de cette simple fantaisie, rapidement éclose de
sa fertile imagination. Le sort en a décidé autrement, et il restera, pour nos
survivants, l'auteur des Noces de Jeannette, comme alors que les
philosophiques et berceuses pièces poétiques de Sully Prudhomme seront, en
partie, oubliées, on se souviendra toujours de son Vase brisé. N'ayons
garde, d'ailleurs, d'oublier que le livret de ce petit acte a contribué fort à
établir la popularité dont il n'a pas, jusqu'au moment où nous écrivons,
discontinué de jouir, à telles enseignes que, si Victor Massé n'était pas mort
prématurément, il aurait pu assister à la millième représentation de son œuvre.
Il était réservé au seul Ambroise Thomas d'être appelé à jouir, grâce à Mignon,
de semblable béatitude.
A l'époque où les
Noces de Jeannette furent représentées à l'Opéra-Comique, le théâtre
familial par excellence, un chroniqueur disait déjà, moitié en riant, moitié de
bonne foi : « On assure que le charmant dénouement des fiançailles pastorales
de MM. Jules Barbier, Carré et Victor Massé préoccupe vivement les honorables
municipalités de nos douze arrondissements. » (Paris n'en comptait pas encore
vingt, comme actuellement.) Jamais les publications de bans ne s'étaient, en
effet, si multipliées.
Les Saisons, que nous avons citées
avec les éloges qui leur sont dus, étaient faites d'une autre substance et
témoignaient d'un bien supérieur et plus artistique effort, ce qui n'empêcha
pas le public de leur faire grise mine. Massé eut beau les remanier et en faire
une manière d'oratorio : ce public réfractaire et buté n'y put prendre goût. Et
pourtant, Meyerbeer, qui avait quelque compétence en ces choses et estimait
fort le talent de Massé, tenait cette partition pour parfaite dans son genre,
un genre qui avoisinait celui de Haydn. Il ne se faisait pas faute, à
l'occasion, d'en témoigner ouvertement. Mais, que voulez-vous ? Les habitués de
l'Opéra-Comique n'avaient d'oreilles que pour les Noces de Jeannette.
Peut-être même, Mozart nous pardonne qu'ils s'en accommodaient mieux que de
celles de Figaro !
Aux Noces
interminables succédèrent, à courts intervalles, la Fiancée du Diable et
Miss Fauvette. L'interrègne dura peu, encore qu'il y ait, dans ces
manifestations nouvelles de la verve mélodique de Victor Massé, une délicatesse
rare, unie à un esprit très avisé et s'identifiant aux situations, sans les
ponctuer par trop, comme il convient en semblable matière. « Les grandes
lignes, disait-on naguère, toujours à propos d'Auber, font défaut, mais les
détails curieux abondent, et vous avez devant vous une jolie mosaïque, faite
avec toute sorte de petits morceaux d'or et de fragments de pierres précieuses.
» Tout le Massé de la Fiancée du Diable et de Miss Fauvette est
là, et aussi celui de Galatée, que l'Opéra-Comique n'a pas encore rayé
de ses papiers.

|
Victor Massé vers 1870
(coll. BNF, département Estampes et photographies, 4-NA-117) DR.
|
Le sujet de Galatée avait
tenté Rameau, ce souverain maître de la musique française.
La pensée lui vint
d'écrire, sur un poème qui lui fut offert, un ballet qu'il intitula : le
Triomphe des Arts. Notre devoir est de consigner ici que ce ballet n'a pas
laissé une trace lumineuse dans l'histoire lyrique, non plus que la pantomime
de Romagnesi, coulée dans le même moule.
Il ne nous paraît pas
bien nécessaire d'analyser la Galatée, de Barbier et Victor Massé, car
elle n'a guère quitté le répertoire ; mais il n'est pas hors de propos de
marquer d'un trait le grand cas que le compositeur faisait de ce librettiste et
de son autre collaborateur Carré. Il n'avait cessé d'exalter leur mérite.
— Il n'y en a pas
d'autres, disait-il à M. de Thémines, librettiste aussi à ses heures, et non
des plus chétifs.
Tout en reconnaissant
le talent et la haute expérience de ses deux confrères, il hasardait cette
objection :
— Pardon ! mais si, par
un motif quelconque, ils n'écrivaient plus, ou si — à Dieu ne plaise! —ils
disparaissaient?
— Je ferais comme eux :
je n'écrirais plus, ou je disparaîtrais de même.
« Je vis plus tard
Victor Massé, raconte M. de Thémines, aux obsèques de Bourdin, l'un des gendres
do Villemessant. Nous en revînmes à pied. Le chemin était longuet, nous pûmes
causer à loisir. La conversation tomba sur l'ouvrage qu'il composait en ce
moment-là. C'était Paul et Virginie.
» — Charmant sujet, lui
dis-je, mais assez difficile pour le choix des deux interprètes... à moins que
vous n'écriviez le rôle de Paul de façon à pouvoir être chanté indistinctement
par un ténor ou par un soprano.
» — Jamais ! fit Victor
Massé en bondissant. Un travesti, y pensez-vous ?
» — Pourquoi non ! Si
l'on n'accepte pas trop volontiers, chez nous, les travestis, à moins que ce ne
soit pour les rôles de pages, ou pour les opérettes, il n'en est pas de même
ailleurs. »
Et M. de Thémines lui
fit très sérieusement remarquer qu'il ne voulait pas faire exécuter
exclusivement à Paris son opéra, et que l'Italie prenait son parti le mieux du
monde de rôles du sexe fort joués par d'expertes chanteuses habiles, revêtant
fort galamment l'habit masculin sans qu'on y prît garde : à preuve le
personnage de Roméo, des Capulets et Montaigus, de Bellini, écrit pour
un soprano. Rien n'y fit. Massé se montra irréductible. Il devait se souvenir
pourtant que, dans sa Galatée, c'est à Mlle Werteimber, alors dans tout
l'éclat de sa renommée, qu'il confiait le rôle de Pygmalion, primitivement
écrit pour Bataille, et qu'il n'avait eu qu'à se louer de ce bon mouvement, Mme
Ugalde, passionnée et vibrante, lui donnant la réplique, sous la splendide ?
forme de la statue animée, avec la plus superbe des virtuosités.
M. de Thémines, dont
les avis avaient été suivis par Meyerbeer, — pas facile à satisfaire et très
méticuleux, — ne fit pas moins sa traduction en italien de Paul et Virginie
: Paolo et Virginia, et il est vraisemblable que, depuis cette lointaine
époque, les scènes d'au delà les Alpes ont vu apparaître un Paolo portant, au
lieu de jupes et de dentelles, le traditionnel costume de ce tendre et légendaire
amoureux inventé par Bernardin de Saint-Pierre, et dont les aventures ont fait
couler des larmes de tant de beaux yeux !
Il était de la race
pure des créateurs de l'opéra-comique, ce Victor Massé ! Il y avait en lui de
la consanguinité virtuelle de Grétry, dont nous avons essayé de tracer la
souriante et délicate physionomie. Il avait cela de commun avec son illustre
modèle, que les « motifs » jaillissaient de son cerveau sans que le moindre
effort en témoignât. Et veuillez remarquer que ces « motifs », dont il était
prodigue, c'est le sang, la vie et l'âme de la musique, comme l'a dit justement
un analyste qui a fait une attentive étude de notre vieux théâtre lyrique. S'il
en était besoin, les compositions scéniques de Victor Massé en fourniraient une
évidente preuve. Il serait exagéré de vouloir établir que, dans les œuvres
nombreuses qu'il a écrites, la même veine mélodique et la même inspiration
féconde s'y épanchent ; mais il y a toujours, de-ci de-là, quelques traits par
où se manifeste sa charmante et charmeuse originalité. Prenons pour exemple la
Fée Carabosse, représentée au Théâtre-Lyrique, le 28 février 1859. Des lacunes
y apparaissent ; mais comme il a su tirer parti des situations que son
librettiste lui a donné l'occasion de mettre en valeur ! Ce livret n'entrait
pas dans son habituel ordre d'idées. Il était plutôt fait pour tenter la verve
d'Offenbach. Et cependant, par grâce spéciale, Victor Massé en tira grand
parti. Le thème de cette fantaisie lyrique se résume en ceci : dans la forêt des
Ardennes, l'inconscient et amoureux Albert se trouve aux prises avec deux
éthérées : Carabosse et Mélodine. Pour triompher, elles font flèche de tout
bois, ou, pour mieux dire, de toute baguette magique. Mélodine l'emporte si
bien sur sa rivale, qu'elle la réduit à rester laide et bossue, tant que la
bonne fortune ne lui échoira pas de se faire embrasser par un jeune homme fiancé
à une jeune fille. Inutile de dire que la jeune fille n'est autre que la sirène
de la forêt des Ardennes.
C'est là, dans ce sujet
nouveau pour lui, que l'art souple et délicatement plié au genre qu'il lui a
plu de traiter se révèle. Dans la partition de la Fée Carabosse, que
nous n'avons pas eu le plaisir d'entendre au théâtre, nous avons retrouvé les
couplets des « Vins du Rhin », « motif » de fière allure, et une chanson, de
brio sonore, à laquelle Mme Ugalde prêtait sa jeune et vibrante virtuosité.
Victor Massé eut la
main moins heureuse et fut moins bien servi par ses librettistes dans Fior
d'Aliza, que l'Opéra-Comique donna le 5 février 1866. Malgré ses hautes
qualités, l'œuvre n'obtint pas le succès qu'on en attendait. Le sujet était
triste, et triste aussi parut la partition. Mieux eût valu pour lui faire choix
d'un sujet qui entrât plus étroitement dans sa gamme, car sa conscience étant
égale à sa science, il voulut trop aller à l'unisson de ses paroliers.
N'avait-il pas dit lui-même — et cette parole le peint tout entier, — que ce
qui complète la valeur d'une idée mélodique, c'est son union intime avec la
situation et avec une déclamation vraie !
Le Fils du Brigadier eut le sort de Fior
d'Aliza. On y peut glaner, pourtant, des morceaux où reparaît dans sa
verdeur le Massé des Noces de Jeannette et, ce semble aussi, celui des Saisons,
lesquelles rappellent le doux et délicieux poète qui s'était incarné dans Haydn.
Montaubry, si brillant à ses débuts mais alors à son déclin, ne le défendit que
faiblement, — En revanche, la Reine Topaze, représentée au
Théâtre-Lyrique le 24 décembre 1856, s'empara de vive force de tous les
suffrages. Il y a là adéquation complète entre le sujet exposé et la traduction
lyrique qui s'y juxtapose. Il va, par gradations successives, de l'orchestre à
la voix et de la voix à l'orchestre, comme les lois théâtrales et techniques le
commandent. Fétis, d'ordinaire bien avisé, aurait eu mauvaise grâce de dire à
ce propos ce qu'il a dit d'autres œuvres de Victor Massé, à savoir qu'il ne
s'était pas pénétré d'une vérité incontestable : c'est que l'expérience de la
scène et le métier ne tiennent lieu de l'imagination qu'aux dépens de la
renommée d'un artiste. Son sentiment était que, si quelques hommes privilégiés
par la nature ont pu écrire avec rapidité un grand nombre d'opéras dans
l'espace de quelques années et y jeter d'heureuses inspirations, ces
organisations d'élite sont des exceptions. Mais s'il est vrai de noter, sans
songer à lui en faire reproche, que Victor Massé s'est montré inégalement
prodigue de ses dons, il n'est pas moins évident que dans la Reine Topaze
et, à longue distance, dans la Nuit de Cléopâtre, le plus pur de
lui-même, il fixa à nos yeux, dans une action concise, l'ensoleillement de
Venise la belle. Cela tient de l'enchantement.
Montjauze, qui créa le
rôle de Rienzi, de Wagner, à Paris, était son principal interprète, en
compagnie de cet excellent Meillet, trop tôt disparu. Mme Miolan-Carvalho était
aussi de la fête, ou plutôt du triomphe. Nous n'avons pas eu la bonne fortune
de l'entendre dans l'air célèbre de l’« Abeille »; mais nous n'avons pas de
peine à croire qu'elle y devait être absolument merveilleuse. Mme Landouzy,
dont nous goûtons fort le talent et apprécions la voix, ne manquait guère de le
chanter à la leçon de chant du Barbier de Séville. Assurément, ce ne
pouvait être que la menue monnaie de Mme Miolan-Carvalho.
Vous souvient-il du
choeur des Bohémiens ? Quelle allure pittoresque ils vous ont ! Et que vous
semble de ces couplets si lestement troussés :« Rira bien qui rira le dernier.
» Ils pétillent d'esprit, et d'un esprit qui n'a rien de composé ni de banal.
II n'est pas douteux
que la Reine Topaze, inconnue de la génération actuelle, attirerait,
aujourd'hui comme autrefois, un public nombreux à l'Opéra-Comique ; car elles
sont loin d'être démodées, ces vieilles pièces que l'on s'obstine à ne pas nous
faire entendre ! Il en va de la Reine Topaze comme du Cheval de
Bronze, comme de la Sirène et de tant d'autres partitions d'Auber, qui
languissent dans les cartons. Les chanteurs changent, les partitions sont
rivées au répertoire courant, et, à part Galatée et les Noces de
Jeannette, tout ce qu'a produit Massé a disparu — et nous n'avons pas
besoin d'ajouter que c'est grand dommage. Mais avant de parler de son œuvre
dernière, la Nuit de Cléopâtre, qui a été son Africaine, à lui,
puisqu'il n'a pas eu, comme son illustre devancier Meyerbeer, le bonheur
d'assister à la première représentation de cette œuvre, éclose sur un lit de
souffrance, rectifions certains points de sa biographie, éparse dans
d'inexactes notes et qu'il convient de relever au passage. Nous sommes d'autant
plus autorisés à le faire, que c'est du gendre de Victor Massé, notre excellent
et si distingué confrère du Figaro, M. Philippe Gille, que nous tenons
ces précieux renseignements. « Gardez-vous bien, nous écrit-il, si vous trouvez
au nombre des œuvres citées de Victor Massé, une certaine Favorite et l'Esclave,
de la mentionner : Massé n'en a jamais entendu parler et il n'a jamais su d'où
provenait cette erreur d'attribution. »
Voilà un fait désormais
établi et que nous signalons à l'attention de notre confrère Pougin,l e
continuateur de l'universelle Biographie des Musiciens, de Fétis, où
tant de lacunes regrettables existent et où tant de portraits quelconques
s'étalent dans leur parfaite insignifiance.
On a prétendu, de même,
dans nous ne savons quelle revue musicale, que le chœur du premier acte des Saisons
: le chœur des Paysans, paraissait emprunté à un autre chœur connu, également
de paysans, du premier acte de Faust. Comment Massé aurait-il pu
commettre ce larcin, puisque le Faust de Gounod n'était pas né encore ? Les
Saisons l'ont précédé de plusieurs années. Du reste, des compositeurs de
cette trempe ne s'empruntent pas : ils se rencontrent, et c'est tout.
Victor Massé mourut le
5 juillet 1884, et ce ne fut que le 25 avril 1885, près d'un an après, que
l'Opéra-Comique joua la Nuit de Cléopâtre. Jamais il n'y voulut
travailler que lorsque la maladie lui laissa des jours de calme et que son
cerveau n'était point troublé.
— Je veux, disait-il,
faire une partition bien portante.
Et il la fit.
La Nuit de Cléopâtre avait été repoussée à
l'Opéra par Vaucorbeil, qui était pourtant de nature accueillante, à cause d'Aida,
présentant la similitude de couleurs égyptiennes, et Aïda était alors en
pleine vogue.
Cette Nuit de
Cléopâtre, Victor Massé l'avait incessamment présente à ses yeux, et elle
bourdonnait obstinément à ses oreilles dans ses propres nuits d'insomnie. Vous
en connaissez l'affabulation, car nous en avons fait autrefois l'analyse. En
deux mots, on la peut résumer. — Manassès, un jeune téméraire que la troublante
beauté de Cléopâtre a rendu comme fou, risque sa vie pour la voir de plus près.
La future reine d'Egypte et de Chypre s'ennuie, car son cher Antoine, le grand
conquérant, est loin d'elle, occupé sans doute à faire rendre gorge aux
Parthes. Le pêcheur Manassès, oui, Manassès, ce ver de terre amoureux d'une
étoile, est comme le Zéphoris de Si j'étais roi : un simple pêcheur, — a
surpris Cléopâtre au bain. Et elle de s'écrier, dans un mouvement de pitié où
la luxure se mêle :
Tu devrais mourir là,
sur-le-champ, de ma main !
Mais tu dis que tu
m'aimes
Soit ! tu mourras
demain !
Et ainsi sera fait. La
nuit d'extase n'aura pas de lendemain. L'air de Cléopâtre et le duo qui suit
sont de pures merveilles de style et de passion. Mme Heilbron et Talazac, l'un
et l'autre sitôt disparus, chantaient cette scène avec une admirable flamme.
L'Introduction
symphonique et l'Invocation à Osiris, d'une ordonnance parfaite, sont, à elles
seules, un poème de grâce attendrie et de charme berceur. Manassès ne serait
pas un sérieux jeteur de filets si, sous le ciel d'Orient, quelque barcarolle
n'errait parfois sur ses lèvres. Il obéit avec délices à la tradition en
murmurant : Sur les flots bleus, glisse ma voile, d'un si caressant
rythme mélodique. Victor Massé était un intuitif : il trouvait presque toujours
et en toutes choses la note juste. La mort l'a surpris trop tôt pour qu'il ait
pu donner la pleine mesure de son talent. C'est cruel à dire, racontait naguère
un de ses plus intimes amis, mort lui-même depuis, mais les six dernières
années de Victor Massé, ce long temps marqué par des crises de chaque jour,
furent peut-être les plus heureuses de sa vie. Il ne courait plus le cachet,
comme au temps de sa jeunesse ; il n'était plus contraint à tenir l'emploi de
chef des chœurs à l'Opéra, poste honorifique puisque Hérold l'avait illustré de
son génie, mais qui, néanmoins, condamne un musicien à une triste servitude. Le
mal, en l'arrachant à ces fonctions envahissantes, avait, pour ainsi dire,
rendu Massé à lui-même. Il pouvait enfin dépenser tout ce qui lui restait de
vie pour son art. « A mesure que le corps s'écroulait, la pensée, plus
libre que jadis, s'élevait vers les hauteurs sereines ; aucun souci de la vie
matérielle ne venait plus l'arracher à ses rêves. Le malade faisait pitié à
voir, mais le musicien offrait un spectacle admirable de volonté et de passion
». Victor Massé s'est éteint dans la plénitude de sa pensée. Il avait succédé,
à l'Institut, à Auber, dont il prononça l'éloge dans un discours de haut savoir
et d'un irréprochable tour littéraire.
Ély-Edmond Grimard
(1842-1900, critique
musical)
in Les Annales
politiques et littéraires, octobre 1897

|
Charles Renaud de Vilbac
(lithographie d'Alexandre Alophe, coll. BNF, Estampes) DR.
|
Charles RENAUD de VILBAC (1829-1884)
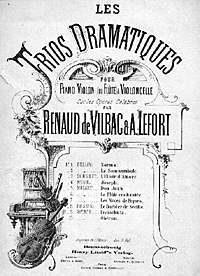 |
Page de garde des Trios dramatiques pour piano, violon (ou flûte) et violoncelle, sur des opéras célèbres de Charles Renaud de Vilbac et Augustin Lefort. Henry Littoff éditeur
( coll. DHM )
|
Fils d'un capitaine au Corps Royal d'Etat-Major, Alphonse Zoé Charles RENAUD de VILBAC est né le 3 juin 1829 à Montpellier. Entré à l’âgé de 13 ans au Conservatoire national supérieur de musique de Paris, il suivit les classes de Benoist (orgue) et d'Halévy (composition). Peu après l’anniversaire de ses 15 ans! il remportait en 1844 le deuxième Premier Grand Prix de Rome, avec sa cantate Le Renégat de Tanger, sur un poème du marquis de Pastoret. Il avait d'autant plus de mérite que, comme l'écrivait son père le 15 juin 1844 au Secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts1:
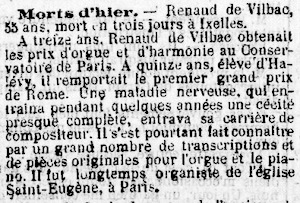
|
La Croix, 23 mars 1884 (DR.)
|
Né aveugle, mon fils Renaud de Vilbac fut opéré deux fois de la cataracte, à 4 et à 5 ans; ses yeux sont restés de longues années dans un état de mobilité effrayante qui l'empêchait de discerner les objets. Sa vue s'est assurée et, sans être bonne, elle sert surtout d'un côté: un il est encore un peu voilé par des filaments cataracteux. Mon fils a commencé à lire la musique il y a deux ou trois ans; il écrit maintenant d'une manière lisible, mais il ne peut distinguer ni former les caractères de l'écriture ordinaire.
Après un séjour de 13 mois à Rome, Renaud de Vilbac rentrait à Paris et fit entendre une ouverture de sa composition lors de la séance annuelle de l'Académie des Beaux-Arts du 3 octobre 1847. Quelque temps plus tard, en 1855, il devenait le premier titulaire du grand-orgue Merklin-Schütz, tout nouvellement installé dans l'église Saint-Eugène-Sainte-Cécile, à Paris IX°. C’est l'architecte Lusson, sur des dessins de Boileau, qui venait d’achever l’édifice. Cet instrument de 33 jeux, répartis sur 3 claviers et un pédalier, auparavant, avait été utilisé en démonstration à l'Exposition Universelle de 1855 durant quelques mois. C’est lui même d’ailleurs, en compagnie de Georges Schmitt, l’organiste de St-Sulpice, qui l’inaugura le 9 mai 1856. Il abandonnera ce poste d'organiste en 1871, pour le laisser à Raoul Pugno, plus connu d'ailleurs comme pianiste et pédagogue que comme organiste. En 1880 Charles Renaud de Vilbac partageait avec Ferdinand Poise, ainsi qu'un peintre et un sculpteur, le prix Trémont, ce qui leur valut chacun une somme de 500 francs.
On connaît de ce compositeur une opérette en un acte écrite sur des paroles de M. de Léris (Alfred Desroziers), Au clair de lune, donnée au Théâtre des Bouffes-parisiens (Paris) le 4 septembre 1857, un opéra-bouffe en un acte Don Almanzor, écrit sur un texte de MM. Eugène Labat et Louis Ulbach, également donné à Paris, au Théâtre Lyrique, le 16 avril 1858; des pièces pour orchestre, pour piano : Menuet Louis XV op. 31, Ophélia (nocturne), Petite Fantaisie sur la mélodie de Tissot, Lili-Polka, Petite poupée chérie (valse), Caresses enfantines (mazurka), Echo du désert (rêverie arabe), Sonnez clairons (marche militaire), Caprice Styrien, Fior di speranza (romance sans paroles)..., ou encore pour orgue, avec notamment un Prélude en mi bémol. On lui doit aussi des transcriptions, dont la Danse macabre de Saint-Saëns et plusieurs autres écrites avec la collaboration d'Augustin Lefort, professeur de violon au Conservatoire de Paris.
Il est décédé à Ixelles, près de Bruxelles (Belgique), le 19 mars 1884.
Denis HAVARD DE LA MONTAGNE
____________
1) Communication inédite de M. Bertrand Malaud, qui précise que les huit autres candidats qui concoururent lors de la première épreuve du Prix de Rome, du samedi 22 au vendredi 28 juin, étaient : J.J. Gautier, E. Ortolan, A. Coinchon, V. Massé, C. Duvernoy, A. Laurent, E. Membrée et H. Mertens. Seuls Gautier, Massé, Duvernoy, Laurent, Mertens et de Vilbac furent admis à l'épreuve définitive. [ Retour ]
 Renaud de Vilbac, Ay Chiquita - Robe d'azur, chanson n° 1 des Arabesques, op. 32, pièce pour piano écrite sur les thèmes ornés et variés des chansons espagnoles de Sebastian Yradier, dédicacée "à M. F. Le Couppey" (Paris, Au Ménestrel/Heugel et Cie). Fichier audio par Max Méreaux (DR.)
Renaud de Vilbac, Ay Chiquita - Robe d'azur, chanson n° 1 des Arabesques, op. 32, pièce pour piano écrite sur les thèmes ornés et variés des chansons espagnoles de Sebastian Yradier, dédicacée "à M. F. Le Couppey" (Paris, Au Ménestrel/Heugel et Cie). Fichier audio par Max Méreaux (DR.)
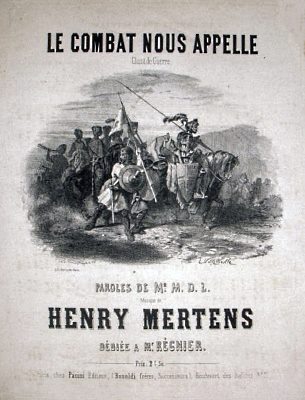
|
Henri Mertens, Le Combat nous appelle, chant de guerre
dédié à M. Régnier, paroles de M.D.L, Paris, 1846, Pacini éditeur
(coll. privée) DR.
|
Henri MERTENS (1819-1873)
On
sait peu de choses sur ce musicien : son œuvre n’est pas connue et jusqu'à
ce jour on ignorait même sa date de décès. Il n'est mentionné dans aucun
dictionnaire ou ouvrage spécialisé, mais nos recherches nous permettent d'en
dire maintenant davantage sur ce lauréat du Prix de Rome injustement oublié.
Jean-Henri
Mertens est né à Paris le 3 janvier 1819, fils de Jean-Henri-Guillaume Mertens
et de Jeanne-Marie-Madeleine Warnimont. Son père, mort le 8 août 1840, sous la
Restauration était « musicien aux Gardes du Corps du Roi » dans la
Compagnie de Noailles. C'est ainsi qu'enfant, Henri entra chez les Pages de la
Chapelle du Roi, où on le repère en 1830. Lesueur et Cherubini en étaient alors
les surintendants et Plantade le maître de chapelle. Les Pages, au nombre de
six, étaient placés sous la direction de Jadin « gouverneur, maître des
Pages », aidé de Leroy, précepteur. A cette même époque, il avait déjà
rejoint le Conservatoire de Paris (octobre 1829). Dès la première année scolaire,
alors âgé de 11 ans, il obtenait un 1er accessit de solfège (1830)
dans la classe d’Alexandre Goblin, devant Jules Pasdeloup, le futur fondateur
des célèbres concerts du même nom ! Un second prix lui sera décerné en
1832 et un premier l’année suivante. En octobre 1830, il rentrait dans la
classe de clavier de Louis Flèche et quelque temps plus tard dans celle de
composition de Carafa. C’est lui qui l’amena au Concours de Rome, pour lequel
Mertens se présentait la première fois en 1844. Sa cantate Le Renégat
d’Alger, écrite sur des paroles du marquis de Pastoret, lui valut un 1er
second Grand Prix, derrière Victor Massé et Charles Renaud de Vilbac. Il se présenta à
nouveau en 1845 et 1846, mais bien qu’il fût admis à concourir à l’épreuve
définitive il ne fut pas récompensé.
Ce
qu’Henri Mertens advint après 1846 n’est pas connu totalement, néanmoins l'on
sait qu'il se livra à l'enseignement, notamment en Algérie. En effet, mort à
l'hôpital militaire de Constantine le 15 août 1873 à onze heures du matin, à l'âge
de 54 ans, l'acte de décès dressé le lendemain à la mairie de cette ville le
déclare « professeur de musique ». L'une de ses sœurs, Laurence
Mertens (1821-1865), célibataire, quant à elle, enseignait le piano à Paris.
Une autre, prénommée Jeanne (1824-1901), célibataire aussi, exerça à Paris la
profession d'institutrice et la dernière, Elisa, née en 1832, fut mariée en
1832 à Séraphin Dardenne, rentier de son état.
On
sait également que Mertens continua de se livrer à la composition. Il est en
effet l'auteur de pages pour le piano : Vive Henri IV, quadrille
(Paris, J. Meissonnier, 1843), Ouraïda, fantaisie, op. 22 (Paris,
Fleury, 1856), Noël ! Noël !, petite fantaisie sur Adeste
fideles (Paris, Fleury, 1855), Les Oeufs de Pâques, petite fantaisie
très facile (Paris, Fleury, 1857) ; de pièces pour la voix : Le
Combat nous appelle, chant de guerre, (Paris, Pacini, 1846) et de musique
religieuse : 7 Morceaux brillants et faciles pour orgue ou
harmonium : Entrée, 3 Offertoires, Elévation, Communion, Sortie, op. 20
(Paris, Fleury, 1856), Cent Noëls courts, faciles et choisis... pour
versets, antiennes..., en 14 séries, pour orgue ou harmonium, en 2 suites
(Paris, Fleury, 1856), 50 Airs de cantiques choisis et brillants d'une
exécution facile, arrangés sans paroles, pour orgue ou harmonium et divisés en
2 suites (Paris, Fleury, 1857), Petit Offertoire pour le temps pascal sur
l'hymne O Filii et filiae, pour harmonium (Paris, Fleury, 1857), 3
Offertoires... pour les fêtes de l'armée : Entrée, Offertoire, Sortie
pour les Offices funèbres, pour orgue ou harmonium (Paris, Fleury, 1859).
Bertrand
Malaud, le biographe de Louis Deffès, signale l’existence d’une dame Mertens,
qui, d’après le livre de régie de l’Opéra-Comique, fit partie (avec Mmes
Galli-Marié, Chevrier, Decroix, Feitlinger, Werhlé, et MM. Engel, Morlet,
Barnolt, Bernard, Collin, Davoust et Pamart) de la distribution des Noces de
Fernande, de V. Sardou, E. de Narjac et L. Deffès, dont la première
représentation à l’Opéra-Comique eut lieu le mardi 19 novembre 1878. Mais,
cette chanteuse ne semble pas être de la même famille que notre Prix de Rome.
Denis Havard de la Montagne
(2001, mise à jour : avril 2017)
1845
Pas de premier prix
Eugène ORTOLAN (1824–1891)
Ministre plénipotentiaire, docteur en droit, jurisconsulte, lauréat du Grand Prix de Rome de composition musicale, compositeur d’opérettes, voilà un homme qui sut habilement mêler la rigueur du droit et la fantaisie musicale !
Né à Paris le 1er avril 1824, Eugène Ortolan était issu d’une famille provençale de juristes : son grand-père avait été juge de paix à Toulon et son père professeur à la faculté de droit de Paris. Ce dernier, Joseph-Louis-Elzéar, né le 21 août 1802 à Toulon, décédé en 1873, fit ses études de droit à Aix puis à Paris et après l’obtention de son doctorat en 1829, fut notamment secrétaire général au parquet de Paris (1830), puis titulaire de la chair de législation pénale comparée à la faculté de droit de Paris et membre du Conseil supérieur de l’Instruction publique. Jurisconsulte distingué, il a laissé une œuvre considérable et a notamment été décoré de l’ ordre de Saint-Jacques de l’Epée du Portugal pour la rédaction du nouveau code portugais. Plusieurs de ses ouvrages font autorité : Cours public d’histoire du droit politique et constitutionnel des peuples de l’Europe, avec le tableau de leur organisation actuelle (Paris, Franjat aîné, 1831), Le Ministère public en France, traité et code de son organisation, de sa compétence et de ses fonctions dans l’ordre politique, judiciaire et administratif (Paris, Franjat aîné, 1831, 2 vol.), Histoire de la législation romaine depuis son origine jusqu’à la législation moderne, suivie de l’explication historique des Instituts de Justinien (Paris, Joubert, 1835, nombreuses rééditions ultérieures), Cours de législation pénale comparée (Paris, Joubert, plusieurs livraisons à partir de 1838), Eléments du droit pénal (1856)… Cultivant la littérature, Joseph Ortolan a écrit également un volume de poésies : Enfantines moralités (Paris, C. Gosselin, 1845) et un ouvrage sur Dante : Les pénalités de l’Enfer de Dante, suivies d’une étude sur Brunetto Latini, apprécié comme le maître de Dante (Paris, H. Plon, 1873). Les villes de Paris et de Toulon lui ont rendu hommage en donnant son nom à l’une de leurs rues : rue Ortolan, dans le cinquième arrondissement parisien (ouverte en 1884) et avenue Joseph Ortolan à Toulon.
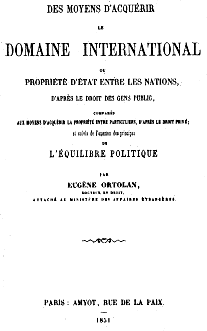 |
Page de couverture du livre de droit
écrit par Eugène Ortolan
( Paris, Amyot, 1851 )
|
Jean-Félicité-Théodore Ortolan, né le 12 janvier 1808 à Toulon, mort en 1874, frère de Joseph et oncle d’Eugène, eut aussi quelques succès en droit maritime, avec un ouvrage intitulé : Règles internationales et diplomatie de la mer (Paris, impr. de Cosse et N. Delamotte, 1845, 2 vol.), réédité à plusieurs reprises, notamment en 1864 (Paris, H. Plon) sous le titre de : Règles internationales et diplomatie de la mer par Théodore Ortolan, capitaine de vaisseau, officier de la Légion d’honneur, quatrième édition mise en harmonie avec le dernier état des traités, suivie d’un appendice spécial contenant, avec les actes du Congrès de Paris de 1856, les principaux documents officiels relatifs à la dernière guerre d’Orient et à la guerre actuelle d’Amérique. Entré dans la marine en 1822, nommé capitaine de frégate en 1848 puis capitaine de vaisseau en 1862, retraité en 1868, commissaire impérial au conseil de guerre et de révision de Toulon, Théodore Ortolan a également publié des Lettres inédites du bailli de Suffren (Paris, [s.n.], 1859, 39 p.)
Dans un tel milieu, Eugène Ortolan ne pouvait échapper à une carrière juridique, même si ses goûts le portait vers la musique. Il mena ainsi de front des études de droit à la faculté de droit de Paris, qui furent couronnées par un doctorat, et des études de musique au Conservatoire de musique et de déclamation de Paris. Elève d’Halévy pour le contrepoint, et de Berton pour la composition, Eugène Ortolan, entre ses deux licences de droit, se présenta en 1845 au concours de composition musicale de l’Institut de France et remporta le premier Second Grand Prix de Rome, seule récompense décernée cette année là. Le poème choisi était Imogine de Vieillard (scène à 3 voix).
Reçu docteur en droit en 1849, spécialisé en droit international, il entre cette même année au Ministère des Affaires étrangères et y fait une carrière de consul général et ministre plénipotentiaire, qui l’oblige à beaucoup voyager, notamment en Belgique et en Russie. Sous le Second Empire, il n'a pas souvent le loisir de s'adonner à la musique, son Ministère d'emploi ayant fort à faire durant cette période conflictuelle avec plusieurs puissances étrangères : guerre de Crimée avec l'Angleterre contre la Russie, pour sauvegarder l'empire ottoman (1854-56), guerre d'Italie pour conserver l'indépendance de ce pays menacée par l'Autriche (1859), expédition en Syrie afin de protéger les chrétiens Maronites contre les Druses (juillet 1860), expédition en Chine aux côtés de l'Angleterre (octobre 1860), guerre de Cochinchine causée par l'assassinat de missionnaires français (1861-62), guerre du Mexique à la suite de violations d'intérêts de résidents français dans ce pays (1863), guerre contre l'Allemagne (1870-71)…Le 24 décembre 1881, il regagne son dernier poste au consulat de Melbourne où il est nommé consul général, avant de faire valoir ses droits à la retraite le 1er mai 1884.1
C’est sans doute en raison de sa carrière diplomatique qu’Eugène Ortolan a peu composé : quelques mélodies, qualifiées par Fétis " d’un joli tour et d’un heureux caractère ", des morceaux symphoniques, un oratorio Tobie, écrit sur un poème de Léon Halévy, exécuté à Versailles le jeudi saint 16 avril 1867, et surtout deux ouvrages théâtraux qui lui valurent quelques succès : l’opéra-comique en deux actes Lisette, créé au Théâtre-Lyrique du boulevard du Temple le mardi 10 avril 1855 et l’opérette en un acte La Momie de Roscoco, interprétée pour la première fois le 27 juillet 1857 aux Bouffes-Parisiens.
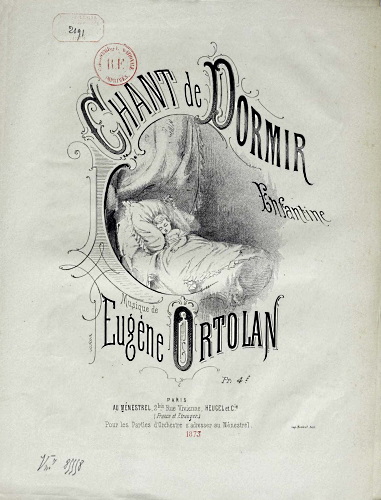
|
Eugène Ortolan, Chant de dormir,
pour voix de soprano et piano, poésie d'Elzéar Ortolan
Partition complète au format PDF
(Paris, Au Ménestrel, 1873/coll. BnF-Gallica) DR.
 Fichier audio par Max Méreaux (DR.) Fichier audio par Max Méreaux (DR.)
|
Lisette, écrit sur un livret de Thomas Sauvage, interprété par Mlles Girard, " vive, mutine, douée d’une voix charmante et d’une diction pleine de verve " et Chevalier, et MM. Crambade (Germain), Legrand, Colson, qui dans le rôle du fat y dépose " l’empreinte de son talent si distingué ", Adam et Vasseur, raconte l’histoire de Lisette, jeune fille au service d’une comtesse, qui pour rendre service à sa maîtresse la supplée lors d’un rendez-vous galant avec un fat. L’amoureux de Lisette (Germain), tenu à l’écart de cette supercherie, par dépit s’engage comme soldat du roi, devient capitaine et à son tour papillonne autour de la comtesse… qui à nouveau demande à Lisette de se faire passer pour elle à un second rendez-vous galant. Finalement la fidélité de Germain et la vertu de Lisette éclatent au grand jour ! On pouvait lire dans " L’Univers musical " du 15 avril 1855 : " Tout cela n’est pas très neuf, mais il y a des mots, des scènes et de jolies situations. La musique de M. Ortolan n’a de jeune qu’une certaine incertitude, car elle procède généralement d’une inspiration et de tendances sévères. Cela ne veut pas dire qu’elle manque de mélodie, bien au contraire, elle est constamment limpide, colorée, facile… " La critique musicale saluait plus particulièrement " l’ouverture, dont la facture savante décèle de sérieuses études ; le premier chœur en sol avec arpèges de flûte d’une nuance finement pastorale ; le duo de Germain et de Lisette : Ah ! le bon billet ; puis l’air de Lisette : En ces cieux, votre présence, auquel l’accompagnement de harpe donne un caractère doux et voilé ", mais reprochait au compositeur sa manière un peu trop savante d’écrire la musique, l’encourageant à " arriver au genre simple, le plus difficile, le plus estimable de tous ", à l’image de Grétry, Monsigny et Boïeldieu qui n’ont pas dédaigné de s’y tenir.
La Momie de Roscoco fut créée le même soir que La Demoiselle en Loterie d’Offenbach (livret de Jaime fils). Cette opérette, écrite sur des paroles d’Emile de Najac, conte l’histoire du tuteur trompé par sa pupille maintes fois reprise dans les vaudevilles. Léon Sorel, dans " La France musicale " du 2 août 1857, écrivait : " La musique de M. Eugène Ortolan est bien faite, mélodieuse, facile. L’ouverture, le duo de Gorgoyo et de Roscoco, la romance de la jeune fille, la sérénade du ténor et le grand quatuor final ont été également remarqués et applaudis. C’est un nouveau succès pour l’auteur de Lisette ; c’est pour l’avenir la promesse d’un talent agréable." Quant aux acteurs, voici ce que ce même Sorel disait : " L’exécution de la pièce est satisfaisante. M. Bauce, qui débutait, a une bonne voix de baryton, et joue convenablement ; M. Caillat est toujours excellent dans les rôles d’amoureux dupé ; M. Godefroy, encore un débutant, a une jolie voix de ténor et beaucoup d’aisance en scène. Mlle Coraly Guffroy ne nous paraît pas en progrès ; elle n’a pas grandi, ce qui était nécessaire ; elle a maigri, ce qui était difficile et inutile ; sa voix est devenue criarde, et la comédienne n’est pas très fort au-dessus de la chanteuse ; puis le voisinage de Mlle Tautin est chose dangereuse ! "
En 1877, Eugène Ortolan fit partie du jury pour le grand concours international pour la composition de la cantate jubilaire du pape Pie IX, organisé par les catholiques de Lille ; 39 partitions furent soumises.
Jurisconsulte réputé tout comme son père, Eugène Ortolan est l’auteur d’un ouvrage de droit qui fit autorité à l’époque : Des moyens d’acquérir le domaine international ou propriété d’état entre les nations, d’après le droit des gens public, comparés aux moyens d’acquérir la propriété entre particuliers, d’après le droit privé, et suivis de l’examen des principes de l’équilibre politique (Paris, Amyot, 1851). Officier de la Légion d’honneur, chevalier de l’ordre de Léopold de Belgique, commandeur de l’ordre de Saint-Stanislas de Russie, il est décédé le 11 mai 1891 à Paris, dans son appartement du numéro 3 de la rue Soufflot, laissant une veuve, Marie-Egérie Dufeu, alors âgée de 50 ans. Celle-ci, épousée sur le tard le 4 septembre 1886 à Paris, alors qu'il avait fêté ses 62 ans, était née le 27 février 1841 à Marseille, du mariage (1833) d'Antoine Dufeu, négociant ayant des origines orientales, et d'Adèle Naydorff. Lors de cette cérémonie de mariage à la Mairie du neuvième arrondissement parisien, les quatre témoins et amis des familles étaient : le comte Antoine Roselly de Lorgues (1805-1898), homme de lettres, américaniste éminent, officier de la Légion d'honneur ; Charles de Lesseps (1840-1923), ingénieur, vice-président du Conseil d'administration des Compagnies de Suez et de Panama, officier de la Légion d'honneur, fils de Ferdinand de Lesseps (1805-1894), constructeur du Canal de Suez ; Charles Labrousse (1828-1898), lieutenant de vaisseau, ingénieur civil, spécialiste de la navigation aérienne, chevalier de la Légion d'honneur ; et Edouard Dufeu (1836-1900), frère de la mariée, artiste peintre et graveur, expose au salon des artistes français 1860 à 1890.
Bien que portant le même patronyme, il ne faut pas rattacher à cette famille le Révérend Père Théophile Ortolan. Né le 20 avril 1861 à Saint-Tropez (Var), mort le 5 décembre 1937 à Metz, il est en effet le fils d'un commerçant tropézien (Louis) et de Rose Guisolphe. Ordonné prêtre en 1885 chez les Oblats de Marie Immaculée (O.M.I.), le R.P. Ortolan, docteur en théologie et en droit canonique, lauréat de l’Institut catholique de Paris, membre de l’Académie de Saint-Raymond-de-Pennafort (Montréal), est l’auteur de nombreux ouvrages scientifiques et religieux : Astronomie et théologie, ou l’erreur géocentrique, la pluralité des mondes habités et le dogme de l’Incarnation (Paris, Delhomme et Briguet, 1894), Vie et matière, ou matérialisme et spiritualisme en présence de la cristallogénie (Paris, Bloud et Barral, 1898), Savants et chrétiens, études sur l’origine et la filiation des sciences (Paris, Delhomme et Briguet, 1898), Le levier d’Archimède, ou la mécanique céleste et le céleste mécanicien (Paris, Bloud et Barral, 1899), Diplomate et soldat. Mgr Casanelli d’Istria, évêque d’Ajaccio, 1794-1869 (Paris, Bloud et Barral, 1900, 2 vol.), La fausse science contemporaine et les mystères d’outre-tombe (Paris, Bloud et Barral, 1900). On lui doit également une histoire de son ordre longuement racontée dans Les Oblats de Marie Immaculée durant le premier siècle de leur existence (Paris, Lethielleux, 1914-1932, 4 vol.) et un ouvrage touchant la musique intitulé Matérialistes et musiciens (Paris, Bloud et Barral, 1898).
Denis HAVARD DE LA MONTAGNE
(2003, mise à jour : novembre 2019)
____________
1) Nous sommes reconnaissant à Mme Agnès Moinet-Le Menn, conservateur du patrimoine à la direction des archives du Ministère des Affaires étrangères, d'avoir bien voulu nous communiquer le détail de la carrière d'Eugène Ortolan : attaché surnuméraire à la direction des Archives et chancellerie du Ministère des Affaires étrangères (15 mars 1849), attaché surnuméraire à la direction des Consulats et Affaires commerciales (26 avril 1849), élève-consul (24 novembre 1852), attaché payé (15 janvier 1854), commis principal (31 décembre 1860), rédacteur (31 décembre 1866), consul général, chargé de travaux particuliers à la direction des Consulats et Affaires commerciales (marques de fabrique, propriété littéraire et artistique) 1er février 1880, membre du comité consultatif du Contentieux (26 avril 1880), consul général, chargé du consulat de Melbourne (24 décembre 1881), admis à faire valoir ses droits à la retraite (1er mai 1884). [ Retour ]
1846
Léon GASTINEL (1823-1906)
Article, illustration et fichier audio sur cette page spécifique.
1847
 |
Buste de Louis Deffès sculpté par M. Fabre sur la stèle du monument funéraire inaugué le 14 juillet 1904 au cimetière de Terre-Cabade de Toulouse
( Coll. Bertrand Malaud )
|
Louis DEFFÈS (1819-1900)
Article sur une page spécifique.
Eugène CRÉVECOEUR (1819-1891)
Le
plus grand mérite d'Eugène Crévecoeur a été d’enseigner la composition à
Edouard Lalo. L’auteur du Roi d’Ys, au moment où il suivait en auditeur
la classe de violon d’Habeneck au Conservatoire de musique et de déclamation de
Paris, travaillait en effet la composition avec le pianiste Julius Schulhoff et
Crévecoeur, alors répétiteur de Colet dans sa classe harmonie. Cela se passait
en 1843 et Crévecoeur, son aîné de 4 ans, était lui-même étudiant dans cet établissement.
Il se peut que leur chemin s’étaient déjà croisés dans la région du nord de la
France. On sait en effet que Lalo, né à Lille en 1823, commença par étudier le
violon et le violoncelle au Conservatoire de sa ville natale et que Crévecoeur
est originaire de la même région.
C’est
le 12 janvier 1819 à Calais (Pas-de-Calais) que Joseph-Eugène vint au monde du
légitime mariage de Pierre-Louis Crévecoeur,
capitaine de navire, et de Suzanne Framery. On ignore où notre futur lauréat du
Prix de Rome débuta ses études musicales. Ce dont on est certain, c’est qu’au
début des années 1840 il était admis au Conservatoire royal de musique et de
déclamation de Paris, où il suivait notamment la classe d’harmonie d’Hippolyte
Colet. En juillet 1844 il recevait un deuxième prix d'harmonie vocale et
instrumentale partagé avec Mangeant et l'année suivante décrochait le premier
prix décerné à l’unanimité, avec deux épreuves : une basse donnée pour
être chiffrée et réalisée à quatre parties vocales (style sévère et fuguée) et
un chant donné pour être écrit à quatre parties instrumentales (composition
dans le genre libre). Deux années plus tard, il se présentait pour la première
fois au Concours de composition musicale de l’Institut de France. Classé 4ème
au terme du concours d’essai, avec un sujet de fugue soumis par Adolphe Adam,
il prit part aux épreuves définitives qui consistaient en la mise en musique
(pièce lyrique à 3 voix) d’un poème de Léon Halévy : L’Ange et Tobie.
Déclaré Second Prix par les membres de l’Académie des Beaux-Arts réunis en
assemblée plénière, il reçut le reçut le dimanche 21 novembre 1847 des mains de
M. de Kératry, pair de France, vice-président de la Commission spéciale des
Théâtres royaux et du Conservatoire royal de musique, lors de distribution
solennelle des prix du Conservatoire.

|

|
Devoirs d'harmonie vocale de Crévecoeur lors de l’obtention de son 1er prix d'harmonie en juillet 1845, in la réédition en 1858 du Traité de Colet.
 Fichier audio par Max Méreaux (DR.) Fichier audio par Max Méreaux (DR.)
( Bnf/Gallica
)
|

|

|
Devoir d'harmonie instrumentale de Crévecoeur lors de l’obtention de son 1er prix d'harmonie en juillet 1845, in la réédition en 1858 du Traité de Colet.
 Fichier audio par Max Méreaux (DR.) Fichier audio par Max Méreaux (DR.)
( Bnf/Gallica
)
|
 |
Édouard Lalo
(1823-1892)
élève de Crévecoeur
( photo Lejeune ) |
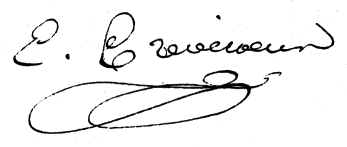
|
Signature autographe, 1881 (DR.)
|
Après
l’obtention de son Prix de Rome, en 1849 Crévecoeur donnait des cours
particuliers d'harmonie à Charles Lecocq, futur grand compositeur d'opérettes
dans la lignée d'Offenbach, avant son entrée au Conservatoire de Paris. Plus
tard, le 10 mai 1851, alors domicilié 7 rue de La-Grange-aux-Belles à Paris, on
le trouve en compagnie d'Adolphe Blanc (1828-1885), violoniste, compositeur et
futur chef d'orchestre au Théâtre Lyrique, assistant le Commissaire-priseur
chargé de l'estimation des livres et partitions de musique pour dresser
l'inventaire après décès de son maître Hippolyte Colet dans son appartement de
la rue Blanche. Vers cette même époque il travaillait quelque temps au Théâtre
de la Porte-Saint-Martin à Paris. Mais, "…Crévecoeur – dont le nom assez
significatif est presque un symbole, – allait, bientôt désabusé, abandonner les
abruptes régions de l'art pour s'établir, dans les plaines favorisées du Nord,
marchand de dentelles." [H. Malherbe]. En effet, après son mariage avec
Marie-Catherine Jearsin, qui eut lieu à Paris le 11 mars 1858 en l'église
Saint-Martin-des-Champs, il retournait dans sa ville natale à Calais pour se
livrer au commerce. C'est d'ailleurs dans cette sous-préfecture du
Pas-de-Calais que naissait l'année suivante, le 31 janvier 1859, son fils
Eugène
qui poursuivra les activités commerciales de son père dans sa fabrique de
tulle.
Eugène
Crévecoeur est décédé à Calais, le 6 décembre 1891, à l'âge de 72 ans. On lui
connaît 4 Sonates pour piano et violon : n° 1, op. 10, en sol – n°
2, op. 11, en ut mineur – n° 3, op. 12, en la – n° 4, op. 13, en sol, publiées
en 1879 chez l'éditeur parisien E. et A. Girod, ainsi que la réédition en 1858
(s.l., s.n.) du Traité spécial de l'accompagnement pratique au piano ou
Partimenti de son maître Hippolyte Colet, dont il avait assuré la révision
et correction.
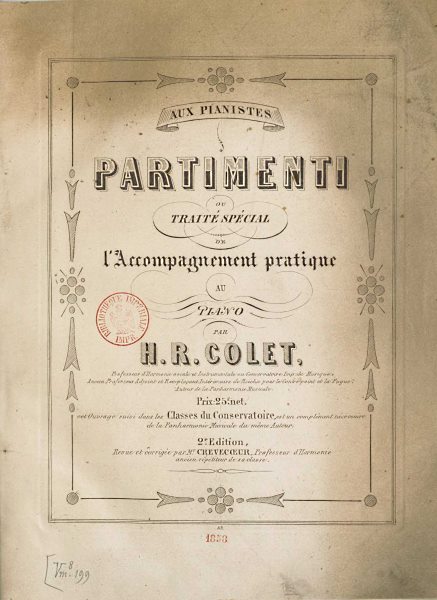
|
Couverture de la réédition (1858) par Crévecoeur du Traité spécial de l'Accompagnement pratique au piano d'Hippolyte Colet
(Bnf/Gallica)
|
Au
Salon de 1888 le sculpteur Emile Chatrousse (1829-1896), auquel on doit
notamment des statues ornant le Louvre, les Tuileries, le Théâtre du Châtelet,
l'Hôtel de Ville de Paris, et des bustes placés à l'Institut de France, au
Palais de justice, à l'Opéra et aux Musées Carnavalet et de Versailles, avait
exposé une statue en marbre intitulée « M. Eugène Crévecoeur ». A ce
jour, la destinée de cette sculpture ne nous est pas connue.
Denis Havard de la Montagne
(fév. 2007,
révision : aout 2017)
1848
Jules DUPRATO
Article détaillé dans cette page spécifique.
Auguste BAZILLE (1828-1891)
 |
Auguste Bazille (1828-1891) vers 1880, organiste
de Ste-Elisabeth.
( Détail, photo P. Petit, BNF Richelieu )
|
Le 3 février 1880 une catastrophe ferroviaire survenue dans la banlieue parisienne, à Clichy-Levallois, faisait 13 morts et une quarantaine de blessés. Plusieurs artistes figuraient parmi ces derniers : Mme Collin, femme du chanteur de l’Opéra-Comique et sœur de Melle Fiocre, de l’Opéra ; MM. Haymé et Joly, des Bouffes et Auguste Bazille, alors premier chef du chant à l’Opéra-comique, qui rejoignait son domicile, non loin de Paris, situé à Colombes. Quelque temps auparavant, le samedi 5 juin 1875, c’est lui qui avait joué les obsèques de Bizet aux claviers du grand-orgue de l’église de la Trinité, en improvisant pour cette occasion sur des thèmes des
Pêcheurs de perles à l’entrée et de
Carmen à la sortie. Pasdeloup et l’Orchestre du Cirque d’hiver avaient quant à eux interprété
Patrie et des extraits de
L’Arlésienne.
Né le 27 août 1828 à Paris, Auguste Bazille avait rapidement rejoint le Conservatoire national supérieur de musique de Paris, où il remportait un brillant palmarès : premier prix de solfège (1841), premier prix d’harmonie et d’accompagnement (1845), premier prix de fugue (1846) et premier prix d’orgue (1847). L’année suivante, il était couronné par un premier Second Grand Prix de Rome, derrière Duprato. C’est à cette époque qu’il fut engagé à l’Opéra-comique, tout d’abord en qualité d’accompagnateur, puis comme chef du chant.
 |
Grand orgue de l'église
Sainte-Elisabeth-du-Temple, à Paris IIIe. Construit en 1853 par le
facteur Suret, il comportait à l'origine 39 jeux répartis sur 3 claviers
et un pédalier.
( photo Christophe d'Alessandro, avec son aimable autorisation. )
D'autres très belles photos de C. d'Alessandro sont disponibles sur la page des organistes et maîtres de chapelle de l'église Ste-Élisabeth. |
En même temps, il était nommé premier organiste titulaire du nouvel orgue que le facteur Suret venait de construire (1853) à l’église Sainte-Elisabeth du Temple, dans le troisième arrondissement parisien. Cet instrument comportait à l’époque 39 jeux répartis sur 3 claviers de 54 notes et un pédalier de 24 notes. C’est Pierre Laboureau, un ancien élève de l’Ecole Niedermeyer, qui lui succédera en 1887, avant de laisser à son tour les claviers à un autre futur Grand Prix de Rome, Omer Letorey.
Premier chef du chant à l’Opéra-comique, organiste de Sainte-Elisabeth, Bazille enseignait également au Conservatoire de Paris l’accompagnement pratique au piano. L’un de ses plus prestigieux élèves fut un certain Claude Debusy qu’il connut dès son entrée dans cet établissement, le 2 octobre 1872 et qui rejoignit sa classe d’accompagnement et d’harmonie pratique en octobre 1879. L’année suivante il obtenait le premier prix. Si la révolte de Debussy contre l’enseignement de l’harmonie par son professeur Emile Durand est connue, l’on sait par contre que le futur auteur de La Mer retira un grand profit de l’excellent enseignement d’Auguste Bazille.
 |
Rouen: l'orgue de Saint-Maclou
( Photo Michel Baron )
|
En tant qu’organiste Auguste Bazille était renommé. Il n’était pas rare de le croiser ça et là dans toute la France, où il était demandé pour inaugurer des orgues. C’est ainsi que le 1er octobre 1854, il inaugure celles de Saint-Médard à Epinay-sur-Seine que vient de terminer Suret, les 19 et 21 novembre 1861 il réceptionne celles de la cathédrale de Nancy restaurées par Cavaillé-Coll, le 29 août celles de la basilique Saint-Denys d’Argenteuil, construites par Suret, et le 15 avril 1884, celles de l’abbatiale Saint-Sauveur à Montivilliers, dues au facteur Louis Debierre. Mais c’est surtout l’inauguration le 26 mai 1854 de l’instrument de St-Eustache, construit par Barker, avec les organistes Lemmens, César Franck et Cavallo, puis celui de Saint-Sulpice (29 avril 1862), œuvre de Cavaillé-Coll, en compagnie de Guilmant, Saint-Saëns, César Franck et Schmitt qui le révéleront au grand public. Lors de cette dernière manifestation, il interprétait d’ailleurs une Pastorale de sa composition intitulée Orage. N’oublions pas également l’inauguration, le 26 juillet 1866, avec Aimable Dupré (le grand-père de Marcel Dupré), Saint-Saëns, alors organiste de la Madeleine, Charles Renaud de Vilbac, Prix de Rome et organiste de Saint-Eugène à Paris et Aloys Klein, titulaire de la cathédrale de Rouen, du grand orgue de Saint-Maclou de Rouen, reconstruit par la firme Merklin-Schütze... Sa réputation était telle que la presse, lors de l’inauguration solennelle de l’orgue de Notre-Dame de Paris, le 6 mai 1868 à 8 heures du soir, qui attira des milliers de personnes, déplora de ne pas voir le nom d’Auguste Bazille figurer sur les programmes !
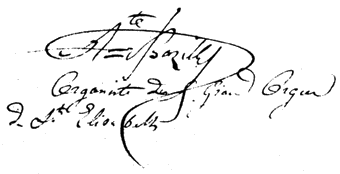 |
Signature d'Auguste Bazille apposée le 29 août 1867 sur le procès-verbal de réception du grand-orgue d'Argenteuil, construit par le facteur parisien Suret.
( photo DHM )
|
Si Auguste Bazille déploya une grande activité en tant qu’interprète, que ce soit aux claviers d’un piano ou d’un orgue ou encore à la tête de ses chœurs de l’Opéra-comique, il n’en est pas de même pour ce qui concerne la composition. A part quelques pièces éparses, on ne lui connaît en effet que des mélodies, des couplets pour des scènes de vaudevilles, ainsi que quantité de réductions de partitions pour piano, notamment Lakmé et Le Roi l’a dit de Delibes, Cinq-Mars de Gounod et Zémire et Azor de Grétry. Son nom apparaît également, en même tant que ceux de Clapisson, Gevaert, Jonas, Gautier, Mangean et Poise, dans la musique de l’opérette en un acte, La Poularde de Caux, qui fut représentée au Théâtre du Palais-Royal.
Auguste-Ernest
Bazille est mort le 18 avril 1891 à Colombes, près Paris, où il résidait depuis
plusieurs années. Il avait épousé en 1863 à Paris Jenny Dorigny, qui lui
donnera un fils : Henri Bazille (1870-1909). Celui-ci, élève du
Conservatoire de Paris, où il fréquentait notamment des classes de solfège (2e
médaille en 1886) et de déclamation, fera une carrière parisienne de musicien
(pianiste) et d’artiste dramatique, notamment au Théâtre des Bouffes-Parisiens.
Denis HAVARD DE LA MONTAGNE
Georges MATHIAS (1826-1910)

|
Georges Mathias, lithographie de M.-A. Alophe
(Imprimerie Lemercier, Paris/coll. BnF-Gallica)
|
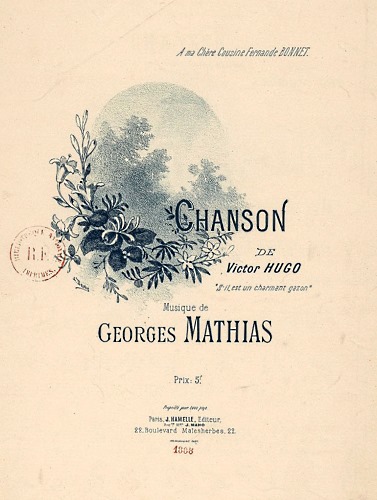
|
 Georges Mathias, Chanson "S'il est charmant gazon", poésie de Victor Hugo (Chants du crépuscule), dédicacée "à ma chère cousine Fernande Bonnet" Georges Mathias, Chanson "S'il est charmant gazon", poésie de Victor Hugo (Chants du crépuscule), dédicacée "à ma chère cousine Fernande Bonnet"
[née Mathias en 1856, il s'agit de la petite-fille de Herz Mathias (c.1778-1850), un oncle de Georges]
(1888, Paris, Hamelle, éditeur/coll. Bnf-Gallica).
Fichier audio par Max Méreaux avec transcription pour clarinette de la partie chant (D.R.)
|
Deuxième second grand prix de Rome 1848, élève de piano de Chopin, professeur de piano au Conservatoire de Paris de 1862 à 1893, pianiste concertiste et compositeur.

|
Signature autographe, 1872
DR.
|
Ernest Cahen, Régina, grande valse simplifiée par Charles Chaulieu extraite des Nuits enchantées
(Paris, Cauvin éditeur, 1877/coll. BNF-Gallica) DR.
 Fichier audio par Max Méreaux avec corrections (en rouge) de la partition : ajouts de bémols oubliés devant le mi aux 5e, 6e, 7e et 8e mesures de l'avant-dernier système à la main gauche (DR.) Fichier audio par Max Méreaux avec corrections (en rouge) de la partition : ajouts de bémols oubliés devant le mi aux 5e, 6e, 7e et 8e mesures de l'avant-dernier système à la main gauche (DR.)
Partition au format PDF |

|
1849
Pas de premier prix
Ernest CAHEN (1828-1893)
Compositeur discret et musicien polyvalent, Ernest Cahen, pianiste distingué, organiste, professeur de musique, et compositeur, a laissé peu de souvenirs dans l’histoire de la musique.
Né à Paris le 18 août 1828 et fils de Samuel Cahen (« savant hébraïsant, traducteur de la Bible ») et Mathilde Bloch, Ernest Cahen fréquenta le Conservatoire de sa ville natale, où il eut pour professeurs Adolphe Adam pour la composition, Joseph Zimmermann pour le piano, et probablement Félix Le Couppey (solfège, harmonie) et François Bazin (accompagnement). 1er prix de solfège en 1838 à l'âge de 10 ans, 1er accessit d’harmonie et accompagnement en 1845, puis 1er prix deux années plus tard, il se présentait en 1849 au Concours de l’Institut et remportait le second Grand Prix. Il était cependant le premier nommé, puisque cette année-là le jury n’avait pas cru devoir décerner de Grand Prix !
Après l’obtention de son Prix de Rome, Ernest Cahen se livra à l’enseignement à Paris, notamment comme professeur adjoint au Conservatoire, tout en touchant les orgues des synagogues de la rue de la Victoire et de la rue Notre-Dame-de-Nazareth, et ce, durant plus de 40 ans. L’instrument de la Grande synagogue de Paris, édifiée rue de la Victoire en 1867, avait été construit en 1875 par le facteur Merklin. Samuel David, autre lauréat du Prix de Rome y était alors directeur de la musique à la même époque. Quant au temple de la rue Notre-Dame-de-Nazareth, érigé en 1852, il accueillait alors un bel orgue Cavaillé-Coll de 1852.
On connaît d’Ernest Cahen un opéra-comique en 3 actes, Couvre-feu (paroles de Camille Doucet et Vierne), en répétition au Théâtre-National en juillet 1851 et plusieurs opérettes, parmi lesquelles Le Calfat en 1 acte, représenté en 1856 au Théâtre des Folies-Nouvelles, et Le souper de Mezzelin en 1 acte, représenté en 1859 dans ce même théâtre. Située 41 boulevard du Temple, cette salle de spectacles, fondée en 1852, était alors dirigée par le député et journaliste Altaroche, qui, avec le littérateur et journaliste Louis Huart s’étaient lancés en 1855 dans l’exploitation d’une nouvelle scène de genre. Alors en vogue, ce théâtre lyrique attirait la jeunesse de l’époque qui venait se distraire sur les boulevards en assistant à des pièces légères. En septembre 1859 la célèbre actrice Virginie Déjazet le racheta pour son fils Eugène, lui-même auteur d’opérettes.
Ernest Cahen est décédé à Paris le 1er novembre 1893, laissant une veuve née Brunette Bloch.
D.H.M.
 |
Emile Jonas
( lithographie, Impr. Becquet, BNF Richelieu )
|
Émile JONAS (1827-1905)
Né le 5 mars 1827 à Paris, Emile Jonas est entré au Conservatoire national supérieur de musique de Paris le 28 octobre 1841, dans les classes de piano et d’harmonie de Félix Le Couppey et de composition de Michel Carafa qui le conduira à l’obtention d’un deuxième Second Grand Prix de Rome en 1849 pour sa cantate Antonio. Dès 1847, année où il avait obtenu un premier Prix d’harmonie, il était nommé professeur assistant de solfège élémentaire au CNSM, avant d’être nommé titulaire en 1857, puis de prendre deux années plus tard la classe d’harmonie et de composition pour les élèves militaires. En 1870 il se retirait du Conservatoire.
Chef de musique de la Garde Impériale et chef de chœur de la synagogue portugaise, alors installée au numéro 23 de la rue Lamartine, dans le onzième arrondissement parisien, il est l’auteur d’un grand nombre d’opérettes composées dans le style d’Offenbach, dont certaines connurent un certain succès : Avant la noce (Fantaisies-Parisiennes) et les Deux Arlequins (id., 1866). Citons encore le Duel de Benjamin donné aux Bouffes-Parisiens en 1855, le Roi boit (1857), Job et son chien (1863), le Manoir de la Renardière (1864), Avant la noce (1865), le Canard à trois becs (1869) et Javotte, opéra-comique en 3 actes sur un livret d’Alfred Thompson (Paris, E. Dentu, 1872). On lui doit également quelques pages pour saxophone, notamment Le Diamant et une belle Prière pour quartette de saxophones.1
 |
Exemple n° 1 noté par Léon Algazi
( La Revue musicale, numéro spécial 222, année 1953-54, p.159 )
|
Dans ses compositions à l’usage du culte hébraïque le musicologue Léon Algazi, directeur de la musique de la synagogue de la rue de la Victoire et professeur de musique liturgique au Séminaire israélite , lui reproche2 " de sacrifier au déplorable goût du jour, confondant froidement les styles et les genres et associant des paroles liturgiques (quitte à en fausser le sens et la prosodie) à des airs d’allure militaire ou théâtrale, et même à des valses ou des mazurkas. " [voir exemple 1, ci-dessus]. Il est cependant l’auteur d’un recueil de chants hébraïques à l’usage du culte, publié en 1854, qui note la tradition sefardie ou portugaise dans lequel il a le mérite de recueillir quelques mélodies traditionnelles qu’il a su harmoniser selon les canons classiques.
Emile Jonas est mort à Saint-Germain-en-Laye, le 21 mai 1905.
Denis HAVARD DE LA MONTAGNE
 |
Emile Jonas, Couplets de la cocotte,
extrait de l'opéra bouffe en 3 actes
Le Canard à trois becs
( 1869, Paris, Girard éditeurs/coll. BNF-Gallica )
Partition au format PDF
 Fichier audio par Max Méreaux (DR.) Fichier audio par Max Méreaux (DR.) |
____________
1) Enregistrée en 1994 par le Quartetto di Sassofoni Accademia. CD NUOVA ERA 7211, "Hommage à Sax - XIX Century Original Work for Saxophone" www.accademiasax.com/discog/cd_page/7211.html
[ Retour ]
2) La Revue musicale, numéro spécial 222, année 1953-54.
[ Retour ]
 |
CD NUOVA ERA 7211 (enregistré en 1994)
HOMMAGE A SAX.
XIX Century Orginal Works for Saxophones
QUARTETTO DI SASSOFONI ACCADEMIA
Gaetano Di Bacco,saxophone soprano - Enzo Filippetti, saxophone alto
Giuseppe Berardini, saxophone ténor - Fabrizio Paoletti, saxophone bayton
CLAUDE DELANGLE, saxophone soprano
- Jérôme SAVARI (1819-1870) : Quintette et Quatuor
- Jean-Baptiste SINGELEE (1912-1875) : Grand Quatuor concertant op. 79 et
- 1er Quatuor op. 53
- Caryl FLORIO (1843-1920) : Quartette (Allegro de Concert)
- Jean-Baptiste MOHR (1823-1891) : Quatuor
- Emile JONAS (1827-1905) : Prière (1861)
|
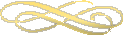

Droits de reproduction et de diffusion réservés
© MUSICA ET MEMORIA