Émile PALADILHE - Adolphe DESLANDRES - Isidore LEGOUIX - Théodore DUBOIS - Théodore SALOMÉ - Eugène ANTHIOME - Louis BOURGAULT-DUCOUDRAY - Adolphe DANHAUSER - Jules MASSENET - Charles CONSTANTIN - Gustave RUIZ - Victor SIEG - Charles LENEPVEU - Émile PESSARD - Alfred PELLETIER-RABUTEAU - Eugène WINZTWEILLER, Antoine TAUDOU
1860
Émile PALADILHE (1844-1926)
 |
Émile Paladilhe (1844-1926)
( coll. DHM )
|
Émile PALADILHE (1844-1926), Prix de Rome à l'âge de 16 ans en 1860, auteur notamment des opéras Le Passant, L'Amour africain, Diana, d'un drame lyrique sacré Les Saintes-Marie-de-la-Mer, et de plusieurs Messes et autres oeuvres de musique sacrée. Il succède en 1892 à Ernest Guiraud à l'Institut de France.
Biographie d'Émile Paladilhe (page spécifique).
Catalogue chronologique des oeuvres d'Émile Paladilhe.
Adolphe DESLANDRES (1840-1911)
 |
Adolphe Deslandres
( photo X... )
|
" Homme d’une beauté exceptionnelle, grand, les cheveux d’un blanc argenté, une grande barbe, les joues fraîches et rouges, comme de nombreux Français qui mènent une vie digne et modérée, de grands yeux bruns de braise, étincelants à mesure qu’il parle ", voilà le portrait que Fannie Edgar Thomas, critique musicale du journal The Musical Courier de New-York, dressait d’Adolphe Deslandres dans son article du 6 juin 1894.1
" Homme de talent ", Adolphe-Edouard-Marie Deslandres est né le 22 janvier 1840 dans le village des Batignolles-Monceau alors qu’il n’était pas encore absorbé par Paris.2 Son père, Laurent, pianiste et organiste, était à cette époque maître de chapelle de l’église Sainte-Marie des Batignolles, où il restera d’ailleurs en fonction durant une cinquantaine d’années entre 1829 et 1880. Celui-ci avait été le premier musicien à exercer dans la toute nouvelle église paroissiale des Batignolles construite en 1828 par les soins de Charles X et de la duchesse d’Angoulême, une fille de Louis XVI. Agrandie une première fois en 1834 (chœur et deux chapelles latérales), cette église, due à l’architecte Lequeux, a trouvé sa forme définitive actuelle en 1851 avec l’ajout des deux bas-côtés. Elle a la forme d’un temple grec. Son fronton triangulaire est soutenu par quatre colonnes d’ordre toscan. Laurent Deslandres (1813-1880) eut la douleur de perdre deux de ses enfants, alors qu’ils étaient également promis à une brillante carrière musicale. L'aîné, Jules-Laurent Deslandres, né le 15 août 1838 aux Batignolles, élève du Conservatoire de Paris où il obtenait un 1er prix de contrebasse en 1855, était entré en 1859 dans l'orchestre de l'Opéra de Paris et "possédait une jolie voix de ténor, qu'il utilisait pour chanter à Sainte-Marie des Batignolles". Mais, la mort l'enleva le 1er août 1870 à l'âge de 31 ans. Le cadet, Georges-Philippe Deslandres, né le 5 mai 1849, avait, tout comme son frère aîné, rejoint le Conservatoire de Paris, où il était rentré en 1868 dans la classe d’orgue de César-Franck . Deux années plus tard il en ressortait muni d’un deuxième Prix. Devenu organiste et compositeur, principalement de musique religieuse, il est hélas décédé à Paris, le 12 octobre 1875, tout juste âgé de 26 ans, après avoir été quelque temps organiste accompagnateur à Sainte-Clotilde, Saint-Vincent-de-Paul et Sainte-Marie des Batignolles.
 |
 |
Eglise Sainte-Marie des Batignolles, avant 1851
( Dessin X..., paru dans la plaquette «Centenaire de l'école Sainte-Marie des Batignolles, 1878-1978» )
|
Eglise Sainte-Marie des Batignolles, après son agrandissement de 1851
|
 |
Fragment partition Ave Maria pour soprano ou ténor, avec accompagnement d'orgue, par Adolphe Deslandres "Maître de chapelle et organiste du Grand Orgue de Ste Marie de Batignolles, chanté par Mlle Cl. Deslandres dans la Chapelle du Palais de Versailles",
publié dans le supplément de L'Illustration, 9 mai 1903
 Fichier audio par Max Méreaux (DR.) Fichier audio par Max Méreaux (DR.)
( coll. D.H.M. )
|
Adolphe Deslandres quant à lui, intégra tout jeune le Conservatoire de Paris et suivit notamment les classes de Leborne (contrepoint et fugue) et de François Benoist (orgue). Premier Prix d’orgue et également de fugue en 1858, il se présentait au Concours de Rome l’année suivante et remportait, ex aequo avec Paladilhe, une mention honorable pour sa cantate Bajazet et le Joueur de flûte. Il concourrait à nouveau en 1860 et cette fois-ci obtenait le premier Second Grand Prix, derrière son ami Paladilhe. Le sujet de la cantate était cette fois-ci Ivan IV. Peu de temps après, en 1862, il était nommé organiste de l’église Sainte-Marie des Batignolles, où son père dirigeait la Maîtrise. Il jouait ici sur un instrument des frères Stoltz qui semble avoir fonctionné jusqu’en juillet 1912. Il y avait également un orgue de chœur construit par Merklin en 1880, que le curé de la paroisse, l’abbé Leblanc, à l’occasion de travaux exécutés dans son église en 1911, donna à l’église St-André-d’Antin.3
Compositeur fécond, Adolphe Deslandres a produit un grand nombre d’œuvres chorales et instrumentales, ainsi que des pages de musique religieuse. Gounod appréciait particulièrement son opéra-comique Dimanche et Lundi et assista même à sa première représentation à l’Opéra-Comique (1872), où fut également donné en 1884 un autre opéra-comique de sa composition : Le Baiser. D’autres opéras, représentés à l’Alcazar d’hiver eurent un certain succès : Le Chevalier Bijou (1875) et Fridolin (1876). L’oratorio Les Sept Paroles du Christ, pour baryton solo et chœur, avec accompagnement de violon-solo, violoncelle, harpe et orgue, sur des paroles d'E. de Laboulaye (exécuté dans la Chapelle du Palais de Versailles en 1883), ainsi que la cantate Sauvons nos frères, pour voix seules, chœur et orchestre, sont des œuvres marquantes que le compositeur affectionnait particulièrement, ainsi d’ailleurs que son remarquable Stabat Mater à 4 voix, soli, chœurs, orgue et orchestre, qui fut donné en 1885 et en avril 1897 à la Chapelle du Palais de Versailles. Parmi ses pièces religieuses, citons encore une Messe de Saint-André, exécutée à Notre-Dame et dans la basilique du Sacré-Coeur de Montmartre, une Messe Solennelle en mi bémol pour solistes, chœur, orchestre et orgue, qui fut jouée à St-Eustache pour la Fête de Sainte-Cecile le 24 novembre 1885, un recueil de vingt-quatre cantiques pour les principales fêtes de l’année, une Invocation à Marie... et des pages pour orgue : Offertoire et Communion, Offertoire pour grand orgue... On lui doit également un Air de ballet pour piano, des Etudes de concert en staccato, un Scherzo pour grand orchestre qui fut donné au Palais du Trocadéro en 1880 où obtint un vif succès, quatre Méditations pour violon, violoncelle, cor, harpe, orgue et contrebasse, une Ode à l’harmonie, de nombreuses mélodies : Feuillets d’album, la Barque brisée (chant funèbre patriotique), La Vierge aux fleurs, la Nativité...
Prix de l’Institut, Officier d’Académie, Officier de l’Instruction Publique, Adolphe Deslandres a été durant longtemps un compositeur à succès, tant dans le domaine profane que religieux. Il est mort à Paris, le 30 juillet 1911. En son temps, ce musicien fut considéré comme un "remarquable compositeur", son talent souple et varié ayant atteint son complet épanouissement", ce que la presse se plaisait à souligner. La "Revue des Beaux-Arts et des Lettres" du 1er avril 1899 écrivait notamment : "M. Deslandres possède le don d'orchestration à son plus haut degré de perfection... Bien qu'il ait un très volumineux et très riche bagage de musique religieuse, il ne s'est jamais, pour cela, éloigné du genre profane qu'il élève : il reste mélodique comme les maîtres qu'il a toujours aimés et vénérés : Mozart, Gounod, etc... Ses compositions sont claires : toutes ses pages sont d'une inspiration féconde et la science couronne ses richesses intellectuelles." Quand à la revue "Gil Blas", on pouvait lire dans son numéro du 9 juillet de la même année : "Adolphe-Edouard-Marie Deslandres n'est pas seulement un excellent maître de chapelle, doublé d'un virtuose religieux: il est compositeur et ses oeuvres, si fécondes, obtiennent dans les milieux mondains le même succès qu'à l'église, car il sait varier sa forme. Sa musique, s'inspirant du sujet, atteint les plus hauts sommets de l'art et se plie aux caprices gracieux du poème."
Clémence Deslandres, "cantatrice de grand style, douée d'une fort belle voix", interprétait souvent les oeuvres de son frère Adolphe, notamment dans des solennités musicales religieuses ou des concerts de charité. C'est ainsi qu'elle chante en juin 1895 dans la basilique du Sacré-Coeur de Paris le Chant populaire à Jeanne d'Arc, paroles de Mgr Le Nordez ; en juin 1896, ainsi qu'en 1897 et en 1898 dans la même église l'Hymne au Sacré-Coeur avec violon, harpe et orgue ; le 28 avril 1899 au Trocadéro La Bannière de Jeanne d'Arc écrite pour solo et chœur ad lib., paroles de Ch. Desgranges, accompagnée par la Musique de la Garde Républicaine dirigée par Gabriel Parès (oeuvre redonnée peu après en mai 1899 à Notre-Dame de Paris, avec accompagnement de 20 trompettes, 10 trombones et grand-orgue).
Denis HAVARD DE LA MONTAGNE
 Adolphe Deslandres, La Guirlande de roses, grande valse brillante pour piano (Paris, F. Gauvin, éditeur). Partition dédiée “à Mme Henri Gillet”, l’épouse du parolier des deux opéras comiques en un acte d’A. Deslandres Dimanche et Lundi, et Le Baiser, respectivement donnés le 21 octobre 1872 à l’Athénée et 3 juin 1884 à l’Opéra-Comique. Fichier audio par Max Méreaux (DR.)
Adolphe Deslandres, La Guirlande de roses, grande valse brillante pour piano (Paris, F. Gauvin, éditeur). Partition dédiée “à Mme Henri Gillet”, l’épouse du parolier des deux opéras comiques en un acte d’A. Deslandres Dimanche et Lundi, et Le Baiser, respectivement donnés le 21 octobre 1872 à l’Athénée et 3 juin 1884 à l’Opéra-Comique. Fichier audio par Max Méreaux (DR.)
____________
1) Fannie Edgar Thomas, née à Chicago en 1848, a habité Paris durant 7 ans à partir d'octobre 1893. Elle a écrit de nombreux articles sur les organistes parisiens qu'elle envoyait à son journal The Musical Courier de New-York. Une trentaine d'entre eux ont été traduits de l'américain par Claude Maisonnat et publiés en français, avec une présentation et des annotations par Agnes Amstrong dans la revue La Flûte harmonique, publication de l'Association Aristide Cavaillé-Coll , dans les numéros 53/54 (1990), 55/56 (1990), 57/58 (1991) et 75/76 (1998). [ Retour ]
2) C'est le 1er janvier 1860 que furent annexées à Paris onze communes avoisinantes : Vaugirard, Grenelle, la Villette, Belleville, Auteuil, Passy, Batignolles-Monceau, Montmartre, la Chapelle-Saint-Denis, Charonne et Bercy. La superficie de la capitale passait de 3402 hectares à 7802 et sa population de 1 053 262 habitants à 1 667 841. Avec les quartiers des Ternes, La Plaine-Monceau et les Epinettes, le village de Batignolles-Monceau formera le 17ème arrondissement.
[ Retour ]
3) L'orgue de tribune actuel construit par Mutin-Cavaillé-Coll date de 1923 et a eu notamment pour titulaire Joachim Havard de la Montagne de 1948 à 1996. [ Retour ]

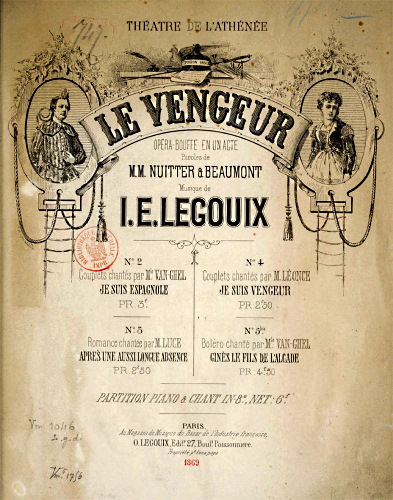
|
Isidore Legouix, "Couplets", morceau extrait de l'opéra-bouffe en un acte Le Vengeur, réduction pour piano et chant (Paris, O. Legouix, éditeur, 1869).
Coll. Bnf-Gallica (DR.)
 Fichier audio par Max Méreaux (DR.) Fichier audio par Max Méreaux (DR.)
Partition au format PDF |
Isidore LEGOUIX (1834 – 1916)
Le paradoxe de ce compositeur, ainsi que le décrit si bien Hugo Riemann dans son Dictionnaire de musique [2e édition française, révisée par Georges Humbert, Lausanne, Libraire Payot & Cie, 1913] est que "l'allure de ses opérettes est trop distinguée pour convenir aux goûts de la masse", ce qu'avait déjà remarqué Pougin en 1881 et consigné en ces termes [Biographie universelle des musiciens] : "M. Legouix est un artiste aimable, instruit, distingué, qui n'a que le tort de respecter l'art qu'il exerce, et qui aurait réussi aussi bien et peut-être mieux que d'autres s'il avait voulu se lancer dans le champ de la musique grotesque et prétendue bouffe, si fort en honneur depuis vingt ans."
Fils aîné de l'éditeur et libraire musical Onésime Legouix (1809-1867) et de Colombe Daubrée, Isidore-Edouard Legouix est né à Paris le 1er avril 1834. Le commerce de son père, qu'il avait ouvert au début du règne de Louis-Philippe Ier, était situé au numéro 4 de la rue Chauveau-Lagarde, dans le huitième arrondissement parisien. Cette librairie musicale, après le décès de son fondateur, fut continuée par son fils cadet Gustave Legouix, né à Paris le 29 février 1844, mort à Montfermeil le 24 août 1916, puis par le fils de ce dernier, Robert Legouix. En 1960, soit près de 130 ans après sa fondation, ce magasin, à l'enseigne "Libraire Musicale R. Legouix ", subsistait toujours à la même adresse (Place de la Madeleine). 1
Admis au Conservatoire de Paris en 1847, Isidore Legouix obtient un 1er prix de solfège en 1850, un 1er prix d'harmonie en 1855 (classe de Reber) et l'année suivante un 2d accessit de contrepoint et fugue. Après avoir suivi la classe de composition d'Ambroise Thomas, il concourt en 1860 pour le Prix de Rome et décroche une mention honorable avec la cantate Le Czar Ivan IV, sur des paroles de Théodore Anne, également auteur du texte de l'opéra Marie Stuart de Niedermeyer (1844). Legouix se présente à nouveau l'année suivante au Concours de Rome, mais échoue. Il abandonne alors ses études au Conservatoire, travaille à la librairie musicale familiale, et se livre à la composition, plus particulièrement à la musique de scène. Mais à cette époque, fin du Second Empire – début de la IIIe République, la concurrence est rude dans le domaine de l'opérette qui fait courir les foules. Hervé, Offenbach, puis Lecocq, Audran, Planquette, Varney se partagent les succès aux Bouffes-Parisiens, au Théâtre des Nouveautés, à celui de la Gaîté ou encore aux Folies-Dramatiques. Mam'zelle Nitouche, La Fille du tambour-major, L'Oiseau bleu, Les Cloches de Corneville, Rip, Le Grand Mogol, Les Mousquetaires sont quelque-uns des triomphes qui tiennent l'affiche durant longtemps, largement amplifiés par l'Exposition Universelle de 1889 (mai à novembre, 25 millions de visiteurs) durant laquelle la musique règne et qui, par ailleurs, voit la construction de la Tour Eiffel. Auteur d'une quinzaine d'ouvrages, Isidore Legouix n'atteindra jamais la notoriété, même si quelques-unes de ses opérettes rencontrèrent un succès très éphémère :
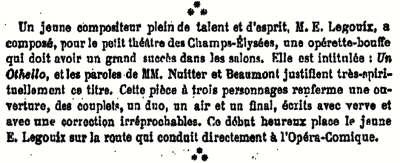 |
L'Univers musical, 24 décembre 1863
|
- Un Othello
, opérette en 1 acte, paroles de Charles Nuitter et Alexandre Beaumont, Théâtre des Champs-Elysée, décembre 1863 (O. Legouix).
- Le Lion de Saint-Marc
, opéra-bouffe en 1 acte, paroles de Charles Nuitter et Alexandre Beaumont, Théâtre Saint-Germain, 24 novembre 1864 (O. Legouix).
- Ma Fille
, opérette en 1 acte, Delassements-Comiques, 20 mars 1866.
- Malborough s'en va-t-en guerre
, opéra-bouffe en 4 actes, écrit en société avec Georges Bizet, Léo Delibes et Emile Jonas (l'acte 3 est de Legouix), paroles de Paul Siraudin et William Busnach, Théâtre de l'Athénée, 15 décembre 1867.
- Le Vengeur
, opéra-bouffe en 1 acte, paroles de Charles Nuitter et Alexandre Beaumont, Théâtre de l'Athénée, 20 novembre 1868 (O. Legouix).
- Deux portières pour un cordon
, pochade musicale en 1 acte, écrit en société avec Florimond Hervé, Charles Lecocq et G. Maurice, sous le pseudonyme unique d'Alcindor, paroles de MM. Lefebvre et Lucian, Palais-Royal, 19 mars 1869 (L. Bathlot, puis Dentu, 1897)
- L'Ours et l'amateur de jardins
, bouffonnerie en 1 acte, paroles de William Busnach et Auguste Maquet, Bouffes-Parisiens, 1er septembre 1869 (O. Legouix).
- Les Dernières Grisettes
, opéra-bouffe en 3 actes, Théâtre des Fantaisises-Parisiennes à Bruxelles, 12 décembre 1874.
- Le Mariage d'une étoile
, opérette en 1 acte, paroles d'Eugène Grangé et Victor Bernard, Bouffes-Parisiens, 1er avril 1876 (O. Legouix).
- Madame Clare, somnambule
, "folie" en 1 acte avec airs nouveaux, Palais-Royal, mars 1877.
- La Tartane
, opérette.
- Quinolette
, opérette en 1 acte, paroles de Mac-Nab, publié dans la revue Le Magasin des Demoiselles.
- La Clef d'argent
, opéra-comique 1 acte, paroles d'Alexandre Beaumont, publié dans la revue Le Magasin des Demoiselles.
- Après la noce
, opérette en 1 acte (G. Legouix).
- La Fée aux genêts
, opéra, paroles d'Eugène Adenis (Hennuyer, c. 1909).
- Une nouvelle Cendrillon
, opérette en 1 acte, paroles d'Eugène Adenis (Hennuyer).
La presse musicale de l'époque reçut différemment les représentations des oeuvres d'Isidore Legouix. C'est ainsi que pour Un Othello "L'Univers musical" du 24 décembre 1863 le présente comme "un jeune compositeur plein de talent et d'esprit" et que la "France musicale" du 3 septembre 1869, pour L'Ours et l'amateur de jardins, écrit que "la petite partition de M. Legouix est charmante et vive". Mais ce même journal rapportait quelques mois auparavant (11 avril 1869) que les Deux portières pour un cordon est "une pièce, qui n'est, faut bien le dire, qu'un prétexte à l'exhibition de trois excellents comiques de ce théâtre, c'est qu'on y voit deux portières qui se disputent un cordon, et un fabricant de robinets, qui est le mari de l'une d'elles."
On doit également à Isidore Legouix quelques pages pour piano (Idylle, La Japonaise, Schzerzo...), des mélodies (Les Braconniers, La Petite curieuse, Les pauvres amoureux...) publiées par son père (O. Legouix) ou par l'éditeur parisien Hennuyer, ainsi qu'un opéra-comique en 1 acte, en anglais (adaptation de H.B. Farnie), intitulé The Crimson scraf (l'Echarpe cramoisie), joué à Londres dans les années 1870 et publié chez J.B. Cramer and Co et chez Metzler. Par la suite, cette oeuvre a fait l'objet d'une transcription pour piano par le compositeur américain Théodore Moëlling (New-York, W.F. Shaw, 1878).
Marié en 1900 à Boulogne-sur-Seine avec Aurélie Grégoire, Isidore Legouix s'est éteint le 15 septembre 1916 dans cette ville où il s'était installé depuis plusieurs années, trois semaines après la mort de son frère cadet Gustave.
Denis Havard de la Montagne
____________
1) Il est utile de souligner que le patronyme Legouix, peu courant, se rencontre principalement dans la Basse-Normandie, or, l'on sait l'histoire curieuse des éditeurs, libraires et marchands d'estampes originaires du Cotentin qui se fixèrent à Paris durant la première moitié du XIXe siècle. La Maison Garnier Frères, fondée en 1833 par deux frères, Auguste et Hippolyte Garnier originaires de la Manche, en est un exemple connu. Mais, à cette heure, nous ignorons encore si Onésime Legouix était lui aussi originaire de cette région.
[ Retour ]
1861
Théodore DUBOIS
 |
Théodore DUBOIS
héliogravure de P. Le Rat, Paris
( collection D.H.M. )
|
(page spécifique)
Théodore SALOMÉ (1834-1896)
 |
Théodore Salomé, 1834-1896.
( photo X..., fin XIX° siècle )
|
Très en vogue durant la seconde moitié du dix-neuvième siècle avec ses compositions parfois souvent qualifiées d’exquises, Théodore Salomé est totalement retombé dans l’oubli de nos jours ! Ces pièces pour piano, aux noms charmants et si évocateurs, figuraient au " Panthéon des pianistes " publié par l’éditeur parisien Henry Lemoine au début du XXème siècle : Aubade op. 38, Berceuse, op. 36, Le Bocage, op. 51, Danse mauresque, op. 34, Fleur d’Aragon, op. 35, Rose de mai, op. 33, Tante Aurore, op. 32, Vieille Chanson, op. 31... Quelques fragments symphoniques de sa composition furent également exécutés par la Société Nationale de Musique en 1877 et avaient soulevé l’intérêt des spécialistes qui trouvèrent là d’excellentes choses annonçant un brillant avenir à son auteur. Mais Théodore Salomé, bien que visiblement doué pour la composition préféra cependant se consacrer entièrement à ses activités d’organiste et de maître de chapelle plutôt que d’exploiter sa veine créatrice.
 |
L'église de la Sainte-Trinité, à Paris
( gravure de E. Therond, vers 1880 )
|
Né à Paris 5e ancien le 20 janvier 1834, Théodore César
Salomé est le fils cadet d'Henri Salomé (1803-1876), corroyeur, originaire
d’Hazebrouck (Nord) et de Jacqueline Bouvard. Ce dernier, parti de sa terre
natale, exerça successivement son métier à Grenoble (années 1820) et à Paris
(années 1830), avant de s’installer peu avant 1840 à Louviers (Eure). Théodore fut
sans doute initié à la musique par son frère aîné François (1827-1901), qui sera
plus tard pianiste, organiste et directeur de l’Orphéon de Louviers (années
1860), tout en y enseignant le piano et tenant l’orgue de l’église Notre-Dame à
deux reprises (1846 à 1851, puis 1859 à 1863). La petite-fille de ce dernier,
Alice Miquel (1893-1983), de par son mariage avec Jean-Marie Lafond (1888-1975,
directeur du Journal de Rouen), deviendra une cousine germaine par
alliance de l’organiste Marcel Dupré (1886-1971). Il fit ensuite toutes ses
études musicales au Conservatoire de Paris, sous la direction de François
Bazin, pour l’harmonie et l’accompagnement, d’Ambroise Thomas, pour la fugue et
la composition, et de François Benoist, pour l’orgue. Il décrocha là plusieurs
récompenses honorables : un deuxième accessit d’harmonie en 1855, l’année
suivante un deuxième accessit d’orgue, puis en 1857 un deuxième prix d’harmonie
et d’orgue, ainsi qu’un troisième puis un second prix d’harmonie en 1858 et
1859. Son cursus musical fut couronné par un premier Second Grand Prix de Rome
en 1861, la même année où étaient également récompensés Théodore Dubois, Eugène
Anthiome et Titus Constantin.
En 1863, l’architecte Théodore Ballu, qui avait déjà élevé l’église Sainte-Clotilde et reconstruira l’Hôtel de Ville de Paris dix ans plus tard, débuta l’édification de l’église de la Sainte-Trinité sur la place d’Estienne-d’Orves, toute nouvellement ouverte et située dans le neuvième arrondissement parisien. Bénie en novembre 1867, elle ne sera consacrée qu’en 1913, la veille de la première guerre mondiale ! Cavaillé-Coll installa dans cette nouvelle église un grand orgue de 46 jeux répartis sur 3 claviers et un pédalier, qui fut inauguré le 16 mars 1869 par Saint-Saëns, Franck et Widor. A la même époque ce facteur construisait également un orgue de chœur de 12 jeux (2 claviers et pédalier). Théodore Salomé, qui occupait déjà le poste d’organiste accompagnateur depuis quelques années sur un orgue provisoire, en fut le premier titulaire. Après une trentaine d’années d’exercice dans cette église, il se retira en 1895, laissant les claviers à Claude Terrasse plus connu d’ailleurs pour ses opérettes (Monsieur de la Palisse, Le Mariage de Télémaque, Cartouche...) que pour ses activités d’organiste liturgique !
Remplaçant parfois au grand orgue Alexandre Guilmant lorsque celui-ci partait effectuer ses célèbres tournées aux Etats-Unis, Théodore Salomé accompagna toujours les offices religieux avec beaucoup de talent et de savoir-faire. Ses compositions religieuses étaient parfois chantées par la maîtrise de la Sainte-Trinité, composée alors d’une vingtaine d’enfants et d’une dizaine de chanteurs professionnels, sous l’habile direction de leur maître de chapelle Emile Bouichère. La Trinité, bien qu’assez austère, faisait partie à cette époque des plus importantes églises de Paris. C’est là d’ailleurs que furent célébrées, le 5 juin 1875, les obsèques de Bizet en présence de 4000 assistants.
Parallèlement à ses activités d’organiste, notre Prix de Rome fut également quelque temps répétiteur de solfège au Conservatoire national supérieur de musique de Paris, professeur de musique au Collège Rollin1, ainsi que maître de chapelle au Lycée Saint-Louis2.
Théodore Salomé a laissé des pages pour son instrument très appréciées, parmi lesquelles on relève un recueil de Dix pièces pour orgue en deux volumes et un autre de Douze pièces pour orgue, publiés chez Leduc. Le volume 3 des Maîtres parisiens de l’orgue au XX° siècle (1936) contient également Deux Canons, op.21, numéros 1 et 3 de cet auteur. Il s’est éteint à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) le 19 juillet 1896, laissant une veuve, Céleste Condrot (épousée le 24 septembre 1867 à Verneuil-sur-Seine) et un fils : René Salomé, né en 1870, licencié ès-lettres, domicilié à Saint-Germain-en-Laye en 1896. Sa veuve lui survivra durant 43 ans avant de quitter ce monde à Paris, le 16 avril 1939 à l’âge de 90 ans, et son fils René, romancier, poète, critique littéraire, décédera célibataire en 1946 à Paris.
Denis HAVARD DE LA MONTAGNE
(2000, 2012, mise à jour : décembre 2025)
____________
1) Le Collège Rollin, fondé en 1822 rue Lhommond, fut transféré en 1878 dans des bâtiments neufs au numéro 12 de l'avenue Trudaine (IX°) et fut rebaptisé à cette occasion Lycée Jacques-Decourt. La musique tenait une place importante dans cet établissement. On y trouve notamment un orgue de 20 jeux construit en 1893 par le facteur Suret qui sera entièrement restauré au cours des années 1970.
[ Retour ]
2)Le Lycée Saint-Louis, construit en 1814 sur l'emplacement de l'ancien Collège d'Harcourt, qui, rappelons-le avait été fondé en 1280 par Robert d'Harcourt avant d'être démoli en 1795, est situé 42 boulevard Saint-Michel, dans le sixième arrondissement parisien. Charles Gounod a été l'un de ses élèves. Plusieurs musiciens de renom ont précédé Théodore Salomé dans ses fonctions de maître de chapelle : Hippolyte Monpou, Félix Danjou et Julien Martin
[ Retour ]
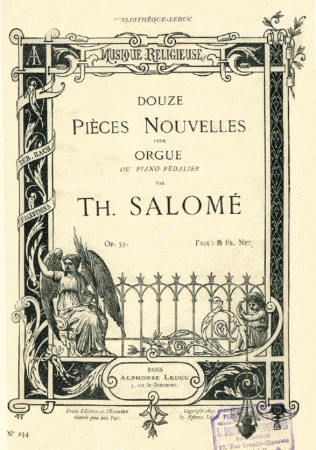 |
 |
Théodore Salomé,  Berceuse pour orgue, extrait de Douze Pièces nouvelles pour orgue ou piano-pédalier, op. 59, Paris, Alphonse Leduc, 1894, page de couverture et premières mesures Berceuse pour orgue, extrait de Douze Pièces nouvelles pour orgue ou piano-pédalier, op. 59, Paris, Alphonse Leduc, 1894, page de couverture et premières mesures
( Coll. Max Méreaux. Fichier audio par Max Méreaux ) DR
|
Eugène ANTHIOME (1836-1916)
 |
Eugène Anthiome vers 1870
( photo Pierre Petit )
|
Premier professeur de piano au Conservatoire de Paris de Maurice Ravel lorsque celui-ci entra à l’âge de 14 ans en 1889 dans sa classe préparatoire, Eugène Anthiome a principalement écrit des opérettes et des pages légères pour piano, parmi lesquelles deux Préludes pour piano, en ut majeur et la majeur, dédicacé le premier " A mon ami Ph. Bellenot " et le second " A ma fille Jane Barret de Beaupré " (Paris, E. Fromont, 1911). Même s’il n’a été qu’un simple maillon dans la culture pianistique du père du trop célèbre Boléro, ce compositeur méconnu peut se targuer d’avoir participé indirectement au renouveau de la technique du piano que Ravel imposa en 1902 avec ses Jeux d’eau : retour à la virtuosité et ingéniosité des combinaisons.
Breton de naissance et de cœur, puisqu’il s’inspira souvent de sa Bretagne natale dans ses compositions, Eugène-Jean-Baptiste Anthiome est né le 19 août 1836 à Lorient (Morbihan) où ses parents, artistes lyriques, obtenaient quelque succès. Entré au Conservatoire de Paris dans la classe d’harmonie d’Elwart, il obtenait un second accessit en 1856 avant de rejoindre la classe d’orgue de Benoist et celle de fugue et de composition de Carafa. En 1861 il se présentait au Concours de Rome avec la cantate Atala qui lui valait un deuxième Second Grand Prix et deux années plus tard il était nommé professeur accompagnateur de déclamation lyrique et répétiteur d’étude du clavier au Conservatoire national supérieur de musique de Paris, avant d’être titularisé professeur de piano quelques années plus tard. Il effectuera une grande partie de sa carrière dans cet établissement qu’il ne quittera qu’en 1901.
 |
Fragment partition de la mélodie Chant d'avril d'Eugène Anthiome, sur une poésie d'Armand Lafrique, publiée dans le supplément de L'Illustration,
11 avril 1903 (Coll. D.H.M.)
 Fichier audio par Max Méreaux (DR.) Fichier audio par Max Méreaux (DR.) |
L’œuvre d’Anthiome n’a pas fait date dans l’Histoire de la musique, mais néanmoins son catalogue ne manque pas d’un certain intérêt, ne serait-ce que par la diversité des sujets abordés. En voici les principaux ouvrages :
Mélodies : Berceuse, paroles de E. Tourneur (1868), Chanson de Nemorin, paroles de Florian (1873), Chansons d’Estelle, paroles de Florian (1873), A un ange, poésie d’Alphonse Boeul (E. Fromont, 1893), Six mélodies bretonnes : Vos binious les gas, Les gas d’Islande, Dors mon gas ; Hardi les gas, Fileuse, Carillon, poèmes de Paul Barret (E. Fromont, 1900)...
Musique de chambre : Grand trio en mi bémol pour piano, violon et violoncelle (Benoit, 1873), Air de ballet pour violon et piano (C. Alard, 1877), Fantaisie romantique pour violon et piano (A. Michel, 1889), Menuet favori de Mme de Maintenon, pièce de clavecin reconstituée par E. Anthiome (Crevel, 1896), Fugue en sol majeur pour piano (E. Fromont, 1899), Six pièces pour clavecin (E. Fromont, 1901-1905), Allemande, pièce pour clavecin (E. Fromont, 1904)...
Musique de théâtre : Semer pour récolter, opéra-comique en un acte, paroles de A. di Pietro et C. Demeuse, représenté aux Fantaises-Parisiennes le 6 mai 1866 (H.L. d’Aubel, 1866), Le dernier des Chippeways, opérette en un acte représentée le 3 février 1876 aux Folies-Bergères, Don Juan marié, la leçon d’amour, opérette en un acte (Escoffier, 1878), Le roman d’un jour, opéra-comique en 3 actes représenté en 1884 à l’Opéra-Populaire de la rue de Malte (Masson Laffrique, 1884), Un orage espagnol, opérette en un acte (1887)...
Musique symphonique : Sommeil et triomphe de Bacchus, scène mythologique pour orchestre (Bathlot-Joubert, 1893), Concerto en ut mineur, pour piano et orchestre (E. Fromont, 1898)...
On doit également à Eugène Anthiome, décédé le 24 juillet 1916 à Versailles, un ouvrage pédagogique intitulé L’Art du piano, méthode pour les commençants (Paris, Lissarague, 1880).
Bon nombre de ses compositions sont restées à l’état de manuscrits, parmi lesquelles on remarque de nombreuses mélodies et chansons, une Grande marche funèbre pour orchestre, écrite à la mémoire de Meyerbeer (1864-66), un oratorio La naissance du Christ, avec accompagnement de flûte, violon, violoncelle, orgue et piano, une cantate Les noces de Prométhée écrite pour l’Exposition de 1867, et une Cantate sacrée tirée des Ecritures Saintes pour orgue (1895).
Denis HAVARD DE LA MONTAGNE
Catalogue, par Anthare de Schuyter.
 Eugène Anthiome, Le Trille, 4e Etude de genre pour le piano, op. 4, dédicacé “à Madame H. Lecour” (Paris, E. et A. Girod, éditeurs). Fichier audio par Max Méreaux (DR.)
Eugène Anthiome, Le Trille, 4e Etude de genre pour le piano, op. 4, dédicacé “à Madame H. Lecour” (Paris, E. et A. Girod, éditeurs). Fichier audio par Max Méreaux (DR.)
1862
Louis BOURGAULT-DUCOUDRAY (1840-1910)
 |
Louis Bourgault-Ducoudray (1840-1910),
Grand Prix de Rome 1862,
professeur d'histoire de la musique
au Conservatoire de Paris
( photo Touranchet )
|
 |
Louis Bourgault-Ducoudray
vers 1862)
( photo Ruck, Musica )
|
Deux articles de
presse
« BIOGRAPHIE
DE M. L.-A. Bourgault-Ducoudray
M.
Louis-Albert Bourgault-Ducoudray est né à Nantes, le 2 février 1840, d'une
vieille famille d'armateurs. Un de ses ancêtres fut échevin de la ville. Dès
l'enfance —ce détail n'est pas fait pour compter parmi les exceptions, étant
commun à tous les musiciens de race — dès l'enfance, il vécut les doigts sur un
clavier.
Je
me suis toujours vu jouant du piano, dit-il simplement quand on l'interroge sur
ses commencements.
Nonobstant
cette ferme tendance, on le destinait à la diplomatie. II fit son droit et,
tout en le terminant à Paris, vers 1859, il écrivit un opéra, qui devait être
représenté trois fois à Nantes.
A
la suite de cette représentation, son père comprit qu'il fallait céder, ne plus
contrarier celle vocation si nette. M. Bourgault-Ducoudray renonça donc à la
diplomatie sans l'avoir même abordée et épousa la musique. Nous y avons
peut-être pendu un ambassadeur, mais nous y avons gagné un véritable artiste,
espèce plus rare. Il avait eu pour premiers professeurs, à Nantes, MM.
Dolmetsch et Champommier, et à Paris, Louis Girard dont les leçons le mirent en
état d'entrer au Conservatoire dans la classe de M. Ambroise Thomas. Il y
demeura deux ans ; après quoi, du premier coup, en 1862, il enleva le prix de
Borne, avec une scène lyrique : Louise de Mézières. Sa partition manquait de
métier, mais elle accusait des qualités scéniques qui le firent immédiatement
préférer à tous ses concurrents.
Cette
première victoire semblait lui réserver la carrière la plus militante : il
n'avait au reste appris la musique que pour faire du théâtre. On va voir tout à
l'heure comment il fut jeté presque soudainement hors de sa voie. A cette époque,
on vivait encore sur le passé de l'école italienne et de l'école allemande :
Gounod n'avait pas achevé sa lumineuse trouée, Berlioz était à peu près inconnu
de la foule ; le mouvement symphonique ne s'accusait pas encore. Aucun
entraînement, aucun souffle de révolution ne pouvait permettre au compositeur
d'ouvrir ses ailes. II suivait, comme on dit, la filière de l'école. Et ce
n'était pas sans un terrible embarras qu'il se trouvait en présence de ses
obligations étroites de pensionnaire de la villa Médicis. Prédestiné à la
musique dramatique, il se croyait sincèrement incapable de musique religieuse.
Or, à cette époque, son envoi de Rome à l'Académie des Beaux-Arts devait, si je
ne me trompe, se composer d'une messe ou tout au moins d'un morceau de musique
religieuse. Homme de devoir et de volonté, notre musicien se mit en tête
d'acquérir la savoir et le goût qui lui manquaient pour remplir convenablement
sa tâche. Il s'enfonça dans l'étude des vieux maîtres, se nourrit de leurs
oeuvres, découvrit Palestrina, en éprouva la joie enthousiaste de La Fontaine
découvrant Baruch, et s'enfonça si bien dans ses recherches, s'y intéressa
tellement que, de retour à Paris, au lieu de faire du théâtre, il fonda une
Société pour l'exécution des grandes oeuvres chorales, voulant faire partager
aux masses son admiration pour ces pages géniales qui lui semblaient devenues
sa chose.
Rome,
de son propre aveu, avait eu sur son esprit une très heureuse influence. Il s'y
était frotté à tous les arts et il estimait déjà, comme aujourd'hui, qu'on ne
fait pas de la musique seulement avec de la musique, mais avec les arts
ambiants. Il considère encore que Rome a été son meilleur professeur
d'esthétique et il se range ainsi au nombre de ceux qui défendront toujours la
villa Médicis comme l'institution la plus salutaire à l'affermissement des
jeunes esprits. Durant huit ans, ces grandes auditions l'occupèrent. Il fit
connaître ainsi au public la Fête d'Alexandre, Acis et Galatée de Haendel,
Hippolyte et Aricie de Rameau, et cette si curieuse et si française Bataille de
Marignan de Clément Jannequin, restée dans ma mémoire comme l'une des
impressions les plus vives qu'il m'ait été donné d'éprouver.
La
guerre vint, elle n'arrêta pas ces concerts que dirigeait une conviction
inébranlable. Les hommes venaient là en lignards, les femmes en ambulancières.
On se séparait, l'âme reposée, pour retourner à la dure tâche du jour.
Le
compositeur avait pris le fusil et le sac et entre deux auditions, il faisait
son service dans le 31e bataillon de marche. Très malheureux comme patriote,
souffrant des blessures de Paris, il était très heureux comme artiste. La musique
le hantait partout, marchait à son côté dans le rang, lui parlait pendant les
tristes, veillées des avant-postes. Il avait entrepris de composer une série de
morceaux empruntés aux Châtiments de Victor Hugo. Il savait par coeur ces
morceaux et il les formulait, musicalement un peu partout.
C'est
tandis que l'un deux s'ébauchait dans son cerveau qu'il entendit chanter à son
oreille les premières balles, étant de garde dans la tranchée, au Bourget. Un
autre lui vint tout entier, comme d'une pièce, à la Comédie-Française pendant
une représentation, d'une des comédies de Marivaux, pourtant peu suggestives de
pareilles inspirations. Il écrivit ainsi Stella, L'Empereur s'amuse, le
Chant de ceux qui s'en vont sur Mer, le Manteau impérial, le Chasseur noir, en
tout une dizaine de pièces. Ces compositions sont restées inédites.
Cette
surexcitation cérébrale qui le poussait au travail, au milieu des événements
les moins faits pour le favoriser, dura jusqu'à l'armistice. Alors, il lui
sembla que tout s'éteignait en son esprit, qu'il n'avait été jusque-là que
l'interprète d'un sentiment collectif et que le silence devait être désormais
sa règle.
La
guerre finie, il reprit sa tâche de vulgarisateur. II avait fait, entre temps,
exécuter avec succès un Stabat Mater représentant cet envoi de Rome qui
lui coûtait tant de soins et avait eu sur son esprit une direction si contraire
à ses aptitudes originelles.
La
publication de deux volumes de mélodies populaires, représentant quatre années
de travail, deux voyages en Grèce, occupèrent sa vie jusqu'en 1878.
II
fit alors au Trocadéro sur les mélodies grecques recueillies et étudiées
pendant ces voyages une conférence dont le succès le désigna au choix du
Ministère des Beaux-Arts comme professeur de l'Histoire de la musique
dramatique au Conservatoire.
C'est
en poursuivant cet enseignement public qu'il a retrouvé la vocation du théâtre.
C'est en analysant les oeuvres des maîtres du siècle dernier qu'il a repris le
goût de la composition dramatique. Il s'est alors jeté dans cette voie avec
l'âpre ardeur et la rude volonté de ceux de la race bretonne, dont il est, son
sens critique longuement épuré lui a permis de voir avec une rare précision ce
qu'il convenait de faire. Son premier objectif a été de portraiturer aussi
fidèlement que possible le coeur humain ; il s'est soucié ensuite d'une
sérieuse ethnographie musicale ; il a cherché, selon sa propre expression, à se
faire le sang des gens du pays dans lequel se passe le drame qu'il a choisi.
Il
a écrit, dans ces conditions et dans ces dispositions particulières, d'abord Bretagne,
un ouvrage de longue haleine, que le public sera appelé plus tard à connaître,
et ensuite Thamara, opéra en quatre tableaux, devant lequel, par grâce
spéciale, s'est ouverte l'Académie nationale de musique.
Louis
GALLET. »
(L'Ouest-Artistes,
5 mars 1892, p. 4-5)
« Les
obsèques de M. Louis-Albert Bourgault-Ducoudray, compositeur de musique,
professeur honoraire au Conservatoire national de musique de Paris, membre de
l'Académie royale de Belgique, officier de la Légion d'honneur, etc., etc., ont
été célébrées hier à dix heures, en l'église Notre-Dame d'Auteuil. Le deuil
était conduit par MM. Charles Bourgault-Ducoudray et Jacques Bourgault-Ducoudray,
capitaine au 124e d'infanterie, ses fils M. Henri Besnier, capitaine au long
cours, son gendre. [...] L'inhumation a eu lieu au cimetière Montparnasse, où
des discours ont été prononcés par M. Emanuel, professeur au Conservatoire M.
Henri Hirchmann, commissaire de la Société des auteurs et compositeurs de
musique M. Poilpot, président de l'Association des médaillés militaires, et M.
Julien Tiersot, bibliothécaire au Conservatoire, au nom des élèves du
maître. »
(Le
Figaro, 8 juillet 1910, p. 2)
Collecte : Olivier Geoffroy
(mars 2021)
Consultez aussi: Voyage à Paris en 1866

|

|
 Louis Bourgault-Ducoudray, Contemplation sidérale pour piano, 5ème pièce du recueil Esquisses d’après nature publié à Paris en 1905 par Emile Leduc. Nouvelle édition avec signature autographe du compositeur in Musica, supplément au n° 52 de janvier 1907, avec en commentaire “Morceau de moyenne difficulté d’interprétation, d’un sentiment très élevé.” (coll. et numérisation Max Méreaux). Fichier audio par Max Méreaux (DR.) Louis Bourgault-Ducoudray, Contemplation sidérale pour piano, 5ème pièce du recueil Esquisses d’après nature publié à Paris en 1905 par Emile Leduc. Nouvelle édition avec signature autographe du compositeur in Musica, supplément au n° 52 de janvier 1907, avec en commentaire “Morceau de moyenne difficulté d’interprétation, d’un sentiment très élevé.” (coll. et numérisation Max Méreaux). Fichier audio par Max Méreaux (DR.)
|
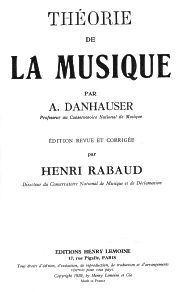 |
Page de couverture de la Théorie de la musique, par Danhauser, édition revue et corrigée par H. Rabaud. Paris, éditions H. Lemoine, 1929
( coll. B.H.M. )
|
Adolphe DANHAUSER (1835-1896)
 |
Adolphe Danhauser. Photo Berger, Paris, ca
1890.
( BNF Richelieu )
|
Né le 26 février 1835 à Paris et décédé le 9 juin 1896, Adolphe-Léopold Danhauser est encore très connu des jeunes musiciens en herbe de part sa Théorie de la musique, éditée chez Lemoine en 1872 et sans cesse rééditée depuis ce jour. Elève d’harmonie de Bazin et de fugue et composition d’Halévy et de Reber au CNSM, Danhauser obtint un premier Second Grand Prix de Rome en 1863. Il se livra ensuite fort jeune à l’enseignement et après avoir été répétiteur d’une classe de solfège au CNSM en devint rapidement titulaire (classe des élèves chanteurs). En août 1875, il fut également nommé inspecteur de l’enseignement du chant dans les écoles de la ville de Paris. On lui doit la musique du drame musical en un acte avec chœurs Le Proscrit, représenté le 31 décembre 1866 à Auteuil par les élèves de l’Institution Notre-Dame des Arts, un opéra en trois actes : Maures et Castillans, ainsi qu’un recueil de 12 chœurs à trois voix égales intitulé Soirées orphéoniques. Si sa Théorie de la musique connut un grand succès et fut éditée dans plusieurs pays (Italie, Espagne, Portugal), il en est de même pour son autre ouvrage pédagogique : Questionnaire... Appendice, paru en 1879. Ces deux ouvrages sont toujours disponibles de nos jours chez l’éditeur Lemoine (17, rue Pigalle, 75009 Paris) !
Denis HAVARD DE LA MONTAGNE
(notice provisoire)
1863
 |
Page de garde de la mélodie Pensée d'Automne écrite par Massenet sur une poésie d'Armand Silvestre. Cette pièce pour chant et piano est dédicacée à la soprano américaine Sibyl Sanderson (1865-1903) pour laquelle l'auteur écrivit Esclarmonde (1889) et Thaïs (1894). Paris, Au Ménestrel, éditions Heugel et Cie
( coll. DHM )
|
Jules MASSENET (1842-1912)
 |
Jules Massenet (1842-1912), Grand Prix de Rome 1863,
professeur de composition au Conservatoire de Paris,
compositeur de musique théâtrale, membre de l'Institut,
photographié en 1910 devant sa propriété à Egreville
( photo Ruck )
|
Né le 12 mai 1842 à Montaud (Loire), décédé le 13 août 1912 à Paris, Jules Massenet, initié à la musique par sa mère, a effectué ses études musicales au Conservatoire de Paris, où il est entré en 1853. Élève d'Adolphe Laurent (piano), de Bazin et de Savard (contrepoint), de Benoist (orgue), de Reber et d' Ambroise Thomas (composition), il obtient le 1er Grand Prix de Rome en 1863 avec la cantate David Rizzio... Bien qu'on lui doit des pages instrumentales et vocales, parmi lesquelles des mélodies, des oratorios et de la musique religieuse, c'est le théâtre qui l'attira plus particulièrement. Parmi ses nombreux opéras, citons plus particulièrement Manon (Opéra-Comique,1884), Werther (Vienne, 1892), Thaïs (Opéra,1894) et Le Jongleur de Notre-Dame (Monte-Carlo,1902). Considéré comme l'héritier de Gounod, son style puissant lui a permis de réussir pleinement, en raison d'un sens inné du théâtre et de ses solides connaissances musicales. Successeur de Bazin à l'Institut (1878), il professe la composition au Conservatoire de Paris et compte parmi ses élèves bon nombre de musiciens de grande valeur : Gustave Charpentier, Alfred Bruneau, Charles Koechlin, Florent Schmitt, Henri Rabaud, Paul Vidal, Gabriel Pierné, Max d'Ollone, Georges Enesco, Ernest Chausson, Guy Ropartz...
D.H.M.
Articles sur une page spécifique: Massenet
Autre article: Massenet et l'Opéra de Monte-Carlo
 |
 |
 |
Page de couverture, détail de la couverture et premières mesures de la Méditation extraite de la comédie lyrique en 3 actes Thaïs, composée en 1892 et créée à l'Opéra de Paris le 16 mars 1894, sur des paroles de Louis Gallet d'après Anatole France
( transcription pour piano seul, Au Ménestrel/Heugel, 1922, coll. DHM )
|

 La Méditation, Marie-Pascale Gobeil (violon) et Céline Boisvert (piano),
La Méditation, Marie-Pascale Gobeil (violon) et Céline Boisvert (piano),
30 mars 2006, Conservatoire de musique de Saguenay, Québec (Canada)
Vidéo MP4 par Michel Baron
La Bibliothèque nationale du Québec propose en ligne seize enregistrements anciens de pièces vocales de Massenet :
http://www4.bnquebec.ca/musique_78trs/mc254.htm
Charles CONSTANTIN (1835 – 1891)
Chef d’orchestre, violoniste, compositeur, Charles Constantin fut un rival de Massenet au Concours de Rome. Tous deux, élèves de composition d’Ambroise Thomas, décrochèrent la même année (1863) un prix à cette prestigieuse institution : Massenet le 1er Grand Prix, Constantin le 2e Grand Prix, après une mention honorable obtenues les années précédentes (Massenet en 1862 et Constantin en 1861). Par la suite, ils firent carrière dans le théâtre, le premier comme compositeur, le second comme chef d’orchestre et directeur, mais autant Massenet est à l’honneur de nos jours, autant Constantin est ignoré de tous.
 |
Signature autographe de Jean Constantin (né en 1797 à Lyon) apposée sur l'acte de naissance de son fils Titus Charles en 1835 à Marseille
( D.R. )
|
Bien que né à Marseille le 7 janvier 1835, au domicile de ses parents situé 14 rue Thiars, Titus Charles Constantin est issu d’une famille savoyarde. C’est son père Jean, exerçant la profession de chapelier, qui s’était installé dans la capitale phocéenne quelques années avant son mariage célébré le 14 août 1830 avec une marseillaise, Marie Bourrely, fille d’un marchand de vin. Jean Constantin, né à Lyon le 21 avril 1797, était fils d’André Constantin, également chapelier de son état, originaire de Bonneville en Savoie… Ne pratiquant pas la musique les parents Constantin l'apprécient néanmoins et font effectuer à leur jeune fils ses premières études musicales avec l’apprentissage du violon. Monté à Paris par la suite, il entre au Conservatoire de musique et de déclamation et en juin 1858 est admis dans la classe de composition d’Ambroise Thomas, où il est rejoint en novembre 1860 par Massenet. Au bout de quelques années, il se présente en 1861 au Concours de l’Institut avec la cantate Atala (paroles de Victor Roussy) et remporte la mention honorable. L’année suivante, il se représente, mais échoue dès la première épreuve de fugue. De nouveau candidat en 1863, sa cantate David Rizzio (paroles de Gustave Chouquet), exécutée à l’Institut le 29 juin par Mlle Baretti (soprano), MM. Léon Duprez (ténor) et Petit (baryton) lui vaut cette fois le second Grand Prix. Dès lors commence pour lui une carrière de chef orchestre et de directeur de théâtre. Le peintre et directeur de la Société nationale des Beaux-Arts Louis Martinet l’engage comme chef d’orchestre dans sa nouvelle salle de spectacles le Théâtre des Fantaisies-Parisiennes, situé 26 boulevard des Italiens à Paris et inauguré le 2 décembre 1865. Arthur Pougin, continuateur de la Biographie universelle des musiciens de Fétis, nous livre quelques détails intéressants quant à la place éminente que Constantin tint dans ce théâtre :
"… c'est à son influence, à son action intelligente, à ses goûts réellement artistiques, qu'on dut de ne pas voir verser ce théâtre dans l'ornière de l'opérette prétendue bouffe, alors si fort à la mode, et qu'on le vit au contraire s'engager résolument dans la voie du véritable opéra-comique, accueillant à bras ouverts les jeunes compositeurs, mettant au jour d'intéressantes traductions d'opéras étrangers, tels que Voie du Caire, de Mozart, la Croisade des Dames, de Schubert, il Campanello, de Donizetti, Sylvana, de Weber, et enfin reprenant d'adorables chefs-d'œuvre du vieux répertoire français, dont l'Opéra Comique semblait ne plus se soucier : les Rosières, le Muletier, d'Hérold ; le Déserteur, de Monsigny ; le Sorcier, de Philidor ; le Nouveau Seigneur du village, le Calife de Bagdad, la Fête du village voisin, de Boieldieu, etc., etc. Avec un orchestre incomplet, des chœurs insuffisants, un personnel de chanteurs très secondaires, mais auxquels il savait communiquer sa flamme et son ardeur, M. Constantin, qui ne ménageait ni son temps ni sa peine, obtenait des résultats surprenants au point de vue de l'exécution, et attirait l'attention générale sur ce petit théâtre, dont il était en réalité le moteur et le soutien."
Devenu "quatrième théâtre lyrique", le Théâtre des Fansaisies-Parisiennes emporte un vif succès, mais sa salle de 400 places est à présent trop exiguë et l’oblige à déménager tant la foule des parisiens qui s’y rue à chaque représentation est importante. C’est ainsi que Martinet s'installe dans la salle de l’Athénée (17 rue Scribe), récemment libérée, afin d'y poursuivre ses activités sous la nouvelle appellation de Théâtre lyrique de l’Athénée (avril 1869). La guerre de 1870 interrompt ses triomphes encourageants, en grande partie dus à la direction artistique de Charles Constantin qui a su élargir son répertoire avec de "véritables grands opéras, sérieux ou bouffes, tels que les Brigands, de Verdi, les Masques (Tutti in maschera), de M. Pedrotti, le Docteur Crispin, des frères Ricci."
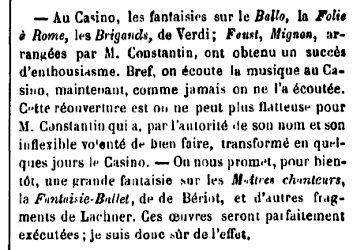 |
1871 : bref compte-rendu des concerts du Casino de la rue Cadet à Paris
( L'Europe Artiste, 3 décembre 1871 ) D.R.
|
Une fois les hostilités terminées, Constantin est engagé par Daudé au Casino de la rue Cadet (n° 18), dès sa réouverture le 20 septembre 1871, comme directeur musical ; les bals étant alors dirigés par Olivier Métra. Dans cette grande salle de bals et de concerts, fondée en 1859 par Pelagot, il doit assurer la direction de 3 grands concerts par semaine (mardi, jeudi, samedi) au cours desquels on peut entre "de grandes œuvres de toutes les écoles, exécutées par un orchestre hors ligne", à l’instar des Concerts Pasdeloup. Renouvelant totalement le répertoire, il donne l’occasion au nombreux public présent d’entendre des chefs d’œuvre anciens et modernes de toute nature : oratorio, symphonies, marches, ouvertures, sonates…Bien que son passage au Casino-Cadet soit de courte durée, sa direction est soulignée dès le début par la presse ; un journaliste de L’Europe Artiste écrit en effet dans le tirage du 29 octobre 1871 : "Nous avons entendu un orchestre qui ne le cède à aucun autre sous le rapport de l’ensemble et de la délicatesse des nuances. Les solistes sont de premier ordre", ajoutant que M. Constantin "est un musicien d’infiniment de sentiment.", et dans celui du 5 novembre suivant : "le Casino, si brillant pendant nombre d'années, s'est vu tout à coup délaissé, grâce à une administration transitoire dont les fautes échappent a notre indulgence. Aujourd'hui, M. Daudé, l'ancien administrateur, a repris courageusement le gouvernail en main. Il a su grouper autour de lui des artistes d'un mérite incontestable et incontesté, sous la direction du jeune et éminent Charles Constantin. Aussi le Casino n'a pas tardé a reprendre ses anciennes splendeurs, tout en devenant l'un des premiers orchestres de Paris où figurent les célébrités du jour. Chaque samedi, les œuvres de nos grands compositeurs y sont interprétées d'une façon magistrale. La partie vocale est confiée à de célèbres chanteurs, parmi lesquels j'ai cru reconnaître une partie du personnel de l'Opéra. Avec de tels éléments, le succès n'est pas douteux. Déjà les dilettantes ont repris avec empressement le chemin du Casino..."
Après un nouvel engagement de quelques mois à l’Athénée (1872-1873) jusqu’à sa fermeture arrivée en décembre 1873 (réouvert en juin 1874, sous la direction de Noël Martin, mais ne sont alors joués exclusivement que le drame intime, la comédie et le vaudeville), Constantin est appelé par Hippolyte Hostein pour diriger l’orchestre dans son nouveau Théâtre de la Renaissance, qu’il vient de construire 20 boulevard Saint-Martin. Inauguré le 8 mars 1873 (salle de 750 places), on peut alors y entendre des comédies, des drames, des vaudevilles, ainsi que des opérettes et des opéras-comiques. Parmi eux citons La Famille Trouillat, opérette bouffe de MM. Crémieux et Blum avec une musique de Léon Vasseur qui est "vive, fraîche, accorte" et comporte "des mélodies charmantes", ainsi que "des chœurs fort réussis" [L’Europe Artiste, 20 septembre 1874] et Giroflé-Girofla, opéra bouffe en trois actes, paroles de MM. Vanloo et Leterrier, musique de Charles Lecocq (11 novembre 1874). Trois années plus tard, en janvier 1876, il succède à Adolphe Deloffre, récemment décédé, à la tête de l’orchestre de l’Opéra-Comique, mais l’expérience est écourtée par l’arrivée d’un nouveau directeur, Léon Carvalho : celui-ci ne renouvelle pas son contrat et nomme à son poste Charles Lamoureux (septembre 1876) ! Parallèlement à ses activités de direction au Théâtre de la Renaissance, Constantin effectue également une saison au Théâtre Italien de la Salle Ventadour à sa réouverture le 8 octobre 1874.
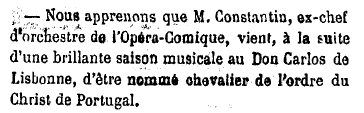 |
1878 : annonce de la nomination de chevalier de l'Ordre du Christ par le roi du Portugal
( L'Europe Artiste, 21 juillet 1878 ) D.R.
|
Mais, de santé fragile, Charles Constantin quitte Paris, continuant cependant de diriger des orchestres. On le trouve en effet quelque temps au Théâtre du Capitole de Toulouse, puis "premier chef d’orchestre" au Théâtre royal San Carlos de Lisbonne. Le journal L’Europe Artiste du 5 mai 1878 apporte des détails sur le répertoire en vogue à cette époque dans la capitale portugaise : "Lisbonne. Les représentations de la troupe française d’opéra comique marchent à souhait. Elles ont commencé par le Songe d’une nuit d’été d’Ambroise Thomas, où le ténor Dereims et sa femme, Mme Devriès-Dereims, ont été fort applaudis. Zampa, avec Lhérie et Mengal, le Domino noir, le Pré aux clercs, Mignon, Si j’étais roi, Fra Diavolo, ont été donnés ensuite. Le public, plus habitué à l’opéra italien qu’à ce genre aimable et élégant, s’y est fait pourtant sans peine ; l’aristocratie et la cour donnent l’exemple de l’assiduité. L’orchestre, sous la direction de M. Charles Constantin, marche fort bien…" Celui-ci, qui "reçoit des ovations sans nombre" de la part du public portugais, après "une brillante saison musicale au Don Carlos" est nommé en juillet 1878 chevalier de l’Ordre du Christ par le roi Louis 1er. Cette même année, de retour en France "l’habile maestro" est engagé par le Casino de Royan comme directeur artistique et chef d’orchestre. Là, "M. Constantin, qui est non seulement un grand artiste, mais encore un excellent organisateur, nous donne des opéras comiques, montés et chantés avec un goût digne d’éloges." On peut en effet y entendre de brillants concerts, mais encore assister à des représentations théâtrales très prisées, notamment les Trois Parques (Vilhem), les Dragons de Villars, la Traviata, le Maître de Chapelle, Galathée… Il s’y produira durant chaque saison estivale jusqu’à son décès arrivé 13 ans plus tard. A cette même époque, il s’installe à Pau et est engagé comme chef d’orchestre du Théâtre, poste qu’il occupera également jusqu’à sa disparition. C’est le 26 novembre 1878 qu’il donne son premier concert dans cette ville
Officier de l’Instruction publique, Charles Constantin est mort à Pau le 27 octobre 1891, en son domicile de la "Maison Pellanne", 7 place Gassion. "Chef de l’orchestre municipal", alors âgé de 56 ans, il était veuf de Blanche Victoire Legendarme. C’est l’organiste Pierre Lespine (né vers 1829), domicilié à Pau, qui effectue la déclaration de décès le même jour, en compagnie d’Antonin Four, secrétaire de la Mairie de Salies-de-Béarn.
Bien que très pris par ses activités de direction d’orchestres, avec lesquelles il s’ingéniait scrupuleusement à offrir un répertoire varié et d’une valeur réelle, tout en ne négligeant nullement la qualité des interprétations, Charles Constantin ne délaissa jamais la composition. Si ses oeuvres n'ont pas résisté au temps, on lui connaît cependant un ballet en 2 actes, Bak-Bek, représenté au Grand Théâtre de Lyon en janvier 1867, une cantate, Salut, donnée au Théâtre de l’Athénée à Paris, le 15 août 1867, un opéra-comique en 1 acte, Dans la forêt, joué dans ce même théâtre le 2 juin 1872 et plus tard à Pau (Paris, E. & A. Girod), une Ouverture Villageoise et une Scène de pantomime exécutées également à Pau, ainsi que plusieurs autres pages orchestrales écrites pour les divers orchestres qu’il fut amené à diriger au fil de sa carrière, parmi lesquelles des Fantaisies sur la Folie à Rome, sur le Ballo in maschera, sur les Brigands, sur Giselle, sur Faust, sur Mignon…données par l’auteur au Casino-Cadet en 1871, et Rolla (janvier 1872). On lui doit aussi des arrangements pour chant et piano de l’opéra-comique La Jolie parfumeuse et de l’opérette Pomme d’Api d’Offenbach (Choudens), et de l’opéra bouffe Une Folie à Rome de Frederico Ricci (Escudier). Cet opéra avait d’ailleurs été donné sous sa direction, en 1ère audition en France, le 30 janvier 1869 aux Fantaisies-Parisiennes et lui avait valu les éloges de la presse [La France musicale, 7 février 1869].
Denis Havard de la Montagne
 Charles Constantin, romance "Des refrains de notre Provence", extraite de l'opéra-comique en un acte Dans la forêt, paroles de Jules Ruelle, représenté au Théâtre lyrique de l'Athénée le 2 décembre 1872 et dédicacé "à mon ami Georges Bizet". Partition pour piano et chant (Paris, E. & A. Girod, éditeurs, 16 boulevard de Montmartre, 1873/coll. BNF-Gallica) DR.
Charles Constantin, romance "Des refrains de notre Provence", extraite de l'opéra-comique en un acte Dans la forêt, paroles de Jules Ruelle, représenté au Théâtre lyrique de l'Athénée le 2 décembre 1872 et dédicacé "à mon ami Georges Bizet". Partition pour piano et chant (Paris, E. & A. Girod, éditeurs, 16 boulevard de Montmartre, 1873/coll. BNF-Gallica) DR.
Partition au format PDF
Fichier audio par Max Méreaux (DR.)

|
Théâtre de La Fenice à Venise
(photo DHM, mai 2017) DR.
|
Gustave RUIZ (1840 - 1891)
Ce
musicien nivernais est ignoré des biographes et musicologues. Aucun
dictionnaire ou autres ouvrages musicologiques ne le mentionne, en dehors de
Pougin en 1867 dans son supplément à la Biographie universelle des musiciens
de Fétis qui lui consacre quelques lignes. Il est vrai, que jusqu'à nos
recherches, on perdait sa trace en Italie à la fin des années 1870, et que,
reconverti dans les affaires, il n'avait guère évolué dans le monde musical du
XIXe siècle. Son œuvre, très restreinte, avait eu peu d'écho.
Gustave-Raphaël
Ruiz est né le 6 mars 1840 à Nevers (Nièvre). Sa famille est originaire de
Naples, alors situé dans le Royaume des Deux-Siciles, où son grand-père, Gaëtan
Ruiz, est dans les années 1820 « Capitaine au Collège militaire Royal de
Naples ». C'est sans doute dans cette ville qu'il s'est marié vers 1790
avec Clorinde Pollano et de cette union va naître le 18 décembre 1794 Ferdinand
Ruiz, le père de Gustave. Celui-ci, entrepreneur de travaux publics installé en
France, spécialisé dans la construction de ponts (notamment ceux de
Saint-Thibault-Saint-Satur sur la Loire et de La Celle-Bruère sur le Cher),
travaille sous la Restauration à la construction du Canal du Berry traversant
Bourges. C'est là qu'il épouse en 1828 Eulalie Lemoine, la fille d'un notaire
et sœur du vice-président du Tribunal civil de Nevers. Installé d'abord à
La-Charité-sur-Loire ou il est « entrepreneur du Canal latéral à la
Loire », puis à Nevers et enfin à Paris, Ferdinand Ruiz est préfet de la
Nièvre (juillet à décembre 1848) et candidat malchanceux aux élections
législatives de 1848. A Nevers, où Gustave passe sa jeunesse, on ignore à
l’origine quel maître l'initie à la musique. Quoi qu'il en soit, il entre vers
1855 au Conservatoire de musique et de déclamation de Paris, où il fréquente
notamment la classe de fugue et de contrepoint de Leborne. En 1863, il se
présente au Concours de Rome avec la cantate David Rizzio de Gustave
Chouquet et le 4 juillet le jury réuni à l’Institut lui décerne une Mention
honorable. C’est Massenet qui décroche le Grand Prix. Les exécutants de l’œuvre
de Ruiz lors de cette séance sont Mlle de Taisy, de l’Opéra, qui se produit la
même année dans Le Comte d’Ory, ainsi que MM. Colomb et Caron.
A
cette époque le Prix de Rome permet souvent aux jeunes musiciens de débuter
brillamment une carrière et, surtout, leur fait découvrir l’Italie aux frais du
gouvernement, véritable foyer d’artistes propice à la création artistique.
Gustave Ruiz tente plusieurs fois d’obtenir l’ultime récompense, notamment en
1865 où il prend part au concours d’essai en planchant sur le Chœur des
heures et des saisons, extrait du Phaéton de Quinault, mais toutes
ses tentatives restent vaines. Il se rend alors en Italie à ses propres frais,
et parvient à faire jouer, en avril 1870 au Théâtre de la Fenice à Venise, un
opéra de sa composition, en 3 actes et 23 scènes, intitulé Orio Soranzo,
sur un livret de Giorgio Tommaso Cimino (Venezia, Tipografia del Commercio,
impresa Scalaberni edit.). Cette exécution est dirigée par Clemente Castagnari
et Domenico Acerbo (chef de chœur), avec les soprani Emilia Leonardi (Bianca
Mocenigo) et Erminia Spitzer (Zulema), les ténors Emilio Pancani (Orio Soranzo)
et Carlo Fiorini (un Capitaine), le baryton Giuseppe Mendioroz (Masaleno) et la
basse Paride Povoleri (Malipieri). Le succès n'est hélas pas au rendez-vous.
Peu après, il envisage d'écrire un autre opéra sur la Conjuration d'Amboise
de Gustave Flaubert, mais il est probable que ce projet est abandonné. C'est du
moins ce qu'il ressort dans une correspondance de Flaubert adressée à Philippe
Leparfait, datée de 1872, dans laquelle l'auteur de Madame Bovary écrit
"… Un protégé de la maréchale Canrobert, M. Gustave Ruiz, m'a demandé la
permission de faire un opéra sur la Conjuration d'Amboise, mais je n'en
entends plus parler…" [1]
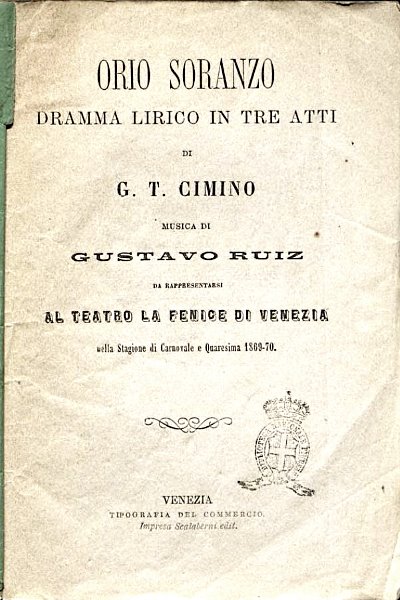
|
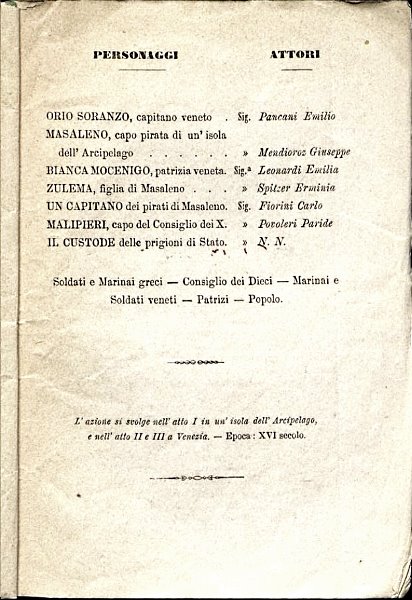
|
Page de garde et distribution du livret du drame lyrique en 3 actes Orio Soranzo "da rappresentarsi al teatro La Fenice di Venezia nella stagione di Carnovale e Quaresima 1869-70"
( Venise, Tip. del Commercio, Bibliothèque Nationale Centrale de Venise ) DR.
|
A
la même époque, en 1870, il demande au poète et folkloriste Achille Millien
(1838-1927), l'un de ses anciens camarades de classe du Lycée de Nevers, de
transcrire le drame de Victor Hugo : Marion Delorme, en un poème d'opéra
en 4 actes.[2]
Le poète s'exécute, mais, si le compositeur en a bien écrit la musique, cet
opéra ne parait avoir jamais été donné.[3]
La guerre de 1870 est probablement la cause de cet abandon, d'autant plus que
Gustave Ruiz semble bien y prendre part en tant que militaire engagé. En effet,
peu après, le 16 octobre 1875 il est nommé lieutenant en premier d'un escadron
de chasseurs à Auxonne (Côtes-d'Or) dépendant du 8e Régiment territoriale de
cavalerie (basé à Dijon).[4]
Par la suite, au début des années 1900, le même Achille Millien, publiait les
chansons qu'il avait recueillies dans le Nivernais à partir de 1877, faisant
appel à son camarade Ruiz pour la notation des mélodies, mais il devra renoncer
"le pauvre Ruiz [ayant été] enlevé par la mort en pleine jeunesse".[5]
Le
4 décembre 1877, au Théâtre communal de Bologne (Italie), est joué un nouvel
ouvrage dramatique de Ruiz : l'opéra seria en 4 actes Wallenstein, sur
un livret d'Achille de Lauzières et Enrico Panzacchi d'après la trilogie de
Schiller (Bologna, tip. Successori Monti, 1877). Mais, cette œuvre, chantée par
Mme Musiani et MM. Clodio, Souvestre et Novarra, à nouveau ne rencontre pas le
succès escompté.
Plus
tard, on le retrouve domicilié à Paris, 21 place de la Madeleine et le 22
novembre 1889 il dépose un brevet de quinze ans pour l'invention d'une
« boucle à boutons sans ardillons, dite boucle militaire ».
Alors reconverti dans les affaires, la même année, le 4 juin, à l'audience des
criés du Tribunal civil de première instance de Lourdes, il se rend
adjudicateur de l'établissement des Thermes d'Argelès-Gazost (Hautes-Pyrénées)
comprenant l'Hôtel du Parc, la source de Gazost, le casino, le parc de 60.000
mètres, plusieurs terrains attenants, ainsi que tout le mobilier, agencements
et machines garnissant les immeubles concernés, le tout pour une valeur de six
cent cinquante mille francs. L'année suivante, le 21 avril 1890, devant Me
Lefebvre, notaire à Paris, il forme la société anonyme des « Eaux minérales
d'Argelès-Gazost » avec un fonds social fixé à huit cent cinquante mille
francs divisés en 1700 actions de 500 francs, s'en réservant la délivrance de
1300, les 400 autres étant à souscrire. Sont alors nommés
administrateurs : Henri Sazerac de Forge, ancien préfet, Emile de
Beaufort, chef de bureau honoraire du Ministère de la Marine, et Emile
Esnault-Pelterie, architecte ; le vicomte de la Nux étant quant à lui
nommé commissaire chargé de présenter un rapport à l'assemblée générale
annuelle.[6]
Gustave Ruiz est décédé le 10 avril 1891 à Monaco[7] ; âgé de 51 ans, il est alors dit « Sous-chef de bureau au ministère de l'Intérieur ». L'on sait qu'il avait deux frères :
l'aîné, Edouard Ruiz, né le 14 février 1832 à La-Charité-sur-Loire, dont la
destinée est inconnue, et Armand Ruiz, né à Nevers le 26 septembre 1837, qui
est mort le 14 octobre 1910 à Paris, en son domicile de l’avenue Hoche. Entré
dans l'armée piémontaise en 1860, lieutenant, ancien aide de camp du Général
della Rocca à Naples et ami de Gambetta, il se vit confier par ce dernier l’administration
de La Petite République française (fondée en 1877), avant d'être nommé
administrateur de la « Banque française du commerce et de
l'industrie » dès sa création en 1901.
On
raconte que la comédienne Alice Ozy, rendue célèbre par les nombreuses liaisons
qu'elle entretint avec, entre autres, le Duc d'Aumale, Victor Hugo et son fils
Charles, Théophile Gautier, Gustave Doré…, eut certains liens avec Gustave
Ruiz. En effet, durant quelques années elle s'était plu à se faire appeler Mme
Ruiz.[8]
De son vrai nom Julie-Justine Pilloy, née à Paris le 6 août 1820, décédée
célibataire dans cette même ville, le 3 mars 1893, elle était la fille de
Jean-Baptiste Pilloy, bijoutier, et de Caroline Ozi, et la petite-fille
d'Etienne Ozi (1754-1813), bassoniste et professeur au Conservatoire de Paris.
Denis Havard de la Montagne
(2002, dernière révision : 2022)
1864
Victor SIEG (1837-1899)
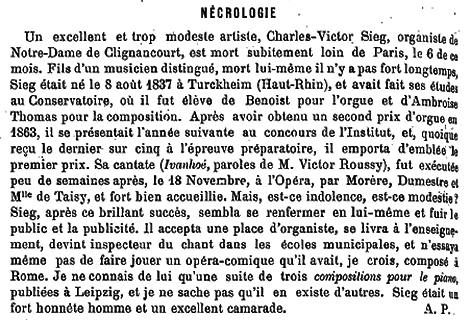 |
Article nécrologique d'Arthur Pougin, in Le Ménestrel, 16 avril 1899
( coll. D.H.M. ) DR
|
On sait que Camille Saint-Saëns ne put jamais obtenir une récompense au Concours de composition de l’Institut où il se présenta vainement en 1852 et 1864. Dès 1852, alors âgé de 16 ans, il était en effet monté en loge pour le Concours de Rome, mais il ne fut même pas nommé ! Douze ans plus tard, après avoir écrit notamment une 1ère Symphonie qui força l’admiration de Gounod et de Berlioz, et un admirable Oratorio de Noël, il se présentait à nouveau, mais ne fut pas plus heureux ! Berlioz lui révélera par la suite qu’une cabale avait été montée contre lui ! Cette année-là un seul prix fut décerné à un compositeur totalement inconnu : Victor Sieg.
Originaire d’Alsace, où il était né à Turckheim le 8 août 1837, Charles-Victor Sieg avait baigné dès sa plus tendre enfance dans la musique, puisque son père, Constant Sieg, pianiste et organiste, était également un compositeur de quelque renommée édité à Paris, chez Mackart. On doit en effet à celui-ci, non seulement des ouvrages pédagogiques : Gammes harmoniques ou gammes par accords, dans tous les tons majeurs et mineurs dans les différentes positions, pour piano ou orgue, op.41 (adopté par les Ecoles Normales), 1er Recueil de compositions faciles pour orgue ou harmonium op.51, mais également des pièces religieuses, avec notamment une Messe facile à deux voix, soli et chœurs, op.50, une Marche religieuse à Notre-Dame des Victoires pour piano ou orgue, op.65, une autre Marche solennelle à Sa Sainteté Pie IX également pour piano ou orgue, op.66 ; ainsi que des romances et autres morceaux faciles : Six Romancines pour enfants, Causeries musicales, op.52-61 (10 morceaux de piano), 15 Romances pour la jeunesse...
Après avoir reçu ses premières leçons musicales auprès de son père, Victor Sieg entra au Conservatoire de Paris, notamment dans les classes d’orgue de François Benoist et dans celle de composition d’Ambroise Thomas. Second prix d’harmonie et accompagnement en 1860, puis d’orgue en 1863, il se présenta au Concours de Rome l’année suivante et obtint le premier Grand Prix, bien qu’il eut été reçu le dernier sur cinq lors des épreuves préparatoires. Sa cantate couronnée, Ivanhoë, sur un texte de Victor Roussy, fut exécutée le 18 novembre 1864 à l’Opéra, notamment par le ténor Morère, qui créera quelques années plus tard, en 1867, le rôle-titre de Don Carlos de Verdi, et la soprano de Taisy, qui paraissait à l’époque dans des ouvrages de Rossini : Guillaume Tell, Le Comte Ory et Moïse.
L’année de son Prix de Rome, il fut nommé premier titulaire du grand orgue de la toute nouvelle église Notre-Dame de Clignancourt, construite par l’architecte Lequeux et inaugurée le 29 octobre 1863. Située place Sainte-Euphrasie, avant de devenir place Jules-Joffrin en 1895, dans le dix-huitième arrondissement parisien, cette église paroissiale était destinée aux habitants du quartier de Clignancourt qui jusqu’alors dépendaient de l’église Saint-Pierre de Montmartre. Gabriel Fauré, en 1870, à l’époque de son retour de Rennes, sera durant quelques mois (mars à août) organiste accompagnateur dans cette église de Clignancourt.
Egalement Inspecteur du chant des Ecoles publiques de Paris, il se livra à l’enseignement, mais ne composa guère. On connaît cependant de Victor Sieg quelques pages pour le piano : Compositions pour le piano, divisées en trois recueils : Trois Impromptus, Tarentelle et Caprice-Valse… Nommé officier d’Académie le 12 juillet 1888, Victor Sieg est décédé le 6 avril 1899 "loin de Paris" d'après Pougin, in Le Ménestrel, et le 10 avril 1899 à Paris, d'après d'autres sources.
Denis HAVARD DE LA MONTAGNE
1865
 |
Charles Lenepveu
( photo Henri Manuel ) DR
|
Charles LENEPVEU (1840-1910)
 |
Charles Lenepveu (1840-1910),
Grand Prix de Rome 1865,
professeur de composition au
Conservatoire de Paris,
élu en 1896 au fauteuil
d'Ambroise Thomas à
l'Académie des Beaux-Arts
( photo Fontaine ) DR
|
Article et fichier sonore sur cette page spécifique.
1866
Émile PESSARD (1843-1917)
 |
Emile Pessard (1843-1917)
( photo Reutlinger )
|
Le 1er décembre 1853 à Paris, lorsqu’ouvraient pour la première fois les portes de l’Ecole de musique de Louis Niedermeyer, destinée principalement à rendre le caractère sacré qu’elle avait perdu au fil des décennies à la musique religieuse, avec notamment l’enseignement du plain-chant comme base, une douzaine d’élèves s’y précipitaient, parmi lesquels Emile Pessard. Celui-ci venait tout juste de fêter ses dix printemps. Clément Loret y enseignait à cette époque l’orgue, Louis Dietsch l’harmonie et Niedermeyer le solfège et la composition musicale. Né à Montmartre, le 29 mai 1853, Emile-Louis-Fortuné Pessard, fils d’Hector, employé aux douanes et flûtiste à ses heures, apprit très tôt le piano et la contrebasse. Dès l’âge de 12 ans il composait d’agréables œuvres, même si celles-ci étaient souvent écrites d’instinct ! Après avoir fréquenté quelque temps l’Ecole de Niedermeyer, il entra au Conservatoire de Paris, dans la classe d’harmonie et accompagnement de Bazin, où il obtint un Premier prix en 1862. Devenu ensuite élève de Carafa, dans sa classe de fugue et de composition il se présenta en 1865 au Concours de Rome. Bien qu’il fut reçu premier au concours préparatoire, il ne put obtenir aucune récompense cette année-là. Seul Charles Lenepveu fut couronné avec sa cantate Renaud dans les jardins d’Armide. L’année suivante, il eut plus de chance avec la cantate Dalila qui lui permit de décrocher le premier Grand Prix, seule récompense décernée pour la troisième année consécutive. Elle fut exécutée à l’Opéra le 21 février 1867. Après le traditionnel séjour à Rome de mars 1867 à décembre 1868, il s’installait à Paris et parvint à donner à l’Opéra-Comique (février 1870) un petit ouvrage en un acte, La Cruche cassée, qui remporta un certain succès. Il écrivait par la suite une douzaine d’œuvres théâtrale : Don Quichotte (Opéra, 1874), Le Char, opéra-comique en un acte avec la collaboration d’Alphonse Daudet (1878), Le Capitaine Fracasse, opéra dont le livret est tiré du fameux roman de Théophile Gautier, Tabarin (Opéra, 1885), Tartarin sur les Alpes (1888), Les Folies amoureuses (Opéra-Comique, 1891), Mam’zelle Carabin (Opéra-Comique, 1893), Une nuit de Noël (1893), L’Armée des vierges (1902), L’Epave (1903).

 Premières mesures des mélodies d'Emile Pessard, Prière de l'Enfant à son réveil, poésie d'Alphonse de Lamartine,
Premières mesures des mélodies d'Emile Pessard, Prière de l'Enfant à son réveil, poésie d'Alphonse de Lamartine,
et Les yeux, poésie de Sully-Prudhomme, parues dans la revue mensuelle La Musique pour tous, Paris, 52 Faubourg Saint-Martin, vers 1910.
( Coll. D.H.M. )
Assurément c’est Le Capitaine Fracasse, en 3 actes et 6 tableaux (Théâtre-Lyrique, 2 juillet 1878), qui fit le plus grand succès de ce compositeur. On pouvait en effet l’entendre à l’Opéra-Comique, au Théâtre-Lyrique, aux Folies-Dramatiques et à l’Opéra-Populaire alors installé au Châtelet. Egalement important compositeur de mélodies, dans lesquelles on reconnaît son écriture légère et parfaitement maîtrisée, on lui doit notamment dans ce domaine un recueil de chansons et mélodies vocales intitulé Joyeusetés de bonne compagnie, la mélodie avec chœur à 3 voix égales : Ne la réveillons pas, et de nombreux autres titres : J’ai dit mon cœur (poésie d’Alfred de Musset), Les yeux (poésie de Sully-Prudhomme), Pourquoi grandir ? (Octave Pradels), Prière de l’Enfant à son réveil (Lamartine), Elle devait m’aimer encore (Th. Maurer), Roses de Noël (Jules Tardieu), Oh ! quand je dors (Victor Hugo), Laissons le lit et le sommeil (Jean Passerat), Le spectre de la rose (Théophile Gautier), Assez dormir, ma belle (Alfred de Musset), Bonjour Suzon (id), Le lever (id.)1.... On raconte qu’un Jour Debussy, alors étudiant, copia de sa main la mélodie de Pessard Chanson d’un fou (Daudet). Quelques temps plus tard, elle était publiée par erreur sous sa propre signature !
Emile Pessard a aussi touché à la musique orchestrale, à la musique de chambre et instrumentale, ainsi d’ailleurs qu’à des pièces religieuses. Citons, parmi sa nombreuse production une Suite d’orchestre, des Pièces et Les Folies amoureuses pour grand orchestre, une Petite Messe solennelle en fa majeur, à 2 voix égales avec orgue ou harmonium, une Messe brève à une voix, un Ave Maria avec accompagnement d’orgue, violon et violoncelle, un quintette Aubade pour instrument à vent (flûte, hautbois, clarinette, cor, basson) écrit en 1882, un Trio pour piano et archets, des Pièces pour piano, une Valse tendre pour piano et flûte...
Si Emile Pessard a été un compositeur fécond, atteignant parfois la notoriété, c’est surtout comme pédagogue qu’il a donné le meilleur de lui-même. Inspecteur du chant dans les écoles communales de la ville de Paris, il fut ensuite nommé en 1881 professeur d’harmonie au Conservatoire supérieur de musique de Paris, où il eut notamment pour élèves Ravel, Gustave Charpentier et Jacques Ibert, tous trois futurs Grands Prix de Rome. Il était également Inspecteur général de l’enseignement musical dans les Maisons de la Légion d’honneur.
Chevalier de la Légion d’honneur en 1879, Emile Pessard est mort le 10 février 1917 à Paris.
Denis HAVARD DE LA MONTAGNE
 Emile Pessard, La Tyrolienne, pour flûte avec accompagnement de piano, op. 75, dédiée “A Monsieur Paul Gennaro” (Paris, Leduc) - Fichier audio par Max Méreaux (DR.)
Emile Pessard, La Tyrolienne, pour flûte avec accompagnement de piano, op. 75, dédiée “A Monsieur Paul Gennaro” (Paris, Leduc) - Fichier audio par Max Méreaux (DR.)
____________
1) Quelques enregistrements anciens (1918-1931) de mélodies d'Emile Pessard, dont Bonjour Suzon, que Léo Delibes mettra également en musique, peuvent être écoutés sur le site de la Bibliothèque Nationale du Québec qui a numérisé ces chansons: http://www4.bnquebec.ca/musique_78trs/mc302.htm [ Retour ]
1867
Pas de premier prix
1868
Alfred PELLETIER-RABUTEAU (1843-1916)
Victor
Alfred Pelletier, dit Rabuteau, est né à Paris le 7 juin 1843, fils de
Pierre-Louis Pelletier et d'Ursule-Lucie Cécile. Entré au Conservatoire de
musique et de déclamation de Paris à la fin des années 1850[1], il obtient un 1er prix
d’harmonie et accompagnement en 1865 dans la classe de François Bazin et un 1er
accessit de contrepoint et fugue l’année suivante dans celle d’Ambroise Thomas.
Il est à cette époque violoniste à l’orchestre du Théâtre Déjazet du boulevard
du Temple. En 1868 il se présente au Concours de Rome avec la cantate (scène à
3 voix) Daniel sur des paroles d’Emile Cicile[2] et décroche le Premier Grand Prix
devant Eugène Wintzweiller. Plus tard en 1881, Debussy planchera sur cette même
œuvre pour l’examen d’essai au Prix de Rome mais ne sera pas admis.
Ernest
Reyer, compositeur et critique musical, dont la sévérité du jugement et la
plume acerbe sont connues, commente ainsi ce concours dans le Journal des
débats du 28 janvier 1869 :
« Aucun des élèves admis l’année
dernière au concours pour le grand prix de composition musicale n'avait été
jugé digne d’être couronné. Cette année-ci, deux concurrents seulement étaient
en présence, et l’administration des Beaux-Arts, ne voulant pas être accusée de
faire des économies, a donné deux premiers prix. Un vers bien connu, que je
n’ai pas besoin de rappeler à M. Wintzweiller ni à M. Rabuteau, leur donnera la
juste mesure de tour triomphe. Peut-être n’y aurait-il eu pour eux ni plus de
péril ni plus de gloire à l’emporter sur un très grand
nombre de rivaux. Le plus clair de leur affaire, c’est qu’ils vont s’en aller à
Rome, et que pendant deux ans au moins ils pourront se promener au gré de leur
fantaisie, et suivant la saison, sous les frais ombrages du Pincio ou sous les
portiques du Vatican ; et ils auront certainement, pendant leur séjour dans la
ville sainte, assez de loisirs pour écrire le pensum de musique religieuse ou
dramatique que les règlements leur imposent. Ne leur envions pas ces deux années
de tranquillité, de calme et de paix. La vie est douce aux pensionnaires de la
villa Médicis, si douce que quelques-uns perdent dans ce dolce farniente toute l’énergie
qui leur serait nécessaire plus tard pour lutter vaillamment et combattre les
obstacles de toute sorte qu’ils sont appelés à rencontrer sur leur route.
Autrefois, en revenant de Rome, ils s’arrêtaient à Vienne et à Berlin, à
Leipzig ou à Dresde, et là, au milieu d’artistes éminents, ils se fortifiaient
à l’audition de belles œuvres et entrevoyaient quelquefois des horizons
nouveaux ; aujourd’hui le voyage d'Allemagne n’étant plus obligatoire (ce
serait, à mon avis, le seul utile), ils s’en dispensent généralement. Confiants
dans leur droit bien plus que dans leur force, ils ont hâte de retourner à
Paris. On sait de quelle façon ils y sont reçus par ceux qui ont pris
l’engagement de les accueillir et de les protéger. J’ai demandé, il n’y a pas
bien longtemps, pourquoi on ne créerait pas en province, dans nos villes les
plus importantes, des places de maîtres de chapelle qui seraient réservées aux
anciens pensionnaires de l'Ecole de Rome et à d’autres jeunes musiciens qui
peur vent bien avoir du talent sans avoir passé par les classes du
Conservatoire. A l’aide d’un simple virement de fonds, le gouvernement
donnerait ainsi à ces jeunes gens les moyens matériels de vivre de leur art, et
de se révéler en même temps comme compositeurs et comme chefs d’orchestre. Ils
n’encombreraient plus, en solliciteurs souvent éconduits, les antichambres de
nos directeurs et ne seraient plus réduits à la triste nécessité de courir le
cachet du matin au soir, le pire des métiers pour un artiste. Et puis, ce
serait un grand pas de fait dans la voie de la décentralisation artistique.
Faut-il rappeler aussi que telle subvention n’a pas toujours suffi à préserver
un théâtre de sa ruine, tandis que d’autres subventions ont été à peu près
inutiles à l’étonnante fortune de certaines entreprises purement spéculatives,
et qui ne devraient avoir aucune part dans les encouragements que le
gouvernement réserve aux progrès et aux belles manifestations de l’art musical
?
Enfin, pour eu
revenir aux deux médiocres cantates (l’une et l’autre se valent) qui, dans les
conditions où elles ont été produites, n’auraient pas mieux réussi si elles
eussent été meilleures, disons que celle de M. Wintzweiller a été chantée sur
la scène du Théâtre-Lyrique, et celle de M. Rabuteau à l’Opéra-Comique [le 19
janvier], par des artistes de l’Opéra. La cantate de M. Wintzweiller a été
exécutée deux fois, et, à la seconde exécution, M. Pasdeloup avait eu la
gracieuseté de revêtir de robes de brocart et d’or les personnages principaux
et les invités du roi de Babylone. C’était une manière de dorer la pilule au
jeune lauréat. L’Opéra-Comique a fait les choses plus simplement : les
chanteurs étaient en costume de ville, et la cantate de M. Rabuteau n’a pas été
répétée le lendemain. On a pensé qu’une seule exécution suffisait. Mlle
Levielli (de l’Opéra) a chanté d’une manière pitoyable le rôle d’Adéna, qui, au
Théâtre-Lyrique, était confié à Mlle
Gilbert. Il paraît que cette prima-donna est sortie du Conservatoire pour
entrer au Théâtre-Lyrique. Si quelque jour j’entends dire le contraire, je n’en
serai point surpris.
Maintenant, jeunes
triomphateurs ou innocentes victimes, partez pour Rome et bourrez votre valise
des partitions des grands maîtres que vous n’avez peut-être pas assez étudiées.
Là-bas les bons exemples vous manqueraient absolument ; mais vous vivrez au
milieu d’autres chefs-d’œuvre qui vous inspireront l’amour du beau, si votre
nature n’y est point tout à fait rebelle. Tous les arts se tiennent par la
main, et, à défaut des grandes solennités musicales perdues pour Rome comme
pour le reste de l’Italie, vous trouverez partout sur votre route des monuments
et des statues, des tableaux dans les musées et des fresques dans les églises,
devant lesquels le musicien et le poète doivent s’arrêter pleins d’admiration
et de respect. Et quand vous reviendrez à Paris, puissent ces nobles souvenirs vous
garder contre de coupables entraînements ! N’écoutez pas surtout ceux de vos
confrères qui, tout en ne résistant pas aux séductions de la mode et du goût le
plus dépravé, vous parleront de la fermeté de leurs croyances et de la pureté
de leurs convictions ! »
Mais,
l'hebdomadaire Le Théâtre illustré, par la voix de son secrétaire de
rédaction, usant du pseudonyme « Maxime », porte lui un jugement
moins sévère (n° 18, janvier 1869):
« M.
Rabuteau est né à Paris, en 1844, et après avoir, travaillé sous les maîtres
Bazin et Ambroise Thomas, il a obtenu trois années de suite le deuxième prix de
composition musicale. Le dernier concours lui a enfin valu la récompense de ses
efforts et de ses travaux, et mardi l'Opéra-Comique exécutait, devant un public
choisi, la grande scène intitulée Daniel, couronnée par
l'Institut.
Le livret de M. Cicile, dont le sujet est
la fin du festin de Baltazar, se ressent de la difficulté de faire exprimer par
trois personnages la fin grandiose de la puissance du roi de Babylone.
La scène commence par une chanson à boire
dans laquelle Balthazar célèbre le plaisir et l'orgueil de sa puissance qu'il
croit inébranlable. Ces couplets, dont le rythme est heureux est aussi original
de possible dans le genre si rebattu de la chanson à boire, sont interrompus
par le bruit lointain du tonnerre, que le roi couvre dû bruit des coupes.
La reine Adéna vient la troubler au milieu
de ses plaisirs et jeter au milieu de cette joie la note lugubre de ses
pressentiments sinistres ; elle a peur de l'avenir ; Balthazar qui est un
esprit fort essaie de la rassurer et ne réussit qu'à moitié, malgré tout le
charme du duo : Viens, des fleurs odorantes ..., une des plus
jolies pages de la partition. Pour la rassurer tout-à-fait, le roi, dans un
accès de témérité dangereuse, se fait apporter un calice, et y boit à Baal, en
défiant le Dieu chrétien ! Devant ce sacrilège, une main de fer trace sur la
muraille le fameux : Mane, Thécel, Farès, qui porte l'épouvante dans
l'esprit de Balthazar vaincu.
Il appelle à lui tous les sages de la
Chaldée, et promet richesses, honneurs à qui expliquera ce mystère ! Le
prophète Daniel s'avance et dit : Ce secret, vous l'allez connaître / De
par l'ordre de Dieu, mon maître ! »
Et dans un air d'une grande simplicité,
mais d'un effet saisissant, il annonce la ruine de Babylone que des fanfares
guerrières lointaines viennent confirmer. Le monarque s'avoue sa défaite, mais
veut combattre encore, tandis que la reine implore le prophète, qui leur dit de
prier.
A la suite d'un trio sans accompagnement,
qu'une seule audition ne suffit pas pour faire apprécier comme il le mérite
sans doute, Balthazar et Adéna adressent au dieu vengeur une prière dont
l'humilité contraste d'une manière très heureuse avec les violences qui ont
précédé. Mais la prière est impuissante, l'empire de Babylone est condamné, et
le palais s'écroule sur le roi éperdu.
Le final, plein de terreur et de
désespoir, a dignement clos cette oeuvre importante du jeune compositeur, dans
laquelle la pensée musicale est presque toujours très claire et parfaitement
adaptée aux passions exprimées au livret.
L'orchestration est d'un maître, et
annonce chez M. Rabuteau une science acquise qui lui permettra de marcher plus
rapidement dans la voie de l'école mélodiste où il y a une belle place à
prendre à égale distance de Meyerbeer et d'Adolphe Adam.
L'exécution a été aussi bonne que possible
dans les conditions de ces sortes de fêtes.
M. Grisy a très bien chanté une partie
très difficile, et M. Ponsard a trouvé dans l'air de la prophétie l'occasion de
développer son magnifique organe et les qualités de son très réel talent.
J'ai gardé pour la fin, contrairement aux
usages, Mlle Levielli, qui a dit avec beaucoup d'énergie tout le
commencement de sa partie, et avec un grand charme les passages de la prière de
la fin. Dans le final elle a eu des accents de terreur qui lui ont valu au
rappel des applaudissements très mérités. Je voudrais bien parler de sa beauté,
mais elle a un ensemble étrange qui m'a frappé, sans que j'aie pu encore me
rendre compte des caractères si singulièrement multiples que donnent à sa
physionomie ses yeux si doux et sa bouche si dédaigneuse. Elle doit être adorée
et crainte en même temps. »
Au
début de 1869, Rabuteau part à la Villa Médicis pour y effectuer le
traditionnel séjour d’où il envoie à l’Académie des Beaux-Arts, comme le veut
le règlement, tout d'abord dès la première année une Sonate pour piano
et violoncelle, puis une Ouverture Le Jugement de Dieu, jouée le 9
novembre 1872 à la séance publique de l'Académie des Beaux-Arts. En 1870, c'est
un oratorio intitulé Le Passage de la mer rouge, qui est exécuté en
public le 23 mai 1874 au Conservatoire, lors d’une séance d’audition des envois
de Rome. A nouveau Ernest Reyer publie un long compte-rendu :
« La
première séance consacrée à l’audition des envois de Rome a eu lieu le samedi
23 mai au Conservatoire. Les musiciens, lauréats de l’Institut, n’auront
bientôt rien à envier aux peintres, aux sculpteurs et aux architectes : rien,
ou du moins peu de chose. Cette première séance avait un très grand intérêt,
parce que c’était la première. On nous conviait dernièrement aux exercices des
élèves ; on nous invite à entendre, quelques jours après, des productions fort
importantes de deux lauréats qui entrent dans la carrière quand leurs aînés y
sont encore ; tout cela, si vous voulez, n’est qu’un retour aux anciens
règlements, mais nous ne demandons pas mieux que de l’accepter comme uns
innovation (il y a si longtemps que l’usage en était perdu) et d’en féliciter
qui de droit.
Il y a dix-huit mois, l’Académie des
Beaux-Arts étant rentrée en possession de ses anciens privilèges, nous
applaudissions dans la coupole de l'institut, en même temps que la cantate de
M. Salvayre, une ouverture de M. Rabuteau. Et nous avons signalé, dans cette
composition symphonique, dans la première partie surtout, de sérieuses qualités
de style, un joli coloris instrumental et certaines tendances qui, même au sein
de l’Ecole, ne sont plus guère considérées comme subversives aujourd’hui. Si
les professeurs se tiennent en dehors du mouvement qui entraîne quelques-uns de
leurs élèves, du moins ne le condamnent-ils pas ostensiblement. Cette ouverture
finissait mal, mais elle commençait bien ; le souvenir que nous en avions gardé
nous faisait augurer favorablement de la nouvelle composition de M. Rabuteau,
bien que d’une ouverture à un oratorio il y ait une assez grande distance à
franchir, avec pas mal d’ornières pour verser en route.
Dans le Passage de la mer Rouge,
s’il n’y a pas d’ornières, il y a la mer, ce qui est tout aussi dangereux, à
moins qu’on ne soit avec les Israélites. Mais, malheureusement, M. Rabuteau a
passé plus d’une fois du côté des Egyptiens, et c’est un miracle qu’il n’ait
pas été englouti avec l’armée du Pharaon qui poursuivait Moïse.
Voilà six ans déjà que M. Rabuteau a
mérité le laurier académique ; voilà six ans que son éducation musicale est
terminée. Le Conservatoire lui ayant appris tout ce qu’il pouvait lui
apprendre, c’était affaire à lui d’apprendre le reste. On dit que le séjour de
Rome met les musiciens en contact journalier avec les chefs-d’œuvre de tous les
arts, excepté avec les chefs-d’œuvre de la musique. C’est bien possible. Mais
il n’en est pas moins vrai que le musicien doué d’un peu d’imagination, qui vit
journellement au milieu de tout ce que les arts plastiques ont produit de plus
parfait, de plus beau, doit en recevoir une impression profonde, ineffaçable.
Les théâtres ne lui enseignent rien, les orchestres sont pauvres, les plus
belles œuvres musicales sont défigurées ; mais la campagne de Rome est
admirable, le paysage a une poésie qui ne se retrouve pas ailleurs, la vie est
facile et le ciel est bleu. Je ne connais pas d’existence comparable à celle
que peut mener un pensionnaire de la Villa Médicis. N’a- t-il pas le libre
emploi de ses loisirs ? Ne vit-il pas dans une atmosphère de travail, entouré
de camarades qui deviennent pour lui, à un moment donné, des auditeurs sympathiques
? Les partitions des grands maîtres manquent-elles à ses études, et ne se
sent-il pas pénétré, au dehors comme au dedans de l’Académie, par les souvenirs
de nos plus grands compositeurs ? Sur cette terre bénie du ciel où Mozart et
Meyerbeer ont vécu, où Mendelssohn a passé, heureux ceux qui vivront et
passeront encore !
Il est possible, comme je l’ai dit plus
haut, que la musique qu’on entend depuis bien des années déjà en Italie soit
loin de répondre aux aspirations de nos jeunes musiciens ; mais je ne vois
pas qu'ils puissent trouver ailleurs des exemples plus vivifiants et des
enseignements plus profitables. Ils ne vont plus guère voir aujourd'hui ce qui
se fait en Allemagne, et je n'ai pas besoin de les édifier sur ce qui se fait
chez nous.
Les merveilles de l’art, les splendeurs de
la nature, les douceurs de l’existence, le travail assidu et la lecture des
chefs-d’œuvre, n’est-ce donc point assez pour éveiller dans une imagination
jeune, ardente, impressionnable, le sentiment du beau ? N’est-ce point assez
pour que les facultés se développent, pour que le talent arrive sinon à son
apogée, du moins à son premier degré de force et de maturité ? Et le musicien
que les meilleurs professeurs ont instruit, le lauréat auquel le gouvernement,
par des libéralités qui l’honorent, fait pendant quatre ans une situation
exceptionnelle, doit-il revenir d’Italie avec des espérances seulement et avec
les vertus d’un solliciteur ? La question de savoir si les théâtres s’ouvriront
un peu plus tôt ou un peu plus tard devant lui n’a jamais été, à mes yeux, la
plus importante. Ce qu’il faut, c’est que son séjour en Italie n’ait pas été
perdu, c’est qu’il revienne de Rome avec une œuvre forte ou gracieuse,
puissante ou originale, avec une œuvre empreinte de sa personnalité et non avec
une ébauche, un pastiche ou quelqu’une de ces productions infimes, misérables,
que la langue musicale se refuse à qualifier. Je n'ai jamais cru à ces génies
incompris qui encombrent pendant des années les antichambres de nos directeurs
de théâtres et emplissent la ville et la cour de leurs gémissements. Le jour
où, par excès de sensibilité ou de lassitude, on cède au désir qui les agite,
ils descendent dans l’arène, l’expérience se fait et on sait ce qu’il en
advient. Si pour quelques-uns ce jour n’est jamais arrivé, c’est vraiment tant
mieux pour eux, car ils gardent intact leur amour-propre et conservent toutes
leurs illusions. Parmi-les uns et parmi les autres, tous ne sont pas allés à
Rome, mais ils forment une catégorie à laquelle les lauréats de l’Institut
apportent un assez nombreux contingent. Les registres du Conservatoire diront à
ceux que cela intéresse les noms de ces musiciens dévoyés ; j’ai déjà eu
moi-même l’occasion d’en citer quelques-uns. Et ce n’est pas seulement sur les
registres de l’Ecole qu’il faut aller les chercher ; on en trouvera aussi un
nombre assez respectable sur les affiches de nos théâtres lyriques.
Je ne puis donc pas considérer comme un débutant,
— et c’est par là que je conclus, — un musicien qui depuis six ans a terminé
ses études. Et d’abord un débutant écrit un fragment symphonique, une
ouverture, un petit drame lyrique, mais il n’écrit pas un oratorio. Me voilà
donc parfaitement à l’aise pour exprimer mon sentiment sur l’œuvre et le talent
de M. Rabuteau.
Le Passage de la mer Rouge, dont les paroles sont de M. Lucien Augé, renferme, y compris
l’ouverture, douze morceaux : récitatifs et soli, chœurs, duo, trio et
fragments symphoniques.
Il est évident que M. Rabuteau, et je ne
l’en blâme point, a une prédilection particulière pour Mendelssohn. On s’en
aperçoit dès le début de l’ouverture, et on retrouve dans la Marche
égyptienne une nouvelle réminiscence de ce maître : le rythme et le contour
mélodique de l'andante de la symphonie en la. Après Mendelssohn, Chopin.
L’accompagnement du chœur n° 4 reproduit d’une façon tellement saisissante le
rythme, certaines harmonies caractéristiques et aussi certaines sonorités de la
Marche funèbre instrumentée par M. Prosper Pascal, que c’est à se demander
si ce n’est pas là une imitation voulue.
La partie symphonique de
l'Oratorio de M. Rabuteau est évidemment la plus faible. On sent chez ce jeune
compositeur la préoccupation de se montrer coloriste ; mais les moyens pour
arriver à ce but lui font souvent défaut. Encore lui pardonnerait-on son
inexpérience à manier l’orchestre s’il faisait à l’oreille quelques-unes de ces
surprises qui indiquent le tempérament, la personnalité du musicien, même à
travers les imperfections de l’œuvre. Mais vraiment, ce n’est pas avec le
tintement d’un triangle ou d’un jeu de timbres qu’on fait de la couleur
orientale, et ce n’est pas davantage avec une pédale de violons décomposée en
groupes de deux, trois et quatre notes, pour arriver à un trémolo assez maigre,
qu’on peint la splendeur imposante d’un lever de soleil sur les montagnes
calcinées de la chaîne arabique. C’est à peine si cela vous
donne l’idée de cette lueur blafarde et crépusculaire que projettent, l’hiver,
les premiers rayons de notre soleil parisien.
Je signalerai une
belle progression dans le chœur n° 6, où la petite flûte jette ses notes aiguës
et stridentes. Est-ce le sifflement de l'aspic de Cléopâtre ? Et, malgré la
réminiscence dont j’ai parlé plus haut, je louerai aussi la péroraison de la Marche
égyptienne, alors que le motif confié aux instruments à
vent reparaît avec un autre sujet exécuté par les instruments à corde pizzicati.
Le duo et le trio
me semblent les morceaux les mieux réussis de la partition. Tous deux sont
écrits pour voix de femmes ; tous deux sont empreints d’un très joli sentiment,
très habilement dialogués et instrumentés avec goût. Le duo surtout a produit
beaucoup d’effet ; mais ces deux morceaux, l’un comme l’autre, ont une valeur
réelle. Les notes graves des trombones et de l’ophicléide donnent assez de
caractère au récit qui précède l’air de Moïse ; le chœur final ne manque pas
d’une certaine ampleur, et ce n’est pas sans raison que je cite ce chœur sans
m’arrêter à la Marche triomphale des Hébreux
et au Passage de la mer Rouge.
Avec la meilleure
volonté du monde, je ne
puis dire à M. Rabuteau que son coup d’essai est un coup de maître. L’attitude
du public, d'un public sympathique, qui
était au venu au Conservatoire avec les dispositions les plus bienveillantes,
aurait même pu influer davantage sur la sévérité de mon jugement... »
(Journal des débats, édition du
mercredi 3 juin 1874).
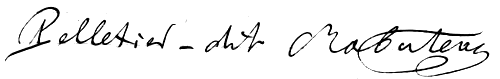
|
Signature autographe,1889
|
Vers
la même époque Alfred Rabuteau compose deux pièces symphoniques, Rome et
Naples, exécutées le 8 mars 1874 aux Concerts du Châtelet d’Edouard Colonne
(un andante pour Rome et une tarentelle pour Naples). Quelques
années plus tard, en mars 1882, séjournant alors à Nice, en collaboration avec
M. Brun, « archéologue, plus connu à la Sorbonne que dans les coulisses
des théâtres », il termine « un opéra-comique – très gai – en trois
actes et cinq tableaux : l’Ecole des Pages. Le sujet est fort
original et la musique paraît devoir faire sensation. » Cette oeuvre est
jouée par la suite à Paris au Théâtre de la Renaissance alors dirigé par
Gravière. Peu après, sur des paroles d'Edouard Guinand, d'après une comédie de
Regnard, son opéra-comique en 3 actes Isabelle est donné sous forme de
concert à Paris, le 12 mai 1884, puis est joué en province avec succès durant
l'été. Au début de l'année suivante, il est nommé Officier d'Académie. Le jeudi
30 juin 1887, c'est la Salle de l'Ecole française de musique et de déclamation
(4 rue Charras) qui l'accueille avec la scène lyrique en deux parties Caïus
Gracchus, sur des vers d'Edouard Guinand, chantée par Mlles Fanny Lépine
(Licinia) et Marie Dihau (Cornelie), MM. Auguez (Caïus), Cazaux (Fulvius) et
Leroy (Senynonius), le choeur et l'orchestre étant placés sous la direction de
Rémi Montardon, directeur de cette école. Le dimanche 6 novembre de cette même
année les Concerts du Château-d'Eau donnent cette oeuvre en seconde audition.
Lors de la première, Jean Weber, le critique musical du quotidien Le Temps
écrit ces lignes quelque peu sévères :
« Dans mon dernier
feuilleton, j’ai annoncé l’exécution de la cantate Caïus Gracchus, de MM. Guinand et Rabuteau, à l’Ecole française de musique et de
déclamation fondée par M. Montardon. M. Rabuteau (Victor-Alfred Pelletier) est
né à Paris le 7 juin 1843 ; en 1868 il a remporté le grand prix de Rome ex
æquo avec Eugène Wintzweiller, compositeur alsacien
né à Wœrth, et qui ne put jouir longtemps de son triomphe ; il est mort en
1870. Le sujet de la cantate de concours était Daniel ; la partition de Wintzweiller fut exécutée au
Théâtre-Lyrique, et celle de M. Rabuteau à l’Opéra-Comique.
On peut également bien
intituler Caïus
Gracchus cantate en deux parties ou drame en deux actes. Caïus succombe en
défendant la cause du peuple, comme son frère Tibérius Sempronius avait
succombé peu de temps auparavant. Dans le scénario de M. Guinand, du moins il
n’est pas
question du premier des Gracchus. Ce que je sais c’est que M. Guinand, pour
donner à son poème le double de l'étendue que comportait le sujet, a abusé des
épisodes. Il y a des chœurs, des morceaux de danse, un air, un duo, un trio, un
quintette, une marche militaire absolument inutiles à l'action ; le serment de
Caïus et les acclamations du peuple ne font que laisser pressentir cette action
: « Caïus salue le peuple, il est heureux de lui apporter les bienfaits de la
paix ; il a voué sa vie à son bonheur et la sacrifierait au besoin pour son
affranchissement et le salut de la République. »
L’action n’occupe donc que la seconde
partie de la cantate. Licinia adjure Caïus, son mari, de ne pas exposer sa vie
; mais Cornélie envoie son second fils se faire tuer comme a été tué le
premier. Marche funèbre : Caïus meurt sur la scène ; le peuple le pleure ;
apothéose représentée par le chœur final.
Le nom de M. Rabuteau m’ayant
laissé pour seul souvenir son prix de Rome, j’ai cherché si j’en trouvais
d’autres dans mes feuilletons. Il y a une fantaisie, Rome et Naples,
exécutée aux concerts du Châtelet et que j’ai traitée avec quelque indulgence ;
puis il y a deux envois de Rome : le Jugement de Dieu, ouverture, et le
Passage de la mer Rouge, oratorio, qui m’ont donné peu de satisfaction. Au
point de vue de grandes compositions vocales ou instrumentales, M. Rabuteau ne
paraît guère avoir fait de progrès depuis son voyage à Rome ; peut-être même ne
s’est-il occupé que de petites compositions. Dans Caïus Gracchus, je
trouve deux défauts que j’avais déjà signalés dans Daniel, c’est que M.
Rabuteau n’évite pas toujours la vulgarité et qu’il se plaît à ressasser les
mêmes motifs, les mêmes phrases au-delà de toute satiété ; ce dernier défaut
devient absolument impatientant dans des hors-d'œuvre comme le sont presque
tous les morceaux de la première partie. Certes, il y a des fragments attestant
une main habile et même une inspiration heureuse quoique rare ; mais on dirait
que M. Rabuteau craint comme la peste les tendances nouvelles. Il ne néglige
pas tout à fait le caractère d’une scène, mais il en écrit la musique sans
beaucoup s’occuper des paroles ; il arrondit ses morceaux, les délaye à
plaisir, en se souciant de l’action scénique comme d’un mirliton. Je crois que s’il
n’avait jamais pu faire jouer une pièce sur un théâtre il aurait plus de souci
du plaisir de ses auditeurs et de la logique musicale. Au surplus, il ne craint
pas d’abuser des notes aiguës des chanteurs, parfois même de leur donner des
modulations peu commodes ; et puis quelle fâcheuse prédilection pour les mesures
à division ternaire ! »

|
Paris, Théâtre de l'Odéon, 8 mars 1898, Jane Rabuteau (au centre) dans le rôle de Dona Luscinde, aux côtés de M. Cornaglia (Le Commandeur) et Eugénie Segond-Weber (Dona Dolorès) dans Don Juan Manara, drame en 4 actes et 5 tableaux d'Emond Haraucourt (DR.)
|
(édition du lundi 4 juillet)
Peu
après, le 5 septembre 1889 à Paris, Pelletier-Rabuteau, alors domicilié 4 avenue
de Clichy, se marie avec Jeanne Pouget, de 15 ans sa cadette, originaire de
Dordogne. A cette cérémonie assistent comme témoins plusieurs personnalités de
l'époque, amies du couple : Edouard Guinand, poète et auteur dramatique,
Edouard Nadaud, violoniste et futur professeur au Conservatoire de Paris, Noël
Tony, sculpteur, Prix de Rome 1868, et Félix Jahyer, littérateur et
journaliste. Mais, la mariée lui est déjà une intime puisque dix ans auparavant
est née de leur relation une fille prénommée Jeanne le 20 mai 1878 à Paris.
Celle-ci, morte à Menton (Alpes-Maritime) le 27 avril 1930, alors veuve de
Thomas Brian Whitney, un Américain de Philadephie installé dans la capitale
qu'elle avait épousé en 1909, fera une carrière d'artiste dramatique, après
avoir effectué ses études au Conservatoire de Paris (1er accessit de comédie en
1895). Connue sous le nom de « Jane Rabuteau » et longtemps attachée
au Théâtre de l'Odéon à Paris, elle crée notamment le rôle de La Muse dans le Déjanire
de Camille Saint-Saëns (Béziers, 28 aout 1898).
En
1890, Alfred Rabuteau participe à la fondation de la nouvelle « Ecole
classique de musique et de déclamation », située 4 rue Charras, dans le
neuvième arrondissement parisien. Cette institution ouvre ses portes en octobre
avec à sa tête pour la partie artistique : le compositeur Edouard Chavagnat
(1845-1913), président, Alfred Rabuteau, vice-président, Sady-Péty, de l'Odéon,
secrétaire, B. Genevois, ténor du Théâtre-Italien, trésorier, J. Gout,
violoniste à l'orchestre de l'Opéra, et Amédée de Vroye, flûtiste. Elle donnera
des auditions d'élèves tous les quinze jours et organisera chaque année des
concours publics jugés par des des notabilités artistiques. L'année suivante,
au mois de mars, il termine l'orchestration d'un drame lyrique en 4 actes
destiné à l'Opéra-Comique : le Vendéen, sur des paroles d'Edouard
Guinand, dont l'action se passe à l'époque des grandes luttes entre chouans et
républicains. Et, à la même époque le 30 avril 1891, une autre comédie lyrique
en un acte, paroles de Fernand Lafargue (Paul Dupont, éditeur à Paris) : Parfum
de race est montée à la Salle Duprez de la rue Condorcet dans une soirée
organisée par le Cercle des Cadets dramatiques ; cette oeuvre est
« lestement enlevée par Félix Barré et Julia de la Blanchetais ».
Puis, le 16 avril 1892 au Nouveau-Théâtre (Paris), dirigé par Borney et
Desprez, est créée la fantaisie en 5 actes de Catulle Mendès et Georges
Courteline Les Joyeuses commères de Paris, scènes de la vie moderne,
dont il a composé une musique nouvelle en collaboration avec Gabriel Pierné
(Paris, Charpentier et Fasquelle, 1892, in-12). Lors de cette même soirée sont
également représentés le ballet des Hamadryanades avec une musique de
Gabriel Pierné et le ballet-pantomime intitulé les Comédiens et les Faunes,
un divertissement extrait des Joyeuses commères de Paris de Rabuteau
(Paris, Durdilly).

|
Alfred Pelletier-Rabuteau, Souvenir de Venise, La Giudecca pour piano
(Paris, G. Hartmann, 19 boulevard de la Madeleine, 1873/coll. BnF-Gallica) DR.
Partition au format PDF
 Fichier audio par Max Méreaux (DR.) Fichier audio par Max Méreaux (DR.) |
Quelques
années plus tard, il concourt au 10e Concours musical de la Ville de Paris,
1900-1903, avec un long drame lyrique en 4 actes, Florizel et Perdita,
sur un poème de Victor-Emile Michelet imité du Conte d'Hiver de
Shakespeare, mais c'est Le Sang de la sirène de Tournemire qui l'emporte
devant La Croisade des enfants de Pierné et Le Christ au désert
de Pons. En réalité, cette pièce lyrique avait été terminée une dizaine
d'années auparavant, en 1893, pour être reçue plus tard en 1896 par M. Carvalho
directeur de l'Opéra-Comique. Programmée pour être donnée au cours de la saison
1896-1897, elle semble finalement ne pas avoir été jouée. Ce n'était pas la première
fois qu'Alfred Rabuteau candidatait à ce concours de la Ville de Paris :
en 1885, il s'était déjà présenté avec la scène lyrique en deux parties Gloria
Victis, sur un livret d'Edouard Guinant, mais le jury réuni le lundi 18 mai
à la préfecture de la Seine, sous la présidence du préfet, M. Poubelle,
couronnait l'œuvre de Vincent d'Indy : Le Chant de la Cloche,
légende dramatique en un prologue et sept tableaux, devant Rubezahl,
légende symphonique en trois parties, sur un livret de MM. Cerfbeer et de
L'Eglise, de Georges Hüe.
Souffrant,
quelques années plus tard il est obligé de quitter Paris pour s'installer à
Nice où il décède le 7 mars 1916, en son domicile du numéro 28 de la rue
Hérold. Son épouse l'avait précédé dans la tombe de quelques années, en 1909.
Retiré de la vie musicale et loin de la capitale, sa disparition est néanmoins
signalée par plusieurs journaux. Parmi ceux-ci, le bi-mensuel de théâtre,
intitulé Les Tréteaux, dans son numéro 9 du 1er mai 1916, publie cet
entrefilet : « Nous avons le regret d'apprendre le décès de M. Alfred
Rabuteau. Compositeur de musique d'une grande valeur, professeur remarquable,
grand prix de Rome en 1868, il remporta de notables succès, dont l'un en
collaboration avec Catulle Mendès. Souffrant, il s'était installé à Nice où il
vivait retiré » et Le Figaro (édition du 18 avril), reprenant cette
dépêche ajoute : « Il laisse une oeuvre considérable inédite, des
partitions, des morceaux de tout genre et un ouvrage sur la composition
musicale d'une forme toute nouvelle, et qu'apprécient hautement ceux qui ont pu
en prendre connaissance. » Concernant ce dernier ouvrage, il s'agit
probablement de ses Partimenti parus en 1888 chez l'éditeur parisien
Emile Bertin.
En
dehors des œuvres déjà citées, Alfred Rabuteau est également l’auteur d’une Sérénade
pour violon et piano (Editions E. Lacombe, 1891), de pièces pour piano éditées
à Paris chez E. Bertin, E. Fromont, Veuve G. Courleux, Hartmann : 4 Grandes
valses brillantes, L’Escholier (grande valse brillante), Le Rêve
(célèbre nocturne), Naples (tarentelle), Souvenir de Venise « La
Giudecca » (1873), Gitana (danse espagnole), Capricciosetta
(mazurka), un recueil de Dix Pièces pour piano, ainsi qu'un Arioso
pour piano publié dans la revue « La Musique pour tous » (n° 158,
16 avril 1898) ; et de mélodies sur des paroles d’Emile Max et Eugène
Leclerc : Aubade à Clairette (P. Dupont), Fanchonette (id.) Prière
à Lison (id.), Amour de fleur (id.), d’Edouard Guinand : Barcarolle
(Jouve), Sérénade champêtre (éditions Jouve, Veuve E. Courleux, Paris),
de V. Emile-Michelet : 10 Rondels fleuris (éditions E. Fromont,
Paris), du baron de Fauconnet : Rose pastorale (Choudens, 1878), Nice
(V.-E. Vauthier, 1878), d'Edmond Teulet : L'Escholier, chanson
d'un autre âge (E. Fromont, 1893), L'Absente, d'A. Augey : 2
Mélodies pour chant et piano (1873)... On lui connaît aussi un quatuor,
dont la partition semble perdue. Celui-ci était en effet interprété en mars
1885 à une séance de concert organisée par les « Quatuors français »,
fondés à Paris en 1881 par MM. Nadaud et Papin, pour lequel un critique musical
du Ménestrel (édition du dimanche 29 mars) écrivait : « la
dernière séance a particulièrement plu, nous y avons entendu pour la seconde
fois un remarquable quatuor de M. Rabuteau, dont le scherzo a été
bissé... »
Denis Havard de la Montagne
(sept. 2004, mise à jour : déc. 2017)
[1]
On connaît un certain
Alfred Rabuteau fréquentant à la même époque l' « Ecole impériale de
dessin, de mathématiques, d'architecture et de sculpture pour l'application des
beaux-arts à l'industrie », de la rue de l'Ecole de Médecine à Paris,
alors dirigée par le peintre Jean-Hilaire Belloc (actuelle Ecole des Arts
décoratifs), qui, le dimanche 28 août 1859 à la distribution des prix dans
l’amphithéâtre du Lycée Louis-le-Grand, reçoit un 4e accessit de « dessin
des plantes » dans la section de dessin. Mais, l'on ne sait à cette heure
s'il s'agit de notre musicien ou d'un homonyme ? [
Retour ]
[2]
Curieux personnage
que cet Emile Cicile. Né le 19 septembre 1829 à Paris, mort le 7 février 1899 à
Versailles, professeur de mathématiques au Lycée de Versailles et de sciences à
l'Ecole régimentaire de génie de cette même ville, officier d'académie, il
était aussi un poète reconnu. A trois reprises ses poèmes furent choisis par
l'Académie des Beaux-Arts pour être mis en musique au concours du Prix de
Rome : Jephté en 1858, Le dernier des Abencérages en 1867 et
Daniel en 1868. En 1877, Henri Maréchal mettait à son tour en musique
l'une de ses œuvres, le poème sacré La Nativité. [
Retour ]
Eugène WINTZWEILLER (1844-1870)
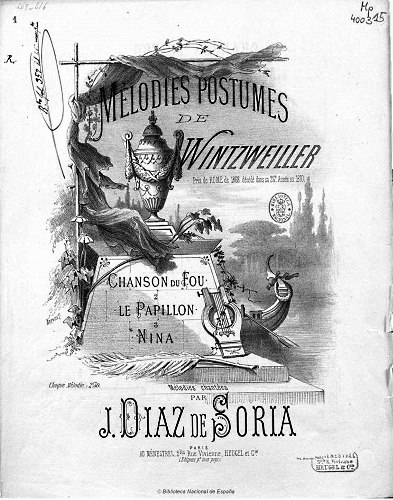
|
 Eugène Wintzweiller, Mélodies posthumes pour voix et piano : Chanson du Fou (Victor Hugo), Joli papillon (Victor Chauvet), Nina (Alfred de Musset), dédicacées "à son ami Jules Diaz de Soria" (Paris, 1874, Au Ménestrel, Heugel et Cie, coll. Bibliothèque Nationale d'Espagne). Fichiers audio avec transcription pour clarinette et piano par Max Méreaux (DR.) Eugène Wintzweiller, Mélodies posthumes pour voix et piano : Chanson du Fou (Victor Hugo), Joli papillon (Victor Chauvet), Nina (Alfred de Musset), dédicacées "à son ami Jules Diaz de Soria" (Paris, 1874, Au Ménestrel, Heugel et Cie, coll. Bibliothèque Nationale d'Espagne). Fichiers audio avec transcription pour clarinette et piano par Max Méreaux (DR.)
|
Né en Alsace, à Woerth (Bas-Rhin), le 13 décembre 1844 et fils de Louis, instituteur à Woerth, puis à Soultz-sous-Foretz, Eugène Wintzweiller a débuté ses études musicales auprès de Joseph Wackenthaler, alors titulaire du grand orgue de la cathédrale de Strasbourg et maître de chapelle. C’est celui-ci qui le recommandera en 1860 auprès de Louis Niedermeyer afin qu’il l’accepte dans son Ecole de musique religieuse, qu’il avait fondée à Paris quelques années auparavant. Wintzweiller reçut dans cet établissement, qu’il quitta en 1863, des leçons de Saint-Saëns à l’époque où il y enseignait le piano. Fauré et Gigout fréquentaient également cette même classe. En juillet 1861, il obtenait un premier accessit de piano et l’année suivante un second premier prix, puis regagnait les classes de Bazin (harmonie et accompagnement), Benoist (orgue) et Ambroise Thomas (fugue et composition) au Conservatoire de Paris. Premier prix d’harmonie et d’accompagnement en 1866, premier accessit d’orgue en 1868, il se vit décerner un Premier Grand Prix de Rome la même année, qu’il partageait avec Alfred Pelletier-Rabuteau. Son séjour à Rome, débuté en janvier 1869, dut malheureusement être interrompu en raison de son état de santé qui s’altérait gravement au fil des mois. Souffrant d’une maladie de poitrine, il dut se résoudre à quitter l’Italie en juin 1870 et se réfugia à Arcachon où le climat était plus favorable. Résidant alors à la Villa Montretout depuis cinq mois, il y mourut le 6 novembre 1870 à la veille de ses 26 ans.
On lui connait quelques oeuvres composées durant ses études au Conservatoire qui consistent en des pages pour piano à 4 mains : Les Originales, valses de salon (Veuve Sulzer, 1868), Souvenirs d'Alsace, six valses (édition posthume en 1886 par A. Leduc), Romance sans paroles (édition posthume en 1903 par Heugel) et des mélodies pour voix et piano sur des poésies de Victor Hugo : Nouvelle chanson sur un vieil air (M. Colombier, 1868), Chanson du fou (édition posthume en 1874, au Ménestrel), de Victor Chauvet : Joli papillon (id.) et d'Alfred de Musset : Nina (id.) ; ces trois dernières au répertoire du chanteur Jules Diaz de Soria.
Il ne semble pas y avoir un lien de parenté avec Alfred Wintzweiller, né le 9 mars 1861 à Hatten (Bas-Rhin), décédé le 2 mai 1931 à Paris VIe, qui, après avoir fait ses études musicales au Conservatoire de Paris, fut durant quarante ans maître de chapelle et organiste de l’église Saint-Germain de Charonne à Paris XXe.
Denis HAVARD DE LA MONTAGNE
(février 2001, mise à jour : décembre 2017)
 Eugène Wintzweiller, Mélodies posthumes pour voix et piano : Chanson du Fou (Victor Hugo), Joli papillon (Victor Chauvet), Nina (Alfred de Musset), dédicacées "à son ami Jules Diaz de Soria" (Paris, 1874, Au Ménestrel, Heugel et Cie, coll. Bibliothèque Nationale d'Espagne). Fichiers audio avec transcription pour clarinette et piano par Max Méreaux (DR.)
Eugène Wintzweiller, Mélodies posthumes pour voix et piano : Chanson du Fou (Victor Hugo), Joli papillon (Victor Chauvet), Nina (Alfred de Musset), dédicacées "à son ami Jules Diaz de Soria" (Paris, 1874, Au Ménestrel, Heugel et Cie, coll. Bibliothèque Nationale d'Espagne). Fichiers audio avec transcription pour clarinette et piano par Max Méreaux (DR.)
1869
Antoine TAUDOU (1846-1925)
 |
Antoine Taudou
( cliché Pierre Petit, in Musica, 1903 )
|
Ce musicien est plus connu comme pédagogue que comme compositeur. Une trentaine d’années professeur d’harmonie au Conservatoire de musique et de déclamation de Paris, il compte parmi ses nombreux élèves plusieurs musiciens de grand talent, tels que Louis de Serres, Charles Koechlin, Jacques de la Presle, Aymé Kunc, Joseph Boulnois, Ermend-Bonnal ou encore Francisco Braga pour ne citer que les plus connus. Parmi ses compositions, on lui doit notamment l’illustration musicale de la pièce de théâtre de François Coppée, le Luthier de Crémone, dont la première eut lieu le 23 mai 1876 au Théâtre-Français (Comédie-Française), avec un Prélude pour violon seul. La critique spécialisée de l’époque soulignait d’ailleurs la belle inspiration de cette page d’une haute élévation de style.
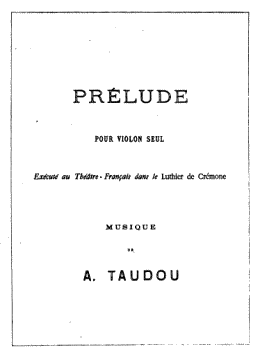 |
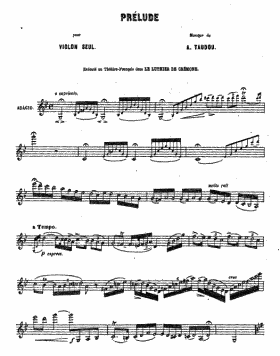 |
Fragment du Prélude pour violon seul, composé pour le Luthier de Crémone de François Coppée joué le 23 mai 1876 au Théâtre-Français.
( "Journal de musique", 15 juillet 1876 )
|
Né à Perpignan (Pyrénées-Orientales) le 24 août 1846, Antoine-Antonin-Barthélémy Taudou est fils de Simon Taudou (1820-1890), instituteur originaire de Serviès-en-Val (Aude), et de Marguerite Rieux, fille d'un boulanger de Perpignan. Il gagnait Paris dès l’adolescence pour intégrer le Conservatoire et obtenait dans cet établissement une 1ère médaille de solfège en 1863, un 1er prix de violon en 1866, un 1er prix d’harmonie en 1867 et un 1er prix de contrepoint et fugue en 1868. L’année suivante ses études étaient couronnées par un Grand Prix de Rome avec la cantate Françoise de Rimini.
Les événements de 1870 interrompirent le séjour d’Antoine Taudou à la Villa Médicis et celui-ci revient prématurément à Paris, où il gagna sa vie comme violoniste au sein de plusieurs formations. On pouvait ainsi le voir notamment à l’Orchestre du Théâtre de la Porte St-Martin, et de 1872 à 1889 à celui des Concerts du Conservatoire. Il fondait même un " Quatuor Taudou ", avec lequel il se produisait durant quelques années dans la capitale. En 1883, il était enfin nommé professeur d’harmonie au Conservatoire de Paris, poste qu’il occupait jusqu'à la veille de la Grande Guerre.
En tant que compositeur, on connaît d’Antoine Taudou un Trio pour flûte, alto et violoncelle (Paris, Richault, 1876), un autre Trio pour piano et archets, un Quatuor pour instruments à archet, un Concerto de violon, et plusieurs pièces d’orchestre, parmi lesquelles on relève une Marche-Ballet, un Chant d’automne et une Marche nocturne.
Chevalier de la Légion d’honneur (décret du 5 avril 1903), domicilié 2 rue Michelet à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), Antoine Taudou, célibataire, est mort le 6 juillet 1925 à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), non loin de Paris.
Denis Havard de la Montagne
(mise à jour : juillet 2018)
 Antoine Taudou, Discrétion, mélodie pour chant et piano sur une poésie de Manuel, dédicacée "A Madame Rabaud-Dorus" (Paris, Le Monde musical. Recueil de musique moderne, vol. II chant, 1874 - coll. BnF/Gallica)
Antoine Taudou, Discrétion, mélodie pour chant et piano sur une poésie de Manuel, dédicacée "A Madame Rabaud-Dorus" (Paris, Le Monde musical. Recueil de musique moderne, vol. II chant, 1874 - coll. BnF/Gallica)
Fichier audio par Max Méreaux, avec transcription pour clarinette de la partie chant (D.R.)
Partition au format PDF.
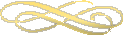

Droits de reproduction et de diffusion réservés
© MUSICA ET MEMORIA