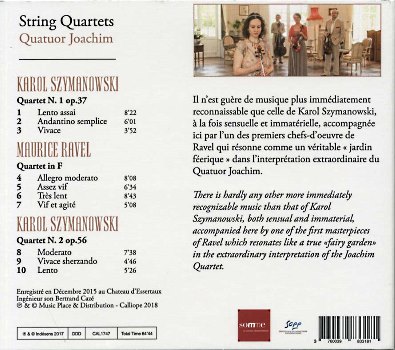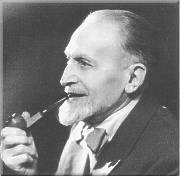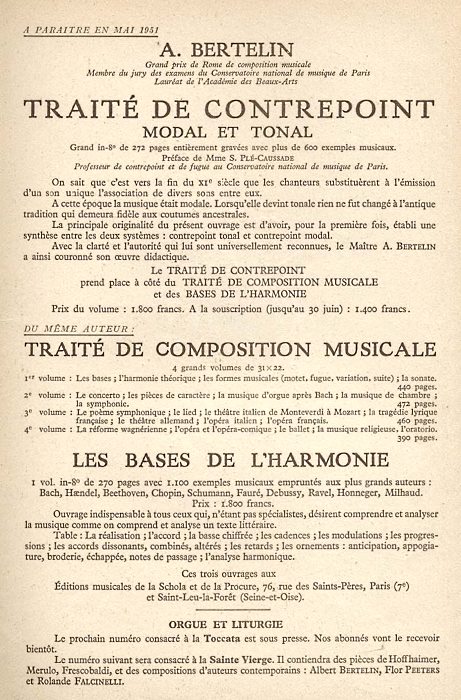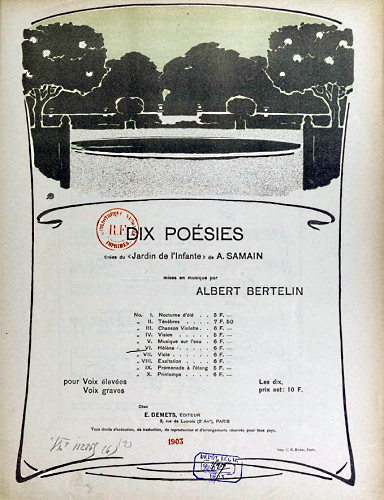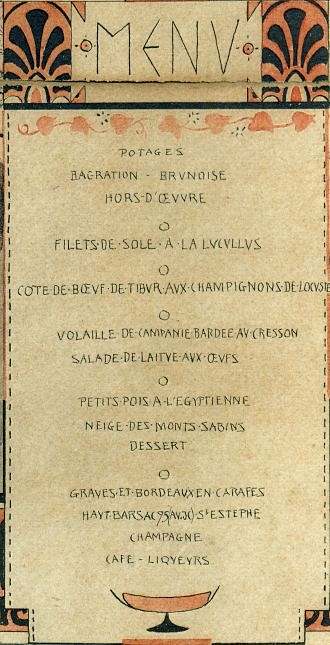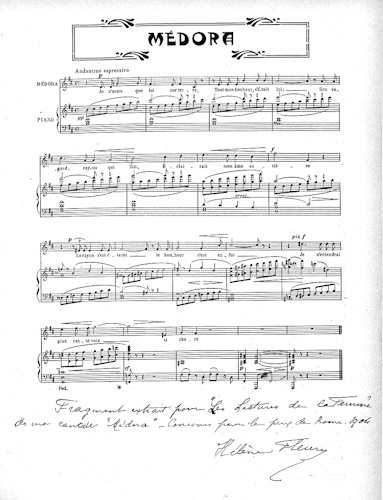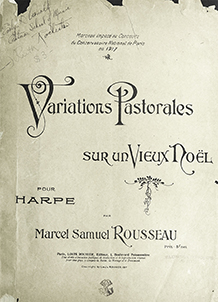Prix de Rome 1900-1909
Florent SCHMITT - André CAPLET - Gabriel DUPONT - Maurice RAVEL - Aimé KUNC - ROGER-DUCASSE - Albert BERTELIN - Raoul LAPARRA - Raymond PECH - Paul PIERNÉ - Hélène FLEURY-ROY - Victor GALLOIS - Marcel SANUEL-ROUSSEAU - Philippe GAUBERT - Louis DUMAS - Maurice LE BOUCHER - André GAILLARD - Nadia BOULANGER - Édouard FLAMENT - Jules MAZELIER - Marcel TOURNIER
1900
Florent Schmitt vers 1900 ( photo Eugène Pirou, BNF Richelieu ) Né à Blâmont (Meuthe-et-Moselle) le 28 septembre 1870 et mort à Neuilly-sur-Seine le 17 août 1958, Florent Schmitt travailla d'abord à Nancy, auprès de l'organiste Henry Hess qui lui enseigna le piano et de Gustave Sandré l'harmonie, avant de rejoindre le Conservatoire de Paris en 1889. Élève de Dubois, Lavignac, Gedalge, Massenet et Fauré, il concourut à 5 reprises pour le Prix de Rome: en 1896 avec la cantate Mélusine, l'année suivante il remportait le deuxième Second Grand Prix avec la cantate Frédégonde, en 1898 avec la cantate Radegonde, en 1899 avec Callirrhoé et en 1900, il décrochait enfin le premier Premier Grand Prix avec la cantate Sémiramis. Il profita de son séjour à la Villa Médicis pour voyager en Italie, Allemagne, Espagne, Autriche, Maroc... En 1901 il était nommé premier titulaire du grand orgue de l'église Saint-Lambert-de-Vaugirard, que Louis Debierre venait de construire et restera à ce poste durant 20 ans. Membre dès sa fondation en 1909 de la Société Musicale Indépendante, il sera également président de la Société Nationale de Musique (1938). Critique musical renommé, notamment au journal Le Temps (1919-1939), il fut également directeur du Conservatoire de Lyon où il enseigna l'harmonie (1922 à 1924) et succédait à Dukas (1936) à l'Institut. Son catalogue, qui comprend 138 numéro d'opus, est très important et fort varié. Attaché au classicisme, bien que romantique par certains côtés, l'œuvre de Schmitt révèle ces deux tendances, principalement dans sa musique d'orchestre. Il est difficile de ne mentionner ici que ses compositions principales, tant elles sont nombreuses! Citons cependant le Psaume XLXII, pour soprano, chœur, orgue et orchestre; son mimodrame la Tragédie de Salomé; sa musique de scène Antoine et Cléopâtre et celle pour le film Salammbô; son Quintette pour piano et cordes; sa Symphonie concertante pour orchestre et piano; sa tragédie dansée Oriane et le Prince d'Amour et sa Messe en quatre parties pour chœur mixte et orgue, qui est son opus ultime. Qualifié par certains de Titan, il est incontestable que Florent Schmitt est l' un des plus important compositeurs de l'école française.
Heitor Villa-Lobos et Florent Schmitt (à droite) en 1927. ( BNF Richelieu ) D.H.M. (notes provisoires)
Monsieur Kenichi Fujimaki, traducteur de la version en japonais du Traîté de la Fugue de Gedalge, a publié des échantillons audio des exemples musicaux inclus dans cet ouvrage (et autres fugues)
sur la chaîne YouTube des éditions Glycine, avec suivi automatique de la partition.
Cette chaîne propose des fugues de MM. Revel, Messiaen, Rivier, Enesco, Schmitt, Morpain, Malherbe, Boulay, Depecker, Koechlin, Van Doren, Vidal.
Un entretien en 1929 avec Florent Schmitt
Florent Schmitt jouit d'une réputation usurpée : on l’aborde avec circonspection, s’attendant à trouver en lui un homme hérissé, toujours prêt, avec une joie maligne, à « mettre les pieds dans le plat », à vous déconcerter par une saillie bourrue ; et l'on découvre un maître de maison charmant, qui vous attend près d’un bon feu et vous offre un cordial, délicate attention par ces temps de froidure.
Evidemment les coups de boutoir qu’on lui prête (sur la foi de son origine lorraine ?) ne sont pas invention pure. Il a été, il reste combatif, jusques et y compris la mêlée, quand les intérêts de l’offensé qu'il défend, lui paraissent en valoir la peine. Mais il se détend aussi volontiers. Tout au plus la vivacité de son tempérament se manifeste-t-elle encore dans la brusquerie de certains jugements sans appel, et dans son goût pour les réponses en impasse.
Par les fenêtres du salon, on apercevrait si le temps était clair, les pentes bouées de Saint-Cloud ; mais l’horizon est barré par la brume. Des parcs, des maisons de campagne s’échelonnent de chaque côté de la route cirée par la pluie, qui vous grimpe au « Calvaire ». Paysage d’hiver assez mélancolique, mais silence propice au travail. Atmosphère ouatée, engourdissement apaisant de la nature ; la saison n’est pas aux éclats, aux rancunes contre les choses ou contre les hommes...
J’interroge imprudemment Florent Schmitt sur ses années de jeunesse.
Vous voulez savoir qui m’a appris le solfège ? Je n’en ai jamais fait. On a tort de confondre généralement solfège et musique quand l’un est par définition ennemi de l’autre. Ce fatras détestable est cause que la plupart des commençants se rebutent et renoncent. Car si c’est là la musique !... La seule éducation dans cet art est celle de l’oreille. Qu’on fasse entendre aux enfants de la musique, de la vraie musique naturellement ; et qu’on leur épargne les commentaires et les analyses et les démonstrations. Si le sujet a quelque chose dans le ventre, cela suffira. Sinon, tous les solfèges du monde n’y pourront rien.
Votre protestation ressemble bien à une coquetterie du savant harmoniste et orchestrateur que vous êtes.
Par solfège, j’entends seulement les rudiments, inculqués aux enfants sous la férule, à l’âge où ils aimeraient mieux jouer aux billes. Je ne vise ni l’harmonie, ni la fugue, trop négligées au contraire et qu'on ne sait jamais assez.
Vous êtes-vous déjà occupé, directement ou autrement, des questions de pédagogie musicale, qui reviennent périodiquement sur l’eau à l’Instruction publique ?
Je m’en garderai bien. Je hais l’enseignement, n’ayant jamais été capable de donner proprement une leçon. Mais j’ai le droit quand même de nourrir une opinion. Tant qu’on s’obstinera à mettre la charrue devant les bœufs, à enseigner une théorie décharnée avant d’avoir intéressé et retenu des sensibilités, par des auditions de concerts ou de disques, on obtiendra le même résultat qu’aujourd’hui, c’est-à-dire exactement rien.
Dans le jardin de la famille Schmitt, rue des Girondins à Saint-Cloud, vers 1910. De gauche à droite, au 1er rang : Roger Haour, Maurice Ravel, Jeanne et Christiane Pivet. Au 2ème rang : Jane Haour, "Raton" Schmitt et Léon Pivet. Au dernier rang : Paul Sordes, Florent Schmitt, Léon-Paul Fargue et Jeanne Schmitt. ( BNF Richelieu )
Avez-vous eu la chance, de par le milieu où vous avez été élevé, de sentir se cristalliser ainsi en vous le sens et le goût de la musique ?
Assez tard, bien que la torture des gammes ne m’ait pas été épargnée, dès que je fus en âge de me tenir convenablement sur un tabouret. La musique ne s’est révélée à moi qu’à 16 ans ; pour la première fois alors j’ai entendu un orchestre, et j’ai découvert la symphonie en « la ». Vers 17 ans, j’ai commencé à travailler sérieusement, à Nancy, sous la direction de Hess et de Sandré. Deux ans après, je suis entré au Conservatoire de Paris, où j’ai eu pour maîtres Dubois, Lavignac, Gedalge, Massenet et Fauré.
Je pense qu’il est inutile de vous demander lequel a influe le plus profondément pour vous ?
Comme professeur, Gedalge. Lui savait enseigner ; on n’allait jamais le trouver sans profit. Comme directeur de conscience, Fauré. Le contraire même du magister. Il n’avait jamais de crayon quand il s’avisait de noter quelque correction. Il faisait son cours en homme du monde, s’entretenant aussi volontiers de Mme de S. M. et des réceptions du soir que de l’objet même de la leçon. Au surplus jamais sa critique ne heurtait de front et comme pour le plaisir d’écraser le délinquant : deux mots discrets sur l’opportunité peut-être plus grande de telle autre construction, de tel développement plus satisfaisant, et c’était tout, assez pour celui qui savait comprendre la valeur des mots. D’ailleurs l’exemple de l’artiste, une pièce comme le « Septième Nocturne » qu’évitent naturellement les pianistes puisque c’est le plus beau, était plus fécond en enseignement que n’importe quelle explication doctorale.
Avez-vous gardé un bon souvenir de votre séjour à Rome ?
Il m’a coûté assez cher ! Songez donc ! Cinq cantates, « Mélusine », « Frédégonde », Radegonde », Callirhoé », enfin « Sémiramis » en 1900. Je méritais une compensation. Au fait ce prix fut surtout pour moi prétexte à voyager. Pour éviter la ligne droite, j’ai fait des crochets, soit à l’aller, soit au retour, par la Suède, la Turquie ou le Maroc. La mansuétude inépuisable du directeur de l’Ecole a passé l’éponge sur les retards que ces itinéraires compliqués occasionnèrent inévitablement.
En somme, sous prétexte que tout chemin mène à Rome, vous vous êtes arrangé pour y passer le moins de temps possible ! C’est donc que l’attirance du lieu était médiocre.
On tâchait surtout de décrocher une chambre tranquille. Pour le reste !... Pourtant j’y ai rencontré deux amis excellents, l’architecte Bigot et Caplet.
Et vous en avez rapporté une partie de votre « Quintette » et le « Psaume XLVI », sans compter sans doute de nombreuses esquisses jetées sur le papier à Rome ou dans vos équipées aventureuses. Ainsi, auriez-vous écrit, outre le « Psaume », « Salomé », « Antoine et Cléopâtre », « Salammbô », « la Dame d’Abisag », si ces voyages ne vous avaient révélé l’Orient biblique et l’Afrique ?
Je n’en sais rien. Songez que j’aurais pu aller au Groenland et faire de la musique samoyède ! Avec autant de plaisir et aussi peu de système. Si j’ai évoqué l’Orient c’est sans démarquer ses thèmes ; le seul motif d’origine que j’aie exploité, venait des bords de la Mer Morte et figure dans la tragédie de « Salomé ».
Vous que le public considère à juste titre comme soucieux de toujours créer du nouveau, que pensez-vous de toutes les innovations dont on nous accable depuis quelques années ?
Je n’en vois pas tant que cela. Comme prospecteurs, il y a Stravinsky, jusques et y compris les « Noces ». Depuis « Mavra », il piétine. Il y a Schonberg, qui a si admirablement stylisé la fausse note et légitimé la discordance...
Parlez-vous sérieusement ?
Très sincèrement. C’est un convaincu. Je n’ai pas une tendresse spéciale pour sa musique mais je l’admire — et la crains.
Démêlez-vous les raisons qui vous en éloignent ?
Je préfère ne pas les formuler ; il me démontrerait que j’ai tort. Car il manie supérieurement la dialectique. Pourtant sa raison persuasive perd du terrain, même en Allemagne. En France on l’a prôné par mode, sans s’attacher à le vraiment comprendre ; on l’a quitté aussi légèrement...
Ne voyez-vous pas de grands prospecteurs en France ?
Satisfaisons l’amour-propre national. Il y a évidemment Debussy, un très grand, celui-là, mais si discuté qu’on le découvre à peine. Et puis Fauré et Chabrier ; l’un pour l’exemple de sa mélodie et sa profondeur, l’autre pour ses recherches harmoniques et rythmiques. Car c’est Chabrier qui, avant Debussy, a secoué cette harmonie, rigide comme une grille de prison, et ressuscité nos rythmes moribonds. Quant au rôle de Franck, d’autres l’ont célébré, avec plus d’enthousiasme que je ne saurais le faire. Mais il n’y a pas à nier qu’il fut, lui aussi, un grand musicien.
Ainsi Chabrier, si peu joué, à peine discuté, est pour vous un méconnu ?
Avec bien d’autres, oui. D’ailleurs les grands artistes ne sont jamais à la mode puisqu'ils sont de tous les temps. La routine règne, à l’orchestre comme au récital et sur la scène lyrique. Ne devrions-nous pas entendre plus souvent « Le Roi malgré lui », qu’on n’a pas repris depuis quarante ans ? Et les œuvres de Lalo ? Et les symphonies de Dukas, Enesco, Lazzari, Glazounov, Kœchlin et tant d’autres ?
Et parmi les jeunes ?
L’avant-dernière génération a donné Honegger, que ses adulateurs feraient mieux de laisser un peu souffler. Quant aux dernières recrues, elles n’en sont encore qu’aux vagissements. Il y a cependant un instrument dont, à défaut d’autres, ils ont saisi du premier coup la technique : c’est la grosse caisse de la parade foraine. Et le badaud, le stupide public a marché comme un seul homme... je fais d’ailleurs des exceptions, parmi leurs aînés surtout ; Delvincourt, Ibert, Ferroud, Hugon, Clergue, voilà des gens dont on parle peu, mais qui ont des chances de laisser à la postérité autre chose que d’emphatiques ou creuses bagatelles.
Laissons donc les petits derniers à leurs pères nourriciers et revenons, si vous le voulez, à ceux qui, sans savoir où peut-être, guident la musique ? Où nous mènent-ils ?
Cela dépend pour combien de temps. D’ici trois ou quatre ans, jusqu’au prochain tournant de la route et si nous n’avons pas versé avant dans le fossé, nous nous rapprocherons d’une certaine clarté de lignes, d’une simplification harmonique et architectonique ; simplification synonyme en partie de pauvreté. On prétend qu’il est difficile de faire « simple », paradoxe commode, qui camoufle une impuissance à concevoir complexe, à orchestrer « riche ». L’instrumentation est morte aujourd’hui. On ne l’apprend plus. On accouple n’importe quels timbres et on « synthétise » pour réduire les frais d’exécution et ne pas indisposer les chefs d’orchestre. A la scène la même politique s’impose.
Alors la grande misère du théâtre lyrique ?
Trop réelle. Il succombe sous les conventions surannées, le coût des décors, la prétention des solistes, les revendications des choristes, qui ne connaissent guère en fait de discipline et d’eurythmie que celles du syndicat. Le lyrisme n’est pas mort, mais il étouffe. Et ce n’est pas le libérer que de susciter en marge, (essai d’ailleurs plein d’intérêt et très viable), le mélodrame avec chœurs à la manière antique ou la tragédie-ballet à partie vocale développée.
Comment jugez-vous l’attitude de la foule dans cette histoire ?
La foule, elle se moque bien de tout cela, elle aime Perchicot [chanteur de variétés]. Les fadaises romantiques sur son rôle dans l’inspiration de l’artiste s’avèrent avec éclat dénuées de bon sens. L’artiste n’a rien à faire avec elle ; s’il prend ses instructions, il s’avilit. Les gens du monde d’ailleurs ne valent pas mieux, ils sont aussi ignares, avec la suffisance par surcroît. L’artiste travaille pour lui seul et quelques-uns qui sentent comme lui. Tout ira bien s’il sait résister à l’effort de ce petit groupe pour se constituer en chapelle, et s’il renonce à la quiète satisfaction d’avoir jamais mis vraiment à une œuvre la dernière main. L’humilité du perpétuellement inachevé est un des secrets essentiels de la sagesse…
Florent Schmitt retrouve sa sérénité. Un magnifique chat zébré sollicite la caresse anguleuse d’un pied de chaise, et s’installe en rond près du feu, dans la tiédeur où nos propos ne dérangeront plus sa sieste, car son maître m’accompagne jusqu’à la porte. Le jardin est aussi tranquille qu’à mon arrivée. L’harmonie du paysage est devenue si douce qu’on ne se sent vraiment pas le courage d’être misanthrope.
M. Rousseau
(in Le Guide du Concert, 25 janvier 1929)
transcription, numérisation DHM
Château de Compiègne, 5 au 11 mai 1900, les 11 candidats au concours d’essai du Prix de Rome.
De g. à dr. : Roger-Ducasse (assis sur le garde-corps), César-Abel Estyle (derrière), Edouard Trémisot, Léon Moreau, Maurice Ravel, Gabriel Dupont,
Angelin Biancheri, Albert Bertelin, Florent Schmitt (lit le journal), Aymé Kunc (assis sur la 2e marche) et Louis Brisset (assis sur le garde-corps)
(Musica, 1913, coll. DHM) DR.
1901
André CAPLET (1878-1925)

Les candidats au Concours du Prix de Rome 1901 au château de Compiègne.
De g. à dr. : un gardien du château, Gabriel Dupont, Aymé Kunc, un gardien du château, André Caplet, Albert Bertelin, Maurice Ravel
(photo X..., Le Monde musical, 1924) DR.
André Caplet (1878-1925),
Grand Prix de Rome 1901,
directeur de la musique
à l'Opéra de Paris ( photo Raoul Autin, 1902 )"Ce qu’il faut mettre en relief d’abord, parce que là réside l’essentiel, c’est du plus loin que je me souvienne, l’attirance toujours exercée sur moi par la mer. Enfant, je restais des heures à flâner au bord des grands bassins du Havre. J’écoutais le rythme des vagues déferlant sur la grève et, bien avant que je ne puisse partir seul, quand un marin m’emmenait dans son bateau, j’étais heureux et j’imaginais, j’entendais des voix dans les voiles. Elles changeaient d’intensité selon la force du vent et semblaient répondre à quelque interrogation venant de moi. Je ne saurais expliquer ce que je ressentais alors mais, revenu sur terre, j’étais en exil. J’attendais toujours je ne sais quel motif d’émerveillement. J’entendais des voix dans les voiles." Rejoignant dans cette passion des voix et de la mer Albert Roussel et Jean Cras, André Caplet est un acteur de tout premier plan dans la vie musicale du début du XXe siècle.
Il est né le 23 novembre 1878 sur un bateau entre Le Havre et Honfleur, dernier enfant d’une famille très modeste. Doué et précoce, confronté dès son plus jeune âge à la nécessité de travailler, il obtient à onze ans un engagement de pianiste répétiteur aux Folies Bergère du Havre et à douze ans, un poste de violoniste dans l’orchestre du Grand Théâtre municipal. Après avoir reçu de Henry Woolett ses premiers cours d’harmonie au Havre, il est l'élève de Charles Lenepveu, Xavier Leroux et Paul Vidal au Conservatoire de Paris (1896-1901). C’est à cette époque que, timbalier aux Concerts Colonne, il se fait remarquer pour ses capacités de chef d’orchestre. En 1899, à 21 ans, il est nommé directeur de la musique à l'Odéon.
Ses premières œuvres (Quintette pour piano et instruments à vent, Callirhoé, Suite persane, Pâques citadines) montrent une assimilation précoce de l'héritage de Franck et de Massenet ainsi qu'une évidente attirance pour l'impressionnisme. Après avoir obtenu avec la cantate Myrrha le Premier Grand Prix de Rome en 1901 devant Maurice Ravel, il parcourt l’Italie avec une insatiable curiosité. A l’occasion du centenaire de la Villa Médicis, il est désigné pour écrire une Marche solennelle exécutée sous sa direction à la cérémonie officielle commémorant cet événement en avril 1903. Avec Épiphanie, triptyque pour violoncelle et piano composé la même année, il entre dans une phase de musique plus évocatrice que descriptive qui débouche sur Le Masque de la mort rouge, fresque symphonique avec harpe principale, d'après Edgar Poe (1908). Caplet remanie son œuvre en 1923 pour harpe et quatuor à cordes, lui donnant alors le titre de Conte fantastique. Cette partition comporte d'étonnantes trouvailles instrumentales dans l'écriture pour la harpe et dans la puissance d'évocation musicale. Il faudra attendre Krzysztof Penderecki ou György Ligeti pour voir certains de ses procédés réutilisés. Se sentant à l’étroit dans sa cage dorée de la Villa Médicis, il donne sa démission, quitte l’Italie pour l’Allemagne où, pendant une année, il suit les répétitions des grands chefs de l’époque : Arthur Nikisch à Berlin et Félix Mottl à Dresde.
En 1907, André Caplet rencontre Claude Debussy dont il connaît déjà fort bien la musique ayant transcrit plusieurs de ses partitions d'orchestre pour le piano. Une profonde amitié s'établit entre eux et, loin de se limiter à un rôle de disciple que lui attribuent de trop nombreux biographes, Caplet devient le plus proche collaborateur de Debussy, son interprète de prédilection d'abord, mais aussi l'orchestrateur de certaines de ses partitions (Children's Corner, La Boîte à joujoux, deux des Ariettes oubliées…). S’adressant à Georges Jean-Aubry en 1908, Debussy confie : "Hier pour la première fois j’ai entendu deux mélodies d’André Caplet. Ce Caplet est un artiste. Il sait retrouver l’atmosphère sonore et, avec une jolie sensibilité, a le sens des proportions ; ce qui est plus rare qu’on ne le croit à notre époque de musique bâclée ou hermétique comme un bouchon !"
Il tombe gravement malade d’une pleurésie à l’automne 1909. Blond, le regard vague, une tête énorme posée sur de larges épaules, il est doté d’une puissante personnalité au dynamisme communicatif. A ce magnétisme naturel s’ajoute un charme indéfinissable auquel succombera Isadora Duncan. Dès 1910 ses premières compositions figurent à l’affiche des concerts parisiens. Ses interprètes sont Claire Croiza, Jane Bathori, Philippe Gaubert, Gaston Poulet, Maurice Maréchal... Sa carrière de direction d'orchestre prend son véritable essor en 1910 lorsqu'il est nommé chef d'orchestre puis directeur de la musique à l'Opéra de Boston où il reste quatre années. Il y présente l'essentiel du répertoire contemporain français, y faisant notamment découvrir la musique de Debussy, Ravel, Satie, Milhaud, Aubert, Laparra… Il revient à Paris au printemps 1911 afin d’orchestrer, préparer et diriger les premières représentations du Martyre de Saint Sébastien, partition que Debussy achève dans la hâte. En 1912, il assure la première exécution de Pelléas et Mélisande en Angleterre.
Définitivement revenu en France au printemps 1914, il est nommé chef d’orchestre à l'Opéra de Paris, mais la guerre éclate en août et l'empêche d'exercer ses fonctions. Caplet s’engage volontairement à la déclaration de guerre (il avait été exempté du service militaire). Il est affecté à la garnison du Havre et c'est avec le grade de sergent qu'il arrive au front en septembre 1915. Il est chef colombophile et, parallèlement, participe activement à la vie du quatuor fondé par Lucien Durosoir et Maurice Maréchal comme l’atteste cette lettre écrite par Durosoir à sa mère le 17 octobre 1915 : "Voici comment je compte faire pour organiser le quatuor. Il est arrivé hier matin, dans un nouveau renfort, André Caplet, le prix de Rome, chef d’orchestre bien connu qui dirigeait à Boston depuis plusieurs années la saison d’opéra. Je lui ai longuement causé hier et je l’ai même présenté au colonel. Il est sergent, on va lui trouver un filon, d’autant plus qu’il est malingre. Il faut vraiment avoir besoin d’hommes pour prendre des gens comme lui. Enfin bref, il jouerait l’alto dans le quatuor (Caplet est pianiste mais il a aussi appris le violon et a quelques rudiments d’alto). Inutile de dire qu’il sera intéressant comme musicien. Il paraît fort timide, il faut dire qu’il était désorienté de se trouver au front, c’est la première fois qu’il y venait." En mai 1916, le général Mangin lui commande la Marche héroïque de la Ve Division. Blessé et sévèrement gazé, il revient du front très diminué physiquement.
Démobilisé au début de l’année 1919, il épouse le 4 juin à Chaville celle qu’il appelait "ma petite Geneviève". De cette union heureuse naît un petit Pierre le 20 octobre 1920. Ses activités musicales restent malgré tout aussi bouillonnantes. Francis Poulenc nous rapporte l’anecdote suivante : "André Caplet, récemment revenu du front, dirigeait une étrange chorale où l’on voyait parmi les basses mes deux maîtres Charles Koechlin et Ricardo Viñes et, dans je ne sais quel emploi, Honegger et moi-même. Il s’agissait de chanter les Trois chansons a cappella de Ravel encore inédites."
Décidant de se consacrer à la composition plutôt qu’à la direction d'orchestre que sa santé affaiblie rend trop fatigante, il refuse les postes de chef d'orchestre que lui proposent l'Opéra de Paris, les Concerts Lamoureux et les Concerts Pasdeloup. Il dirige cependant divers orchestres de façon intermittente. C’est ainsi qu’il fait entendre pour la première fois en France aux Concerts Pasdeloup les Cinq pièces pour orchestre opus 16 d’Arnold Schönberg en 1922. Il dirige également les premières auditions de Socrate d’Eric Satie et de La valse de Maurice Ravel. Toujours la même année, il assiste à la première française du Pierrot lunaire dirigée par Darius Milhaud. Sa curiosité étant toujours en éveil, il est présent lors des premières auditions du Roi David d’Arthur Honegger, Pour une fête de printemps d’Albert Roussel, Noces d’Igor Stravinsky…
Les horreurs de la guerre accentuent son mysticisme qui se traduit dans des œuvres intérieures, généralement destinées à la voix humaine. Ayant tiré de la leçon debussyste une libération vis à vis du passé, peu attiré par le courant Stravinsky de l’après-guerre, il est alors très attentif aux recherches de l’Ecole de Vienne mais reste attaché à une clarté et une fluidité bien françaises. Dès 1909, avec le Septuor pour cordes vocales et instrumentales, Caplet aborde une écriture plus dépouillée, faite de recherches de timbres et de simplicité. Les Inscriptions champêtres (1914), pour voix de femmes a cappella trouvent leur inspiration dans les paysages normands tout comme la Messe à trois voix dite "des petits de Saint Eustache la Forêt" (1920) qui emprunte certains procédés au chant grégorien. Son Panis Angelicus composé le 21 juin 1919 est d’une grande ferveur religieuse et témoigne d’une sincérité et d’une profondeur de sentiments assez rares à cette époque. En 1923, André Caplet termine son chef d’œuvre, Le Miroir de Jésus, triptyque sur les Mystères du Rosaire, poèmes d’Henri Ghéon où il associe à nouveau cordes vocales et instrumentales.
LE MIROIR DE JÉSUS
D’un grand mysticisme, puisant aux racines d’une foi authentique, l’œuvre est écrite entre avril et septembre 1923. "Mes intentions sont d’utiliser comme accompagnement le quatuor à cordes et la harpe ; de faire précéder chaque groupe du Mystère (de joie, de peine, de gloire) d’un petit prélude confié aux seuls instruments à cordes, et d’utiliser un groupe de voix de femmes (9 voix seulement divisées en 3) pour agrémenter comme fond sonore les Mystères joyeux et les Mystères glorieux."
Une version pour chœur, orchestre à cordes et deux harpes est donnée pour la première fois à Lyon le 22 février 1924. Dans sa version de musique de chambre, Le Miroir de Jésus est exécuté en première audition le 1er mai suivant à Paris, au théâtre du Vieux-Colombier. André Caplet dirige et Claire Croiza y chante la voix principale. Le succès est tel que, toujours sous la direction de l’auteur, cet ouvrage est donné à plusieurs reprises et à guichet fermé au Vieux-Colombier. L’œuvre affirmant son rayonnement, d’autres auditions ont lieu dans différentes villes. C’est ainsi que la reine Elisabeth fait venir à Bruxelles le compositeur et ses interprètes pour entendre cette œuvre dans laquelle jamais encore la musique de Caplet n’a atteint une telle force dramatique et descriptive.
Confiant à trois voix a cappella le rôle d’annoncer : "Le Miroir de Jésus : Quinze petits poèmes sur les saints mystères du Rosaire qu’Henri Ghéon composa et qu’André Caplet de musique illustra", l’auteur établit un contact immédiat avec son auditoire. Puis, l’ouvrage se divise en trois parties : le Miroir de joie, le Miroir de peine, le Miroir de gloire. Chacune de ces trois parties est précédée d’un prélude confié aux instruments seuls, d’une écriture systématiquement différente.
Laissons à Yvonne Gouverné, fidèle disciple de Caplet, le soin de nous parler des derniers jours du compositeur :
"Le lundi 9 mars 1925, un festival des œuvres d’André Caplet avait lieu à l’église Saint-Michel au Havre, avec les instrumentistes du Havre bien entendu, la chorale locale à laquelle se joignaient quelques fidèles des nôtres et Mme Claire Croiza interprétant le Miroir de Jésus. A la veille de ce concert auquel je ne pensais pas assister, Madeleine Vhita et moi-même reçûmes l’ordre de nous rendre immédiatement au Havre pour la répétition générale. Madeleine pour remplacer Mme Croiza venant seulement pour le concert. Moi, parce qu’André Caplet avait fait mettre un piano dans l’orchestre et j’avais comme mission de renforcer les basses qui, dans cette église, paraissaient sonner de façon insuffisante. Donc ce qui fut dit fut fait. A l’issue de cette répétition, l’auteur éprouvait le besoin de se détendre… Vers minuit, après avoir quitté les uns et les autres, André Caplet nous emmenait Madeleine et moi vers la mer ! Comment pourrais-je oublier cette promenade nocturne au bord des vagues houleuses, qui fut la dernière de toutes avec lui ? Il nous tenait chacune par un bras, devant cette immensité marine dont nous longions les vagues, et, comme s’il nous proposait une aventure merveilleuse : "Mais pourquoi ne pas partir sur une de ces barques ? Vous savez que je rame très bien" nous dit-il. Poursuivant son rêve, il se mit à fredonner presque joyeusement : "On s’embarquerait sur la mer et l’on ne reviendrait plus".
Le concert ayant eu lieu le lendemain soir 9 mars 1925 fut la dernière escale du musicien devant une assemblée où son œuvre était à l’honneur. Le 14 mars, André Caplet fut immobilisé par une forte fièvre. Le médecin ne put lui cacher qu’il était très grave pour lui de sortir…"
Il est mort le 22 avril 1925 à Neuilly-sur-Seine, dans son appartement du boulevard d'Inkermann.
Ses dernières pensées ont peut-être été pour son maître, son ami, Claude Debussy qui lui écrivait en 1918, quelques semaines avant sa propre mort : "Si l’on a besoin de quelqu’un pour diriger la musique des sphères, je me sens tout à fait désigné pour ce haut emploi." Diriger la musique des sphères, c’est certainement ce qui les attendait tous deux. Messagers des radieux espaces pressentis dont la matière ne possède pas la clé, c’est sur cette vérité si anxieusement recherchée que devaient se rouvrir les grands yeux de Mélisande et que l’extase paradisiaque du Martyre de Saint Sébastien devait précéder dans une aveuglante lumière le couronnement au ciel du Miroir de Jésus.
Patrick Marie Aubert
André Caplet, Adagio pour violon et orgue ou piano. Fichier audio par Max Méreaux (DR.)
LE MIROIR DE JESUS
Isabelle Cals, mezzo-soprano, Gaëlle Thouvenin, harpe,
André Caplet
Quatuor Johannes, Chœur de femmes du Capitole
direction : Patrick Marie Aubert
Auditorium Saint-Pierre des Cuisines à Toulouse
18 novembre 2006 à 18h
Articles détaillés sur cette page spécifique.
Conservatoire de Paris, vers 1895 : quelques élèves de la classe de composition de Jules Massenet, dont Gabriel Dupont. ( Musica, 1909, coll. DHM ) DR
Gabriel Dupont, Epigraphe et Une amie est venue avec des fleurs,
pièces n° 1 et n° 7 des Heures dolentes pour piano (Paris, Au Ménestrel/ Heugel & Cie, 1905)
fichiers audio par Max Méreaux (DR.)
Maurice RAVEL (1875-1937)
Maurice Ravel (1875-1937), Grand Prix de Rome 1901 avec sa cantate Myrrha, auteur de la célèbre Pavane pour une infante défunte (1899) et du non moins célèbre Boléro (1928) qui a fait le tour du monde. ( Photo Melcy, 1910. ) Maurice Ravel s'est présenté cinq fois au concours entre 1900 et 1905 (sauf en 1904). Il obtint en 1901 un deuxième Second Prix de Rome.
Repères biographiques et autres illustrations.Autour du Concerto pour la main gauche.
Conservatoire de Paris, classe de piano 1894-1895 de Charles de Bériot. Debout, de gauche à droite : Maurice Ravel, Camille Decreus (2e prix 1895), Gaston Lévy dit Lhérie (1er prix 1897), Édouard Bernard (1er prix 1899), Fernand Lemaire (1er prix 1895), Henri Schidenhelm (2e prix 1894), Jules Robichon, Marcel Chadeigne (1er prix 1895, grand-père maternel d'Alain Bernaud), Ricardo Vines (1er prix 1894), Cortes, André Salomon (1er accessit 1897) et Ferdinand Motte-Lacroix (2e prix 1894). Assis : Charles de Bériot (au piano) et Joachim Malats (1er prix 1893)
Voir grand format
( BNF Richelieu )
Programme de concert du dimanche 16 janvier 1938, par la Société des Concerts du Conservatoire, sous la direction de Philippe Gaubert, en hommage à Maurice Ravel décédé le 28 décembre 1937. ( Coll. D.H.M. )
Maurice Ravel, Le Jardin féerique, extrait du ballet Ma Mère l’Oye (in supplément de “Musica”, mai 1914) coll. Max Méreaux
Quelques fautes de gravure au dernier système de la troisième page ont dû être corrigées :
- 1ère mesure, 2e temps et 2e mesure, 1er et 3e temps à la main droite : ajout d’un point à côté du sol aigu (croche pointée).
- 2e mesure à la main gauche : les noires n’étaient pas bien placées sur les 2e et et 3e temps.
Numérisation, corrections et fichier audio par Max Méreaux (DR.)
Ravel-Szymanowski par le Quatuor Joachim (CD Calliope CAL1747) paru en 2018.
1902
À propos du Prix de Rome 1902
IMAGE EN PLEIN FORMAT
(in journal Le Petit bleu de Paris, juin 1902) DR..
Aymé KUNC (1877-1958)
Aymé Kunc ( photo X..., coll. part., avec l'aimable autorisation de l'Association Aymé Kunc ) Article et autres illustrations sur une page spécifique.
Roger-Ducasse, premier Second Grand Prix de Rome en 1902. ( photo Musica, 1900. ) DR Né le 18 avril 1873 à Bordeaux, décédé le 19 juillet 1954 au Taillan-Médoc (près de Bordeaux), Roger-Ducasse a fait ses études musicales au Conservatoire national supérieur de musique de Paris, à partir de 1892, auprès de Fauré (composition), Pessard (harmonie), Gedalge (contrepoint) et Bériot (piano). Ses camarades de classe se nommaient Ravel, Florent Schmitt et Georges Enesco. Premier Second Grand Prix de Rome en 1902 avec sa cantate Alcyone, derrière Aymé Kunc, il se consacre ensuite à l’enseignement. C’est ainsi qu’il devint inspecteur du chant dans les écoles de la Ville de Paris (1909), professeur d’ensemble au Conservatoire de Paris, puis succéda à Dukas dans sa classe de composition en 1935, avant de se retirer à Bordeaux. En octobre 1930 il avait prit la direction de la " Chorale des Professeurs de Musique de la Ville de Paris " qu’il dirigea d’une main de maître durant une dizaine d’années, avant de laisser la place à Raymond Loucheur. Son répertoire fort varié lui permettait de donner aussi bien des chansons populaires harmonisées avec grand soin, que le Requiem de Mozart, le Faust de Schubert, ou encore le Magnificat de Bach, sans oublier des pièces de ses contemporains (d’Indy , Debussy, Fl. Schmitt, Saint-Saëns...)
Son premier succès, en tant que compositeur, fut sa Petite suite pour piano à 4 mains écrite en 1898. Par la suite ce sera nombre d’œuvres de grande valeur :Au jardin de Marguerite (pour voix et orchestre), Le Joli jeu du Furet (chœur pour voix d’enfants), Ulysse et les Sirènes (pour voix et orchestre), Orphée (mimodrame), Cantegril (opéra-comique)... un Salve Regina, des motets avec orgue, un 1er Quatuor à cordes... On lui doit aussi une production importante d’ouvrages éducatifs pour la jeunesse : des recueils de dictées et de solfèges, des exercices pour le piano, des études graduées, des transcriptions et des chœurs pour voix d’enfants... Gabriel Fauré qui avait su détecter en lui son génie musicale n’avait pas hésité, non seulement à le laisser le remplacer de temps à autre dans sa classe de composition au Conservatoire, mais également à lui confier la réduction pour piano de son Requiem et de Pelléas et Mélisande.
Roger-Ducasse était également un poète ; c’est ainsi qu’il joua notamment un rôle éminent dans l’expansion de l’Association Guillaume Budé. Il n’avait pas oublié que dans sa prime jeunesse ses parents l’avaient tout d’abord dirigé vers des études littéraires.
On a dit de lui que c’était un travailleur patient et minutieux qui composa relativement peu, mais donna cependant une œuvre variée de grande qualité.
Denis HAVARD DE LA MONTAGNE
Page avec plus de détails concernant Roger-Ducasse.
Une classe de Roger-Ducasse au CNSMP en 1929-1930.
Publicité dans Musique et Liturgie, n° 21 de mai-juin 1951
(coll. D.H.M.) DR.
Albert Bertelin ( photo Musica, 1900. )
Albert Bertelin, né à Paris IXe le 26 juillet 1872 et mort célibataire dans cette même ville, le 19 juin 1951 en son domicile 12 rue Alphonse de Neuville (XVIIe), fils de François Bertelin (1841-1914), banquier, originaire de Tours (Indre-et-Loire), chevalier de la Légion d’honneur (1897) et de Caroline Lohse, parisienne épousée le 1er avril 1870, fit ses études scolaires dans la célèbre école Monge du boulevard de Malesherbes. Au Conservatoire national supérieur de musique, où il était entré en 1893, il a été élève de Dubois, Pugno, Widor et Massenet. Deuxième Second Grand Prix de Rome en 1902, derrière Aymé Kunc et Roger-Ducasse, après avoir obtenu une mention au concours de 1900, il a ensuite longtemps enseigné le contrepoint et la fugue à l’Ecole supérieure de musique César-Franck, à Paris. Auteur notamment d’une Sonate en mi mineur pour violoncelle et piano (1ère audition le 13 mai 1933 à la Société Nationale) et d’une autre Sonate pour piano et violon (1ère audition le 10 mars 1937 à la Société Nationale), on lui doit également un Choral pour orchestre (1902), une Symphonie, une légende hindoue en 4 parties Sakountala, récompensée au Concours Musical de la ville de Paris, un opéra : Goïtza, une Légende de Loreley, pour chant et orchestre, des recueils de mélodies et de nombreuses œuvres religieuses, dont deux oratorios : Sub umbra Crucis (1917) et In nativitate Domini (1922), une Messe pour choeur à deux voix égales, des motets et des pages pour orgue (Ave Maria, Choral, Versets sur « O Filii »), ainsi que des pièces pour piano. Il est aussi l’auteur de plusieurs ouvrages pédagogiques qui ont fait autorité, la plupart publiée aux Editions de la Schola-Cantorum : un Traité de contrepoint modal et tonal (1951), un Traité de composition musicale en 4 tomes (1931-1934) et un volume intitulé Les Bases de l’harmonie. Membre du jury des examens du CNSM de Paris, lauréat de l’Académie des Beaux-Arts, il fut également critique musical à la Revue Musicale S.I.M.
Denis Havard de la Montagne
(notes provisoires)
Quelques glanes sur Albert Bertelin (1872-1951)
à travers la presse et des périodiques musicaux
« Seconde première audition : Trois ballades roumaines, de M. ALBERT BERTELIN, chantées par M. Davriès qui manquait de puissance. Les ballades, au reste, sont banales et manquent d'intérêt. Je parle de la musique, car le style (recueilli par Mlle H. Vacaresco) est assez joli. »
« Concerts Lamoureux », in : Les Bandeaux d'or, anthologie de poèmes et prose, Paris 1906, p. 132.
« CHORAL pour orchestre. — A. BERTELIN. Première audition.
L'oeuvre que la Société des concerts, hospitalière aux jeunes, se fait un plaisir d'accueillir et de présenter au public Angevin est signée Albert Bertelin. Elève de MM. Widor et Th. Dubois pour l'harmonie et la composition, de M. Raoul Pugno pour le piano, M. Bertelin obtint le second prix de Rome en 1902. Il s'était déjà fait connaître par l'audition, à Marseille, d'un fragment du Cantique des Cantiques et la Légende de Loreley, exécutée à Leipzig et à Berlin avec succès. Il donnait, en 1904, à un concert d'orchestre salle Erard le Choral qui figure à notre programme en même temps que des Variations symphoniques et une Symphonie. Le Choral, d'un beau caractère, fut en outre interprété par l'orchestre des Concerts Classiques à Monte-Carlo. A ces oeuvres importantes il faut joindre de nombreuses mélodies sur des paroles de M"° Vacaresco et de M. Albert Bamain. »
« Notice analytique », in : Angers artistes, Angers, 17 mars 1906, p. 360.
« On reproche aux musiciens contemporains de choisir des sujets comme Pelléas ou des textes de Verlaine et de Samain. Brahms qui si souvent compose de simples Volkslieder est davantage entré dans le grand courant populaire. Un jeune compositeur français, Albert Bertelin, est allé demander de l'inspiration à des légendes roumaines. Il en a tiré une série de mélodies d'une volupté chaude, d'une tendresse sauvage, d'une force émouvante ; on peut dire qu'il leur a donné leur forme musicale définitive ! Est-ce de l'art populaire ? Dieu merci, non. C'est de l'art humain. »
Revue musicale de Lyon, Lyon, Vallas, 7 février 1909, p. 500.
« Avec M. Albert Bertelin nous trouvons une forme plus châtiée, des aspirations moins vastes sans doute, mais des qualités de charme, de distinction et d'émotion sincère qui commandent et retiennent la sympathie. Les trois Ballades roumaines, d'après des poésies populaires recueillies par Mlle Vacaresco, sont des mélodies pour voix de ténor avec accompagnement d'orchestre. Elles sont assez développées, très variées d'accents et de sentiments : Sais-tu bien mes chansons ? les Trois Baisers et la Chanson du Poignard ; on les a fort applaudies ainsi que leur interprète, qui fut excellent et légitimement acclamé, M. David Devriès. Sa déclamation énergique et claire, sa voix pure et nette firent aussi merveille dans l'air de la Passion selon saint Jean, de Bach, d'une beauté incomparable et d'une puissance d'expression sans égale. »
J. Jemain, « Revue des grands concerts et semaine musicale », in : Le Ménestrel, Heugel, Paris, 25 novembre 1911, p. 373.
Albert Bertelin, Hélène, mélodie pour voix et piano, dédicacée "à Lucien Berton", poésie d'Albert Samain tirée du Jardin de l'Infante
(Paris, E. Demets, éditeur, 1903/coll. BnF-Gallica) DR.
Partition au format PDFFichier audio par Max Méreaux
« M. Albert Bertelin a mis sur des poèmes de Samain une musique enveloppante, tendre et discrète qui s'adapte admirablement au génie du poète Il a trouvé l'interprète rêvée en Mme Renée Margès, notre charmante compatriote »
« Echos », in : Revue septentrionale, Paris, mars 1912, p. 128.
« Enfin nous eûmes la primeur d'une mélodie de M. Albert Bertelin, que lui inspira une Vision d'Albert Samain, figurant dans le Jardin de l'Infante. C'est une aimable romance dans la manière de Duprato, rapprochement qui, en ma pensée, n'offre rien de défavorable à l'auteur de ladite romance, celui des Trovatelles et du Baron de Groschatminet ayant écrit de fort jolies oeuvrettes. Remercions M. Bertelin de nous les avoir si élégamment rappelées. »
« Les grands concerts », in : Le Ménestrel, Heugel, Paris, 2 novembre 1923, p. 455.
« Le Quintette pour piano et cordes, de M. Albert Bertelin, que l'on entendit au début de la séance, est, en ses quatre parties, une oeuvre d'amples dimensions. Son unité n'est point due uniquement à la fécondité rythmique et à la plasticité du thème initiai ; avant tout elle résulte d'une constante volonté de chant qui fait que nulle mesure ne se solidifie ni ne s'isole. Dynamisme dont l'auteur se fût davantage encore rendu maître s'il l'eût resserré en de plus étroites limites. En excluant toute diffusion, ces pages affirmeraient plus nettement leur intensité et leur fougue. MM. Victor et Jules Gentil, D. Girard, Denayer et A. Lévy en ont marqué avec vigueur la sincérité et l'élan.
Claude Altomont, « Concerts divers », in : Le Ménestrel, Heugel, Paris, 14 mars 1924, p. 117.
« La publicité ressemble à un moteur : la direction qu'il subit, le conduit soit à des spectacles beaux, soit à des spectacles insignifiants. Il faut constater que depuis plusieurs années les permis de conduire ont été délivrés à des ignorants des vraies routes de l'art et de l'art musical en particulier. Et cela explique pourquoi certains bons musiciens hésitent à monter dans pareilles voitures et préfèrent demeurer seuls dans des clairières sonores, lumineuses, douces ou émouvantes. Et ces musiciens pourtant ne sont pas des moindres et bien souvent, la direction de ce moteur, à eux confiée, nous accorderait la joie de voir de beaux sites musicaux. Ces remarques nous sont suggérées par la lecture des quatre gros volumes du cours de composition musicale d'Albert Bertelin. C'est un véritable monument élevé à la gloire de la musique par un de ses plus consciencieux et de ses plus savants serviteurs. Dans les écrits sur la musique, je ne connais pas un ouvrage atteignant cette ampleur. Tout y est présenté, traité, analysé avec cette lucidité supérieure qui sait ne pas détruire l'émotion contenue dans chaque oeuvre. Ce cours de composition musicale égale les cours de littérature des plus grands maîtres en Sorbonne. Et devant cette égalité constatée, je me demande pourquoi il n'en est pas fait une publication plus généralisée. Pour encourager un éditeur à la faire, il suffirait de la part de notre Institut de France ou des Beaux-Arts de lui attribuer un prix majestueux auquel cette oeuvre a totalement droit. N'attendons pas cinquante ans pour le faire.
Ces quatre gros volumes in quarto sont trop peu connus et beaucoup de musiciens les ignorent, — modestie excessive de la part de leur auteur — modestie d'un artiste véritable. On demeure étonné d'un tel savoir, à la fois intelligent et sensible, et l'on voudrait pouvoir dire, un peu partout, « n'oubliez pas Bertelin » ! Ce qu'il y a d'assuré, c'est qu'il ne sera pas oublié par l'avenir. Un tel ouvrage sera pour lui son témoignage du « dignus intrare » et de ses compositions musicales où une véritable connaissance technique de son métier s'unit à un vrai lyrisme prendront certainement place parmi les oeuvres significatives d'une époque. Dans la « forêt sonore », les lianes et les lierres cachent les arbres. Il est temps de les en débarrasser, afin de ne plus prendre les plantes grimpantes pour les arbres eux-mêmes. Un ouvrage comme ce cours de composition musicale explique aussi la personnalité musicale de Bertelin. Il sait vraiment tout de son métier. Il le sait sans étroitesse d'idées, sans formules exclusives, sans parti-pris, car sa sensibilité, à la fois pleine de lyrisme et de pudeur, lui accorde de voir l'âme des moyens, et non leur squelette seulement. Une vraie vie traverse ses oeuvres vocales et instrumentales. Une vie disciplinée dans l'émotion même. Cela n'est-il pas un peu de ce classicisme nécessaire à donner perdurabilité à l'oeuvre ? Enfin, ce cours de composition nous intéresse énormément parce que Bertelin a su y choisir des exemples musicaux de musiciens français, de tous les siècles et jusqu'au XX" siècle ; ce qui n'est pas banal en ces temps où l'on croit tout apprendre de l'étranger, même nos propres chants. Vous pouvez être silencieusement confiant en votre production musicale et didactique, mon cher Bertelin, car, par elle, vous « faites le point » pour l'avenir.
Georges Migot, « Albert Bertelin et son cours de composition musicale », in : La France active, Paris, juillet 1929, p. 182-183.
« Les Deux Mélodies de M. Albert Bertelin, que Mme Lily Fabrègue chanta avec goût, sont également d'une facture agréable sinon très originale : la sensibilité qui les a inspirées fait leur charme. »
« Concerts divers », in : Le Ménestrel, Heugel, Paris, 25 mars 1932, p. 145.
« [Quant aux mélodies de] M. Albert Bertelin, elles se caractérisent par une écriture solide, stricte et probe ; elles sont l'oeuvre d'un vrai musicien particulièrement averti en son métier. »
« Concerts divers », in : Le Ménestrel, Heugel, Paris, 15 mai 1936, p. 162.
*
Le compositeur était souvent sollicité pour écrire des morceaux de lecture à vue pour les classes d'instruments du conservatoire de Paris. Albert Bertelin était par ailleurs critique musical et chroniqueur dans plusieurs revues dont Comoedia, L'Art musical, La Revue musicale S.I.M. On peut trouver le catalogue (non exhaustif) de ses œuvres (ouvrages pédagogiques, mélodies, pièces pour piano, pour orgue, musique de chambre, musique orchestrale, musique vocale religieuse) sur le site internet de la BNF : https://data.bnf.fr/fr/14837401/albert_bertelin/
Olivier Geoffroy
(janvier 2019)
1903Juliette TOUTAIN (1877-1948) Candidate admise à concourir, mais ayant renoncé. Lisez sur Musica et Memoria les textes: Juliette TOUTAIN, précurseuse du Prix de Rome pour les femmes.
Vers 1902
(photo X..., in Musica 1903, coll. D.H.M.) DR.
Raoul LAPARRA (1876-1943)
Portrait photographique en buste, dédicacé en 1928 par Raoul Laparra à Claude Champagne, qui fut son élève de composition et d'orchestration au Conservatoire de Paris. ( Photo Apeda, reproduite à partir du site Web de la Bibliothèque nationale du Canada www.nlc-bnc.ca )
Raoul Laparra (1876-1943), Premier Grand Prix de Rome en 1903 avec la cantate Ulysse, auteur notamment d'un triptyque La Habanera, La Jota et La Malaguena, puis du Joueur de Viole qui sont ses principales compositions dramatiques. Egalement critique musical, il a collaboré au Ménestrel et au Matin. ( photo Bert, 1910. )
Raoul Laparra ( Détail de l'illustration ci-dessous )
Raoul Laparra, 3e mouvement (Andante espressivo) de la 1ère Sonate pour violon et piano (Paris, Hamelle, 1911)
Fichier audio par Max Méreaux (DR)
Menu gravé par Devambez (graveur-éditeur d'art) pour un dîner parisien du lundi 23 novembre 1903 au cours duquel Léon Jaussely, Eugène Piron, André-Jean Monchablon et Raoul Laparra, reçus cette même année Grand Prix de Rome, respectivement d'architecture, de sculpture, de peinture et de musique, fêtent leur récompense, avant de partir prochainement (le 28 décembre) à la Villa Médicis. La cantate Ulysse, sujet du concours de composition remporté par Laparra, est sans doute à l'origine du thème antique de ce menu : alphabets grec et latin, couleurs, tête de lion, ornementation. La barque sur laquelle voguent vers la Gloire les 4 lauréats, porte l'inscription "Illusions - Fragile". Le menu est hautement humoristique : Potages, Bagration brunoise, Hors-d'œuvre, Filets de sole à la Lucullus, Côte de bœuf de Tibur aux champignons de Locuste, Volaille de Campanie bardée au cresson, Salade de laitue aux oeufs, Petits pois à l'égyptienne, Neige des Monts Sabins, Dessert, le tout accompagné de Graves et Bordeaux en carafes, Haut-Barsac 95 (av. JC), St Estèphe, Champagne, Café, Liqueurs. L'auteur de ce menu, dont les initiales semblent être "E.M." entrelacées pourrait être le lauréat du Prix de Rome de peinture Eugène Piron ( coll. Dangla, aimablement communiqué par France Ferran )
1904Raymond PECH (1876-1952)
Raymond Pech, Etude pour piano, "Morceau d'exécution assez difficile, œuvre inédite d'un des meilleurs jeunes musiciens de ce temps, et grand prix de Rome"
(Album Musica, n° 86, novembre 1909) DR.
Partition au format PDFFichier audio par Max Méreaux (DR.)
Raymond Pech, ( photo Cl. Hamel, 1904. ) Compositeur méconnu, Raymond-Jean Pech est né à Valenciennes, le 4 février 1876 et fait ses études musicales à l’Ecole de musique de Valenciennes, puis au Conservatoire de Lille, avant de regagner celui de Paris. Là, il fréquente notamment les classes de Raoul Pugno, puis Xavier Leroux (harmonie) et de Charles Lenepveu (contrepoint et fugue, composition). Il obtient dans cet établissement un 1er prix d’harmonie en 1896, puis un 1er prix de contrepoint et fugue en 1900. Il concourt à trois reprises pour le Prix de Rome et la dernière fois, en 1904, décroche le Grand Prix avec une cantate intitulée Medora, scène lyrique à trois personnages (deux voix d'homme et une de femme), sur un texte d'Édouard Adenis. L’année précédente il avait déjà obtenu un deuxième Second Grand Prix, avec la cantate Alyssa, mais, auparavant en 1902, déjà candidat, sa cantate imposée Alcyone n’avait pas convaincu les membres de l’Académie des Beaux-Arts.
A la fin de l’année 1904 Raymond Pech rejoint la Villa Médicis à Rome, afin d’y effectuer le traditionnel séjour aux frais de l’Institut de France. Il ne reste cependant que très peu de temps dans la ville éternelle, car le 1er mars 1905 il démissionne afin de pouvoir épouser la femme qu’il aime, Madeleine Vannes, née le 24 mai 1881 à Paris. Le règlement alors en vigueur interdisait en effet aux hommes mariés de séjourner à la Villa Médicis. Leurs fiançailles officielles ont lieu peu après en juin suivant et le 10 août à Paris le mariage est célébré.
De retour dans la capitale, au Conservatoire de Paris il enseigne l’harmonie tout d’abord comme suppléant, notamment de son maître Xavier Leroux dans les années 1910. Durant la guerre, il est rappelé et le 16 octobre 1914 il est « pris en subsistance au 127e Régiment d’infanterie comme réfugié et maintenu dans le service auxiliaire ». Le 4 novembre 1915, il passe au 83e Régiment d’artillerie, et plus tard, le 30 novembre 1917, la 2e Commission de réforme de la Seine le réforme pour « artério sclérose ». Son signalement militaire le décrit ainsi : taille 1,75 m, cheveux châtains, sourcils châtains foncés, yeux pers, front moyen, nez moyen, bouche moyenne, menton rond, visage rond.
Darius Milhaud, dans ses Notes sans musique, rapporte : « Depuis mon arrivée à Paris, j’avais assidûment suivi les classes d’harmonie de Xavier Leroux ; il se faisait souvent remplacer par Raymond Pech, un prix de Rome. En dépit de la gentillesse de mes deux professeurs, l’harmonie m’ennuya tout autant qu’à Aix et je ne fis aucun progrès... »
Le 1er octobre 1929, Raymond Pech est enfin nommé professeur d’harmonie, en remplacement d’Auguste Chapuis parti à la retraite, poste qu’il occupera jusqu’à sa retraite prise le 1er octobre 1943.[1]
Alto et chef de chœur à l’Opéra-Comique durant ses études au Conservatoire de Paris, Raymond Pech s’est aussi livré à la composition. Il est l’auteur de mélodies pour voix et piano : Au jardin, poésie de Philoxène Boyer (A. Leduc, 1905) – Songe, poésie de Victor Hugo (A. Rouart, 1905) – Tourment d’amour, poésie d’Eugène Adenis (A. Leduc, 1905) ; de chœurs à 4 voix d’hommes : Souvenirs, poésie de Lucien Bazin (Paris, Margueritat, 1907) – Ballade, poésie de Victor Hugo (Paris, Monvoisin,1909) Les Reîtres, chanson barbare, id. (id., 1911) – L’Art et le peuple, id. (id., 1911) – Sonnet d’Arvers, poésie de Félix d’Arvers (id., 1912) – Chœur polonais, poésie de Sully Prud’homme (id., 1914) – Spectacle rassurant, poésie de Victor Hugo (Buffet-Crampon, 1931) ; de quelques pages de musique de chambre (quatuor à cordes, morceaux de violon) et pour piano (Impromptu, valse, Leduc), ainsi que de pièces de musique religieuse, parmi lesquelles on trouve une Messe. Son hymne à la gloire du Nord, intitulé La Lilloise, lui valut en 1932 à Lille un prix de composition lors d’un concours durant lequel un jury, présidé par Edmond Gaujac, directeur du Conservatoire de cette ville, avait dû examiner 30 manuscrits avant de retenir le sien. Cette œuvre fut exécutée le 8 mai par l’ensemble « Choral des XXX » dirigé par Raymond Robillard, avec le concours d’un « brillant » orchestre.
N’oublions pas également des ouvrages pédagogiques : 40 Leçons d’harmonie (20 basses données, 20 chants donnés) à l’usage des classes du Conservatoire national de musique de Paris (Paris, Heugel, 1928) et 80 Leçons d’harmonie, 2e série (30 basses données, 30 chants donnés, 20 basses et chants alternés) à l'usage : 1° des élèves des écoles de musique et conservatoires de province ; 2° des candidats sous-chefs et chefs de musique de l'armée ; 3° des élèves du Conservatoire national de musique de Paris (Heugel, 1934).
Raymond Pech est mort à Paris, le 3 juillet 1952, en son domicile du 35 rue Rochechouart qu’il occupait depuis 1911. Son épouse lui survécut près de 25 ans avant de décéder à son tour le 18 octobre 1976 à l’âge de 94 ans.
Denis Havard de la Montagne
[1] Parmi ses nombreux élèves, signalons Louis Guillaume Guglielmi (1916-1991), aussi élève de piano dans la classe de Lazare Lévy, qui fréquenta sa classe d’harmonie à la rentrée scolaire de 1934. Mais, il en démissionna au bout d’une année, en octobre 1935. Connu sous le nom de « Louiguy », il fit une brillante carrière dans la variété. Un temps pianiste d’Edith Piaf dans les années quarante, il lui composa plusieurs succès dont La vie en rose (1945) et pour d’autres interprètes écrivit des chansons populaires pour Maurice Chevalier, Georges Guétary, André Claveau, Yvette Giraud. Parallèlement, il composa de la musique pour près d’une centaine de films entre 1946 et 1968. Son épouse (en 1937) Andrée Castel (1915-2000) était violoncelliste de profession. Dans les années 1950-1960 elle fit partie du « Trio de Lutèce » avec Catherine Brilli (pianiste) et Jacqueline Brilli-Girard (violoniste).
A cette même rentrée de 1934, un autre élève également futur musicien de variétés, fut admis chez Raymond Pech : Ange Betti (1917-2005), plus connu sous le nom de « Henri Betti ». 1er accessit d’harmonie en 1937, pianiste de Maurice Chevalier durant la guerre, il lui écrivit plusieurs chansons. De nombreuses autres de son cru seront être interprétées par Joséphine Baker, Bourvil, Reda Caire, Suzy Delair, Fernandel, Henri Génès, Yvette Giraud, Jean Marco, Yves Montand, Tino Rossi… On lui doit aussi des opérettes et pièces de théâtre, des revues de casino (Folies Bergère, Moulin-Rouge, Lido) ainsi que des musiques de films et pour la télévision.
Église St-Paul-St-Louis à Paris IV°, construite en 1627, où Paul Pierné fut organiste durant près d'un demi-siècle ( Photo X... )
Paul Pierné à son bureau
(Fonds d'archives Pierné, coll. C Bongers) DR.
Cousin du chef d’orchestre Gabriel Pierné, Premier Grand Prix de Rome en 1882, Paul Pierné est né à Metz le 30 juin 1874 et reçut ses premières leçons de musique de la part de son père, Charles, ancien élève d’harmonie de César-Franck. Il fit ensuite ses études au Conservatoire de Paris, dans les classes de Lenepveu et de Caussade et remporta en 1903 une mention au Grand Prix de Rome, avant d’obtenir l’année suivante le premier Second Grand Prix, derrière Raymond Pech.
Musicien raffiné et sensible, il tint, durant près d’un demi siècle, le grand orgue du facteur Martin (1867) de l’église Saint-Paul-Saint-Louis1, à Paris. Cet instrument, reçu en 1871 par César Franck et Théodore Dubois, comportait alors 36 jeux répartis sur 3 claviers de 54 notes et un pédalier de 27 notes. Il succédait là en 1905 à son père et resta à ce poste jusqu'à sa mort arrivée en 1952. C’est ainsi qu’on lui doit, dans le domaine de la musique religieuse, deux Messes, dont une pour chœur, soli et 2 orgues, un oratorio Jeanne d’Arc, plusieurs pièces d’orgue et des œuvres chorales.
Sa musique, à l’image du compositeur est distinguée et mériterait largement d’être sortie de l’oubli. Parmi son catalogue, on trouve 2 Symphonies exécutées à Paris et en Allemagne, des poèmes symphoniques pour orchestre, dont plusieurs ont été exécutées au Concerts Colonne : Daphné (1910), De l’ombre à la lumière (1912), Cléopâtre, Heures héroïques (1920), Nuit évocatrice, Rapsodie lorraine, L’Illusion vivante, Masque de Comédie (1930), un Quatuor d’archets, des Trios avec piano, une Sonate pour piano et violoncelle couronnée par la Société des Compositeurs, plusieurs opéras : Le Diable galant (Trianon lyrique, 1913), Enilde (ouvrage en 4 actes), Mademoiselle Don Quichotte, des ballets : La Figurinaï (en trois actes) et La Libellule (1923), des pièces pour piano et un cycle de mélodies intitulé Schéhérazade.
Il est mort à Paris, le 24 mars 1952, en laissant une œuvre variée et de grande valeur. Mais la modestie de son auteur, fuyant les honneurs et les foules, a hélas contribué à l’oubli injustifié de ses compositions, même si certaines d’entre elles connurent à leur époque un succès relatif.
Denis HAVARD DE LA MONTAGNE
____________1) L'église Saint-Paul-Saint-Louis, située 99 rue Saint-Antoine, dans le quatrième arrondissement, est l'ancienne église Saint-Louis, construite de 1627 à 1641, de la maison professe des Jésuites qui s'étaient installés à cet endroit en 1580. A la Révolution elle fut affectée au service paroissial (1802) et les bâtiments transformés en école. C'est l'actuel Lycée Charlemagne. Marin de la Guerre, Michel-Richard Delalande, Marc-Antoine Charpentier, Henry Desmarets et André Campra y ont été maîtres de chapelle au cours des XVIIe et XVIIIe siècles. [ Retour ]
Paul Pierné, Prière pour orgue ou harmonium (Abbé Joubert, Les Maîtres contemporains de l'orgue, Paris, M. Sénart, 1912, vol. II, 1ère partie) DR.
Partition au format PDF
Fichier audio par Max Méreaux (DR.)
(Fonds d'archives Pierné, coll. C. Bongers) DR.
Paul Pierné
Paul Marie Pierné est né le 30 juin 1874 à Metz où son père Charles Pierné avait fondé le Cercle Musical Messin. Sa mère, née Julien, fervente lorraine, était elle-même une excellente chanteuse.
Quand, après la défaite, il lui fallut franchir la frontière provisoirement tracée, elle voua, en ardente patriote, son fils à la carrière des armes ; c’est ainsi que lors de son service militaire à Versailles, il prépara l’École de Saint-Cyr. Mais le petit Paul (cousin de Gabriel) élevé dans une atmosphère propice à développer ses dons naturels, était hanté par la musique et, dès sa douzième année, il dédia à sa mère sa première valse.
Fixé à Paris, Charles Pierné, ami de César Franck, tient les orgues du Temple protestant de Pentemont, rue de Grenelle, et son fils à ses côtés s’initie au style de l’art sacré. Il acheva ses premières études faites sous la direction paternelle au Conservatoire d’où, après avoir étudié l’harmonie avec Charles Lepneveu et la composition avec Caussade, il sortit titulaire du [1er second] grand prix de Rome en 1904 pour sa cantate Médora sur un livret d’Eugène Adenis, grand fournisseur officiel de ces exercices pour débutants.
Une page du manuscrit du Requiem pour choeur et orgue
(coll. Cyril Bongers) DR.
Il épousa en 1907 Mademoiselle Hélène Lacarnoy, nom d’ancienne origine espagnole. Victime de la plus tendre tyrannie d’une mère exclusive, il en garda une sorte de rudesse et de brusquerie martiale pour tout ce qui n’était pas sa chère musique. Mais dès qu’il parlait d’elle, dès qu’il la servait, il redevenait un être candide et jovial.
Il donna en 1913 au Trianon-Lyrique sa première œuvre théâtrale, Le Diable galant, opéra comique sur un livret de Fortolis, et il aurait fait représenter une grande opérette, Mademoiselle Don Quichotte, sur un livret de Jeanne-Paul Ferrier [fille du librettiste Paul Ferrier] quand la guerre éclata.
Ayant repris un grade dans l’armée, il aida vaillamment, avec tant d’autres, à délivrer sa ville natale. Citation, croix de guerre et légion d’honneur, mais le premier élan de sa carrière avait été brisé. Et ce n’est qu’en 1932 qu’il retournera au théâtre avec Le Rêve de Musette que suivit en 1935 au Concert Mayol une opérette légère qu’il signe John Bennet’s.
Il a donné, avec Guy de Teramond, toute une suite de petits actes : Une nuit de Cartouche (1935), La Belle Namouna (1937), La Perruche bleue, Les Deux rencontres (1939), une opérette en trois actes : Les Dames galantes de Brantôme, et deux ballets : La Libellule, créé à l’Opéra-Comique en 1941, et L’Ondine. Il composa également, sur des livrets de Ch. L. Pothier Césarine ou La Chanteuse imprévue (1939), Le Marmiton du vert Galant (1944), Le Mur mitoyen, La Demoiselle du Luxembourg et un opéra-comique en trois actes de Fortolis : Énilde.
On lui doit encore Le Pont d’Avignon, ouvrage commandé par l’État sur un livret de Funck-Brentano, et Le Bal du rêve, un ballet sur un argument de Guillot de Saix que le regretté Reynaldo Hahn avait reçu pour l’Opéra ; il avait écrit avec le même deux farces moyenâgeuses : Le Ménage de Jacquinet et Le Pâté d’anguille ; notons aussi des images radiophoniques : Heures de gloire, sur un livret de Jean Bergeaud. On relève encore à son répertoire : deux symphonies dont l’une lui valut un prix de la Société des Auteurs, un quatuor à cordes, une sonate pour piano et violoncelles, plusieurs poèmes symphoniques : De l’ombre à la lumière, Daphné, Nuit évocatrice, Masque de comédie, Cléopâtre, Les Sept merveilles… des impressions de guerre Heures héroïques, un oratorio Jeanne d’Arc à Rouen, doté d’un prix décerné par les membres de la section de composition musicale de l’Académie des beaux-arts.
Il a harmonisé de très nombreuses chansons populaires pour les émissions quotidiennes de folklore à la Radio-Diffusion : L’Almanach qui chante, Les Métiers qui chantent, La Ronde autour des rondes, Un décor, une chanson, C’est Paris qui chante, Le Canada qui chante.
Deux recueils lui ont été commandés par l’éditeur Rouart : Sous les ailes d’Alsace et Sous la croix de Lorraine.
Il a composé par ailleurs un nombre important de mélodies, et il a excellé dans les chansons d’enfants (dont Le Zoo de bébé et Six chœurs humoristiques). La Ronde française avait été déjà couronné en 1931.
Organiste de talent, il a tenu pendant quarante cinq ans le grand orgue du vœu de Louis XIII : Saint-Paul-Saint-Louis, et son désintéressement était tel que jusqu’en 1947, il donna son concours, moyennant un cachet de 40 fr., pour accompagner les trois messes et les vêpres.
Il a écrit cinq messes d’un grand caractère, dont une messe de Requiem qui fut exécutée à son enterrement, et qui était dédiée à la mémoire du Maréchal Leclerc. Mais aucune de ses œuvres religieuses n’égala certaines improvisations qu’à ses heures inspirées il fit jaillir de son clavier.
Paul Pierné est mort après une longue et douloureuse maladie le 24 mars 1952 à l’âge de soixante dix sept ans. Comme il était fort modeste et fort peu intrigant, on peut dire qu’une grande partie de son œuvre reste encore à découvrir.
Léon Guillot de Saix (1885-1964)
auteur dramatique, poète, journaliste
(texte aimablement communiqué en 2007 par Cyril Bongers)

Hélène Fleury
(photo E. Pirou, 1904) DR.
Hélène Fleury-Roy, Pastorale pour orgue ou harmonium (extrait, première page), dédicacée "A Monsieur Georges Jacob" [1877-1950, ancien élève de l'École Niedermeyer puis du Conservatoire de Paris, 1er prix d'orgue en 1900, organiste et maître de chapelle à Paris] ( Abbé Joubert, Les Maîtres contemporains de l'orgue, vol. 4, Paris, Sénart, 1914 ) DR Hélène FLEURY-ROY (1876-1957)
Hélène-Gabrielle Fleury, née à Carlepont (Oise) le 21 juin 1876, fille de Jules Fleury, licencié en droit, et d'Elvire Moutillard, élève de Dallier, Widor et Gedalge au Conservatoire de Paris, a été la première femme admise en 1903 à se présenter au Prix de Rome de composition musicale, mais elle échoua à l'épreuve de fugue. L'année suivante, elle se présentait à nouveau et réussissait sa fugue, pouvant ainsi se présenter à la deuxième épreuve : la mise en musique d'une cantate imposée, à trois personnages (deux voix d’homme et une voix de femme) : Medora d'Edouard Adenis. Les cinq autres candidats à ses côtés étaient MM. Saurat, Pech, Gaubert, Paul Pierné et Gallois. Le jury lui attribua un deuxième second Grand Prix, décernant à Raymond Pech le premier Grand Prix et à Paul Pierné le premier second Grand Prix.
Dans les années 1890, Hélène Fleury habitait à La Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-Marne). C'est de là qu'elle envoyait ses manuscrits à la Revue musicale Sainte-Cécile [de Reims], organisatrice de Concours de composition. Ayant concouru à plusieurs reprises, elle remporta notamment le 28 mai 1899 le Prix avec un Allegro symphonique pour orgue, devant Théodore Sourilas (Paris), Albert Roussel (Paris) et Raoul de Lescazes (Toulouse). Le jury était composé de Louis Vierne, Henri Dallier, Henry Eymieu, Isidore Massuelle, Henri Lemaire et J.A. Wiersberger. Cette œuvre sera publiée dans le supplément du numéro 19 (4 août 1899). Plus tard, professeur de piano, après avoir épousé à Paris le 10 juillet 1906 Louis Roy, elle résidait en 1909 dans le quinzième arrondissement parisien, 1 rue d'Alencon. Son époux, né le 21 juin 1882 à Troyes (Aube), décédé le 13 juillet 1959 à Castres (Tarn), docteur ès sciences, dans les années vingt professeur de mécanique rationnelle et appliquée à la Faculté des Sciences de l'Université de Toulouse, est l'auteur de plusieurs ouvrages ayant trait à sa spécialité.
En 1928, Hélène Fleury-Roy succédait à Georges Guiraud dans sa classe d’harmonie du Conservatoire de Toulouse. Celui-ci, décédé le 11 février de cette année, avait été autrefois élève de l’Ecole Niedermeyer et de César-Franck au Conservatoire de Paris, avant de tenir l’orgue de la basilique Saint-Sernin de Toulouse. En 1945, elle était remplacée à son tour par Edmond Gaujac, également ancien lauréat du Prix de Rome (1927). 1
Professeur réputée de piano et de composition, Helène Fleury-Roy compte parmi les nombreux élèves qu’elle eut l’occasion de former à Toulouse le chef orchestre Louis Auriacombe, futur fondateur de l’Orchestre de chambre de Toulouse, le compositeur Charles Chaynes, qui obtiendra lui aussi un Grand Prix de Rome en 1951, et le violoniste Pierre Doukan, futur titulaire d’une classe de violon au Conservatoire national supérieur de musique de Paris (1969).
Hélène Fleury-Roy est l'auteur d’un grand nombre de pièces pour piano principalement éditées chez Enoch et Lemoine (Arabesque, Bourrée Gavotte, Canzonetta, Espérance, Fleur des champs, La Nuit, Minuetto, Valse Caprice..., ainsi qu'un Scherzo et une Etude pour la main gauche seule qu'elle interpréta le 14 décembre 1899 à Reims, lors d'un concert de l'Orphéon des enfants de Saint-Rémi), pour voix (Cœur virginal, Mattutina), pour violon (Brise du soir, Trois pièces faciles), pour violoncelle (Rêverie) ou encore pour alto (Fantaisie). On lui connaît en outre une Grande Fantaisie de concert, écrite en 1906 et dédiée à Théophile Laforge, professeur d’alto au Conservatoire de Paris, qui fut autrefois donnée comme morceau de concours au Conservatoire et un Quatuor pour piano et instruments à cordes que l’on pouvait fréquemment entendre en concert à Paris avant la première guerre mondiale. Enfin, signalons une Pastorale en la majeur pour orgue, publiée par l’abbé Joubert dans ses recueils de pièces inédites pour grand orgue avec pédale obligée, intitulés Les Maîtres contemporains de l’orgue, parus à partir de 1911 chez l’éditeur de musique Sénart (quatrième volume, 1914). Malheureusement, les compositions d'Hélène Fleury-Roy sont quelque peu délaissées de nos jours! Elle s'est éteinte le 18 avril 1957 à Saint-Gaudens (Haute-Garonne), non loin de Toulouse, où elle s'était retirée.
Denis Havard de la Montagne
____________
(mai 2010 -janvier 2014)1) Nous devons à Madame Nicole Jacquemin, bibliothécaire du CNR de Toulouse, les quelques renseignements figurant ici sur la carrière toulousaine du compositeur. [ Retour ]
Mlle Hélène FLEURY
Deuxième second Grand-Prix de Rome, 1904
(Musique)
— Vous ne refuserez pas une tasse de thé ?
— No ; but pray, give me very little... Puis voudrez-vous venir avec moi ?
— Où donc ?
— Je vais prendre ma leçon de piano en anglais.
— ???
— Il y a peu de temps que j’ai découvert, en votre Paris même, une pianiste de beaucoup de talent. Une Française. Mais elle parle couramment l’allemand et l’anglais. Elle donne des leçons de musique dans une de ces trois langues, au choix. J’appris cela par hasard. Je courus chez elle. Depuis je m’en félicite, vu que les explications fournies en anglais me sont plus compréhensibles. Au fait, j’ai sa carte sur moi. Voyez :
Hélène Fleury
Compositeur et Pianiste
Professeur de Piano, Harmonie et Contrepoint
Leçons de Musique en Français, Allemand, Anglais
« Vous la connaissez peut-être, au moins de nom : elle concourut dernièrement pour le Prix de Rome.
— Oui, je me souviens. Et n’a-t-elle pas obtenu le Deuxième second Grand Prix ?
— Parfaitement. Allons, venez-vous ? It is fine weather.
— Vous avez raison, le temps semble fort beau. Partons.
Peu après nous nous trouvions en un petit salon familial. Fauteuils de tapisserie, panneaux couverts de hautes reproductions photographiques. Un de ces intérieurs de la bourgeoisie de province où traînent, au long des meubles, et dans chaque bibelot, de vieux et chers souvenirs. Entre la cheminée et la fenêtre, contre le mur, un piano noir, l'instrument sur lequel, sans doute, Mlle Fleury s’exerça depuis son enfance.
Je reste en tête à tête avec la maman. En sa robe noire garnie de crêpe, sous ses cheveux blancs, elle a un air doux et triste. On la sent heureuse, mais nullement surprise du récent succès.
— Nous habitions Compiègne... Originaires de Lorraine, nous naissons musiciens chez nous... Hélène, tout enfant, marqua des dispositions fort vives pour le piano. Dès qu’elle atteignit ses six ans, elle prit, trois fois par semaine, régulièrement, des leçons de musique. Je me réservais la surveillance de ses études ; aussi, lorsqu’à huit, neuf ans, elle improvisait au piano, j’écrivais, notais près d’elle, les airs qu’elle jouait. Plus tard, elle entra au Conservatoire dans la classe de Widor, et elle vint dès lors, dans ce but, chaque semaine à Paris. Son père et moi, heureux de ses dispositions musicales, nous l’encouragions. Mon mari mourut l’an dernier, quelques mois trop tôt pour assister au succès de notre fille...
Un nuage de tristesse, une seconde, voilà le regard de mon interlocutrice. Mais déjà elle souriait : Mlle Fleury venait d’entrer.
Hélène Fleury, fragment de sa cantate Médora
écrite pour le concours du prix de Rome en 1904
(in revue Lectures de la Femme, août 1904) DR.
Plutôt grande et forte, blonde, l’œil intelligent, l’accueil sympathique :
— Maman vous racontait sans doute que nous voici maintenant complètement installées à Paris. Je me sens contente d’être de retour de Compiègne. Vraiment, à la fin de mon séjour, malgré la fièvre du travail, je commençais à devenir un peu lasse de cette existence spéciale et monotone que les règlements imposent aux concurrentes du prix de Rome. Le château avait beau être admirable, l’organisation des loges et du service étaient vainement parfaites ; un mois au secret, cela paraît long !
— Mais je croyais que l’ensemble des épreuves durait plus d’un mois ?
— L’ensemble, oui. Il faut d’abord remettre un certificat de son professeur attestant des capacités à prendre part au concours. Ce professeur doit être connu, sans que, forcément, il appartienne au Conservatoire. Puis a lieu une épreuve d’essai, d’une durée de six jours. L’an dernier je fus éliminée ; cette année nous nous présentâmes quinze. Après les huit journées d’attente qui séparent les deux épreuves, j’appris que je me trouvais admise au nombre des six concurrents autorisés à concourir définitivement. Je manifestais le désir de ne point me singulariser en rien, de partager la vie de mes collègues hommes, s’ils voulaient y consentir et ne pas se contraindre, se gêner, par le fait de ma présence. Ils acceptèrent. Une seule chose nous différencia : suivant la coutume, ils eurent un domestique, et l’on me donna une femme de chambre.
« Nous entrâmes en loge pour un mois. La cantate imposée comportait trois personnages : Sélim, Giaffar, Médora (deux voix d’homme et une voix de femme). Titre : Médora.
« La sortie de Compiègne se trouve suivie d’une période de douze jours pour s’entendre avec ses interprètes. Puis, le 1er juillet, au Conservatoire, première audition. Le lendemain, à l’Institut, audition définitive. J’eus comme interprètes, Mlle Demangeot ; MM. Dubois, de l’Opéra, et Beck, baryton viennois. Tous trois s’affirmèrent parfaits.
« A la proclamation du résultat, M. Pech devenait l’heureux titulaire du Premier Grand Prix. L’an dernier, il obtint une mention honorable en même temps que M. Pierre Pierné, cette fois Premier Second Prix, et bénéficiaire d’un don qui, depuis celle année, s’y trouvera adjoint, soit 1.800 francs. A moi revenait la gloire d’être Deuxième Second Grand Prix.
— Et ?
— Et rien. Pourquoi cette question ?
— Mais il me semble que ce concours se résume très coûteux pour les concurrents ?
— Plutôt. Il y a les frais de séjour au château. Résidence oblige ! et les pourboires doivent atteindre à telle grandeur ! Mais je recommencerai en 1905. Je risquerai, à nouveau, la chance de décrocher le Premier Grand Prix, puisque je n’ai pas encore atteint la limite d’âge : trente ans.
« J’aime passionnément mon art, et même, si je me marie, j’espère y demeurer attachée, mais en sachant l’empêcher de devenir une entrave dans mon intérieur. J’essayerai, au contraire, de l’allier, de le confondre dans l’air familial, afin qu’il me soit une force, et non une source de malentendus.
— Mais quel avenir y sentez-vous pour la femme ?
— A quel point de vue : professorat ?
— Non pas. Le nombre des professeurs-femmes, en musique, se trouve déjà très élevé. Le nombre des compositeurs-femmes, a toujours été très restreint. Alors ?
— Alors, mon Dieu, je crois la femme capable de donner un acte, un bon acte, un excellent acte, mais non de fournir un opéra entier. Elle possède plus profondément que l’homme le don d’éprouver, d’enregistrer une impression ; elle s’affirme plus sensitive. Cependant elle ne dispose pas de la même force conceptive, créative. L’idéal, là comme en tout, il me semble, serait l’œuvre mixte, née d’une collaboration étroite.
Diane-Gabrielle Rony
in Lectures de la Femme,
magazine hebdomadaire de la famille
n° 17 du 18 août 1904
1905
Victor Gallois, Premier Grand Prix de Rome en 1905, directeur du Conservatoire de Douai (Nord). Ce fut lui qui enseigna le premier la musique à Henri Dutilleux, venu se fixer avec sa famille à Douai en 1919. ( photo Cl. Manuel, 1905 )
Articles et illustrations sur cette page spécifique.
Marcel SAMUEL-ROUSSEAU (1882-1955)
Marcel Samuel-Rousseau, 1882-1955, deuxième Second Grand Prix de Rome 1905. ( photo Cl. Manuel, 1905. ) Né le 18 août 1882 à Paris 7e, au domicile de ses parents situé 80 rue Vanneau, Marcel-Auguste-Louis Rousseau se fera appelé plus tard, en souvenir de son père Samuel Rousseau, « Marcel Samuel-Rousseau ». Venu au monde dans un milieu où la musique est vénérée – son père est organiste, chef d’orchestre et compositeur, sa mère née Eva Lambert Cilleuls est la sœur du professeur de chant renommé Louis Lambert des Cilleuls et belle-sœur de Berthe Merklin, fille du facteur d’orgues Michel Merklin – il est très tôt initié à cet art. Elève de son père, et en cours particuliers du pianiste Paul Braud, il se livre très tôt à la composition. On lui connaît en effet deux pièces Rêverie et Scherzo, pour clarinette et piano, exécutées à Paris en avril 1901, une Romance pour cor et harpe chromatique (Leduc), récompensée en avril 1902 par un prix décerné par la Société des compositeurs de musique (elle est jouée le mois suivant à la Salle Pleyel), un drame lyrique en un acte, Le Bonheur des vieux, sur un poème de Georges Mitchell, reçu en janvier 1905 par Albert Carré à l’Opéra-Comique, mais jamais monté. En 1904, il est aussi l’un des plus jeunes critiques musicaux, puisqu’il succède à son père dans les chroniques musicales du journal L’Eclair.
A propos de sa Romance jouée à Pleyel, le journal L’Eclair écrit dans son édition du 12 mai 1902 : deux idées exposées l’une au cor, l’autre à la harpe qui, à la rentrée, se juxtaposent, ingénieusement interverties ; poétique coda où s’entremêlent des notes bouchées du cor et des sons harmoniques de harpe. Fort bien jouée par M. Vuillermoz et Mlle Lucile Delcourt, cette œuvrette a été chaleureusement accueillie.
Entré au Conservatoire de Paris, dans la classe d’harmonie d’Albert Lavignac, il y obtient en 1903 un 1er prix, et la même année le prix Rossini pour son drame lyrique Le Roi Arthur, sur un poème de Fernand Beissier, exécuté au Conservatoire le dimanche 8 novembre 1903 sous la direction de Georges Marty. Fréquentant également la classe de composition de Charles Lenepveu celui-ci le mène à concourir pour le Prix de Rome de composition musicale en 1905. Cette année-là, 6 candidats sur 19 sont retenus pour l’épreuve finale, les 13 autres, dont Maurice Ravel, ayant été éliminés dès la première épreuve de fugue. Il entre alors en loge le samedi 20 mai au château de Compiègne aux côtés des cinq autres candidats pour l’épreuve finale : Louis Dumas, Philippe Gaubert, Victor Gallois, César-Abel Estyle et Ferdinand Motte-Lacroix. La cantate Maïa, sur des paroles de Fernand Beissier, lui vaut un second premier grand prix, derrière Victor Gallois, premier nommé. Exceptionnellement, en raison du départ au bout de seulement une année de la Villa Médicis de Raymond Pech, Marcel Rousseau est admis à séjourner à la Villa. Arrivé à Rome en tant que pensionnaire à la fin de l’année 1905, il composait durant son séjour entre 1906 et 1908 un opéra-comique en un acte Un Matin de Floréal, sur un livret de Paul Gravollet et Henri Cain (ouvrage reçu en 1908 par Albert Carré à l’Opéra-Comique, mais jamais monté), une Suite pour petit orchestre (flûte, hautbois, clarinette, basson, cor chromatique et harpe), un Quatuor à cordes, un Scherzo-fantaisie pour 5 cordes, un Noël berrichon avec chœur et orchestre et un Requiem, qui, lors de son exécution à Paris en décembre 1909 fait écrire par Marcel Bertrand : Dans son Requiem, M. Marcel Rousseau témoigne d’une force et d’une intensité remarquables, et le Pie Jesu, admirablement chanté par Mlle Raveau, est d’une inspiration profonde et très élevée. A cette même audition, au Conservatoire, des envois de Rome de Marcel Rousseau, sont également donnés un Scherzetto sur des chansons enfantines, L’Adoration des Mages et Bergers, sur le Noël de Théophile Gautier et son Noël berrichon, Suite pour double quintette « tout à fait charmante avec ses combinaisons d’instruments à vent » composée de 5 morceaux : Danse et chanson sur la Grand’Place, Veillée de minuit, Refrain de noceux, Les Promis, Assemblée.
De son séjour dans la ville éternelle, Marcel Rousseau en conserva une impression profonde, déclarant en mars 1911 au journal Le Gil Blas : On vit une minute inoubliable sur le quai même de la gare de départ, et l'impression du nouvel élu, quittant Paris, est une impression unique et délicieuse. C'est pour nous, la perspective d'années pendant lesquelles, de simples élèves que nous sommes au départ, par la force même des choses, par la vue de tout ce qui nous entourera durant notre séjour en Italie, par nos visites, en groupes, dans les musées, nous nous élèverons petit à petit, degré par degré, au véritable rang d'artistes, avant de revenir à Paris. Et puis, cette vie, entre camarades, est exquise. Nous vivons dans une fraternité touchante, nous communiquant mutuellement nos impressions, notre idéal. Nous allons à Rome pour écouter, rêver, méditer, nous recueillir, flâner.
Peu après son retour de Rome, Marcel Rousseau publie en 1911 chez l’éditeur Henri Lemoine un ouvrage pédagogique intitulé 30 leçons de solfège à changements de clefs, sur toutes les clefs, dans tous les tons majeurs et mineurs. La même année, il est nommé organiste et maître de chapelle de la toute nouvelle église parisienne Saint-Joseph des Epinettes, située 40 rue Pouchet (XVIIe arr.). Construite l’année précédente, le facteur Mutin vient d’y installer l’orgue de salon Cavaillé-Coll (1898) installé primitivement chez la comtesse Anna de Noailles. En 1905, cet instrument fut racheté par les grands-parents d’Emile Aviné (1er prix orgue chez Guilmant en 1903) qui l’installait dans son domicile de Gisors, avant de le revendre à la paroisse St-Joseph. Plus tard, Marcel Rousseau touche entre 1919 et 1921 le grand-orgue de Saint-Séverin, au départ d’Albert Périlhou et avant la nomination de Marcel Lambert-Mouchague. On lui doit dans le domaine de la musique religieuse quelques œuvres dont un motet In Paradisum pour chœur à 3 voix mixtes et orgue (Choudens) et un Agnus Dei pour solo de baryton et choeur, avec violon, violoncelle, orgue et contrebasse (Pérégally). Cette dernière œuvre, composée par son auteur à l’âge de 17 ans, est exécutée en 1ère audition le 26 avril 1899 à Sainte-Clotilde lors des obsèques de François Leriche de Cheveigné, 32 ans, son frère le capitaine Alexandre Leriche de Cheveigné (37 ans) et le fils de ce dernier, Alexandre (7 ans), morts noyés avec 5 autres personnes, dont la mère du jeune Alexandre, dans le chavirage de leur barque dans la baie de Quiberon (Portivy).
Au début de l’année 1916, il met en musique, pour mezzo-soprano ou baryton et piano (ou orgue), la poésie en vers Aux anonymes ensevelis au hasard des champs d’honneur écrit au front en Argonne en 1915 par le caporal Louis Houzeau (connu sous son pseudonyme Louis Hennevé, 1885-1972), pour consoler la veuve d’un soldat tombé à ses côtés. Editée par Hamelle, cette œuvre sera régulièrement donnée en concert et à la radio durant les décennies suivantes et notamment le dimanche 27 avril 1919 par la Société des Concerts du Conservatoire, chantée par Alice Raveau, de l’Opéra-Comique. En 1931, le label de disques Pathé l’enregistre interprétée par elle « dont la voix grave et ample se prête admirablement à l’enregistrement. »
Marcel Samuel-Rousseau, vers 1910
(photo X...) DR.
Marcel Samuel-Rousseau, 1ère des
Variations sur un vieux Noël, pour harpe
(Paris, L. Rouhier, éditeur, 1917) DR.
Partition au format PDFFichier audio par Max Méreaux (DR.)
Aux Anonymes ensevelis au hasard des champs d’honneur
Il n’est pas besoin d’une pierre
Aux lieux où reposent nos morts.
Notre cœur est leur cimetière
Et garde, vivant reliquaire,
Leur souvenir comme un trésor.
Il n’est pas besoin de couronnes
Pour fleurir leur dernier repos ;
La seule palme qu’on leur donne
Survit aux rouilles de l’automne
Et pousse à l’ombre du drapeau.
Il n’est pas besoin de prières
Pour leur gagner le paradis,
Car Dieu reçoit en sa lumière
Ceux qui l’ont bien servi sur terre
Et qui meurent pour leur pays !
Plus tard, Reynaldo Hahn mettra également en musique (baryton et piano) cette poésie, avec un autre titre, A nos morts ignorés (Au Ménestrel, Heugel, 1918), mais c’est la partition de Samuel Rousseau qui restera connue et jouée entre les deux guerres.
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, classe de Marcel Samuel-Rousseau, 1952; de gauche à droite : Denise Fossiez (assise), Marie-Claire Laroche, Nicole Lapierre, Jacques Boisgallais (assis), René Maillard, Jean Della-Valle
( coll. René Maillard )
En 1917, il succède à Emile Pessard dans sa classe d’harmonie (hommes) du Conservatoire de Paris et prendra sa retraite 35 ans plus tard en 1952. Parmi les nombreux élèves qui suivirent sa classe, on peut noter les Prix de Rome Maurice Franck, Tony Aubin, Aimé Steck et Jacques Castérède, ainsi que Marcel Dautremer (directeur du Conservatoire de Nancy) et son épouse Anne-Marie Dautremer-Perret (professeur de musique), les compositeurs Jacques Leguerney, Jacques Boisgallais et Jean Cartan (mort à 25 ans en 1932), et le chef d’orchestre Richard Blareau (Monte-Carlo, Théâtre des Champs-Elysées, Nice, Opéra-Comique).
Parallèlement à ses activités pédagogiques Marcel Samuel-Rousseau occupe aussi différents postes : membre du Conseil supérieur des études du Conservatoire national de Paris, président des jurys pour les chefs de musique de l’armée et de la Garde républicaine, membre de l’Union des Maîtres de Chapelle et Organistes (UMCO) présidée par Widor, directeur artistique chez Pathé, membre (1935), puis vice-président de la Sacem, directeur artistique de l’Opéra de Paris de 1941 à 1945, succédant-là au regretté Philippe Gaubert et laissant plus tard la place à Reynaldo Hahn. Le 3 décembre 1947 il est élu membre de l’Académie des Beaux-Arts au fauteuil de son successeur à l’Opéra Reynaldo Hahn. Chevalier de la Légion d’honneur en 1927, il reçoit la croix d’officier en 1952.
Tout au long de sa longue carrière, il n’abandonne jamais la composition se tournant plus particulièrement dans l’écriture d’ouvrages lyriques et autres musiques de scène. En plus des ouvrages précités, on lui doit en effet chronologiquement : Promenades dans Rome, ballet en 1 acte et 4 tableaux composé durant son séjour à Rome, scénario de Jean-Louis Vaudoyer, créé tardivement à l’Opéra le 14 décembre 1936 ; musique de scène d’Esther, princesse d’Israël, pièce en 4 actes en vers, paroles d’André Dumas et Sébastien-Charles Leconte, montée le 7 février 1919 à l’Odéon ; musique de scène pour la tragédie de Racine, Bérénice, jouée le 27 mars 1919 à l’Odéon ; Tarass Boulba, drame musical en 3 actes et 5 tableaux, de Louis de Gramont d’après Gogol, créé le 22 novembre 1919 au Théâtre lyrique du Vaudeville, repris à l’Opéra-Comique le 10 mars 1933 ; Le Hulla, conte lyrique oriental en 4 actes, paroles d’André Rivoire, créé à l’Opéra-Comique le 9 mars 1923 et reprise le 7 octobre 1926 ; Le Bon roi Dagobert, comédie musicale en 4 actes, paroles d’André Rivoire (Heugel), créée à l’Opéra-Comique le 5 décembre 1927 (62e représentation le 16 mai 1943) ; Entre deux rondes, ballet, duo chorégraphique en 1 acte, créé à l’Opéra le 24 avril 1940 avec une chorégraphie de Serge Lifar ; Kerkeb, danseuse berbère, drame musical en 1 acte, livret de Michel Carré d’après une nouvelle d’Elissa Rhaïss, créé à l’Opéra le 6 avril 1951. Son ultime ouvrage dans ce domaine, un opéra comique en 3 actes, L’Ami Fritz, écrit sur un livret de Jean Sarment d’après le roman d’Erckmann-Chatrian, semble être resté inédit.
Louise Samuel-Rousseau, vers 1945
(photo X...) DR.
Lors de la première du Bon roi Dagobert, Alfred Bruneau écrivait dans Le Ménestrel (édition du 9 décembre 1927) : La partition de Marcel Samuel-Rousseau s’associe étroitement au poème d’André Rivoire. Elle l’anime d’un mouvement ininterrompu qu’engendrent à la fois l’ordre et la fantaisie. Elle est, du même coup, réfléchie et spontanée, sans que la réflexion y soit maussade, ni la spontanéité vulgaire. Elle a une abondance exempte de lourdeur, un équilibre rassurant et non contraint. Elle est naturelle et raffinée, coulant de source claire en un flot miroitant d’harmonies fraîches. Ses idées, élégantes et précises, s’exposent et se développent normalement, répudiant la bizarrerie, l’emphase, la prétention et la complication. Le fameux motif populaire du « Roi Dagobert qui a mis sa culotte à l’envers » y est employé, orné de piquantes altérations, morcelé, déformé avec une adresse rare, un humoristique à propos. D’autres airs, de semblable provenance y sont aussi utilisés de la plus ingénieuse manière. On y remarquera la façon nouvelle dont le texte parlé s’enchaîne aux vers chantés et l’on constatera les avantages frappants du procédé. On admirera la sûreté de l’instrumentation, ses couleurs logiquement disposées, son éclat et sa force quand elle s’amplifie, sa fluidité discrète lorsqu’elle s’efface pour nous laisser écouter tout ce qui se dit d’amusant sur le « plateau ». Je n’essaierai point de vous désigner une à une les principales pages de cette œuvre fortunée. Je me borne à louer l’irrésistible attrait de l’ensemble.
Il convient d’ajouter qu’il est également l’auteur de mélodies pour voix et piano, ainsi que des Variations pastorales sur un vieux Noël pour harpe et orchestre (Leduc), des Variations à danser pour piano et orchestre (Leduc), Musique pour un Théâtre de marionnettes, 3 pièces brèves pour orchestre de chambre (Choudens), Mélancholia pour orchestre, Chanson pour bercer (harpe, hautbois, ou piano), Rythmes et danses sur le même thème, pour piano seul (Leduc, 1926), 2 Pièces pour quatuor à cordes (Durand), Pièce concertante pour trombone et piano (Leduc), L’Eveil des nymphes, chœur a cappella pour voix de femmes, sur des paroles d’Albert Samain (Hamelle). Certaines partitions inédites, restées dans ses cartons, sont aussi à signaler, Yamilé sous les cèdres (d’après Henry Bordeaux), Le retour de Robinson Crusoé (d’après Miguel Zamacoïs) …
Signature autographe de Marcel Samuel-Rousseau, 1922
( Coll. D.H.M. )Décédé à l’âge de 73 ans le 11 juin 1955 en son domicile 52 rue de Clichy dans le neuvième arrondissement parisien, Marcel Samuel-Rousseau laisse une veuve, Louise Boizot. Celle-ci, née le 3 février 1881 à Paris, fille de François Boizot, architecte parisien et de Gabrielle Bagriot, lui survit quelques années jusque le 17 novembre 1961, date de son décès arrivé à Paris. Tous deux s’étaient connus lors de leurs études d’harmonie au Conservatoire où Louise étudiait cette discipline dans la classe de Samuel Rousseau, le père de Marcel. Mariés le 4 mars 1907 à Paris, plus tard, elle enseignera le solfège dans cet établissement entre 1919 et 1949. Parmi ses élèves, mentionnons Maurice Duruflé et Jacques Chailley. D’une liaison avec Irène Plicque-Boudon, professeur d’éducation musicale, Marcel Samuel-Rousseau eut une fille, Eveline, née le 25 janvier 1929 à Paris. A son tour, tout comme son père et son grand-père, elle sera lauréate du prix de Rome de composition musicale en 1950, cas unique dans l’histoire de la musique de trois générations successives.
Quelques années plus tard, un « Prix de composition musicale Marcel Samuel-Rousseau » a été créé à l’Académie des Beaux-Arts. Le concours, d’un montant de 60.000F, était ouvert à tous les compositeurs pour récompenser la création d’une œuvre lyrique d’expression française. Parmi les récipiendaires figurent Daniel-Lesur en 1973, Dominique Probst pour son opéra Maximilien Kolbe en 1986, André Bon pour son opéra La Liseuse en 1993 et François Narboni (mention en 2000).
Denis Havard de la Montagne
 |
|
Grand Prix de Rome 1905, chef d'orchestre à l'Opéra de Paris, professeur de direction d'orchestre au Conservatoire de Paris ( Musica, n° 98 ) |
PHILIPPE GAUBERT
en 1929, par Charles Tournemire
Jeune encore, Philippe Gaubert a servi la musique avec un relief tellement particulier qu'il parait aujourd'hui opportun de lui consacrer une étude aussi complète que possible. Ses succès au Conservatoire furent très grands : il obtint avec facilité un éblouissant premier prix de flûte ; très peu d'années après cette première distinction, il égalait son maître Taffanel quant au style et à la sonorité. On sentait déjà qu'une invisible fée s'attachait à ses pas, elle ne devait plus l'abandonner. Gaubert obtint rapidement un remarquable premier prix de fugue et un premier second grand-prix de Rome. C'est alors qu'il fit carrière retentissante de flûtiste ; mais, en lui, il y avait déjà des aspirations d'un ordre différent : la composition musicale et l'art de la direction d'orchestre.
Aux pupitres de la Société des Concerts du Conservatoire et à l'Opéra, tout en accomplissant à merveille sa tâche de première flûte, il observait avec la plus sérieuse attention la structure des multiples œuvres aux exécutions desquelles il prenait part, le « rendu, » orchestral de chacune d'elles. Insensiblement il s'assimila mille choses fort utiles qui devaient faire de lui l'artiste complet d'aujourd'hui. Il venait d'être nommé deuxième chef de la Société des Concerts lorsque là-guerre le prit. Trois années de front ! Verdun ! Nous savons qu'il revint avec la croix de guerre, ce qui atteste son courage. Une année après l'armistice, trois nominations d'importance firent immédiatement de Gaubert un personnage de tout premier plan dans les hautes sphères musicales de Paris : professeur au Conservatoire, premier chef d'orchestre de l'Opéra, chef d'orchestre de la Société des Concerts. Evidemment, après ce triple succès, il convenait d'honorer cette ascension rapide, et, pour ce faire, le Ministre des Beaux-Arts nomma notre musicien chevalier de la Légion d'honneur en 1921, puis officier tout récemment.
Le but de cette étude étant de pénétrer autant que faire se peut le compositeur, nous allons entretenir le lecteur de l'importance probablement insoupçonnée de ses œuvres. Nous laisserons de côté, avec regrets, le chef d'orchestre magnifique, un des premiers du monde, incontestablement. Si l'on songe aux multiples occupations qui, depuis de nombreuses années, submergent la vie de Gaubert, il y a lieu de s'étonner qu'il ait pu réaliser des œuvres ne sentant jamais la production hâtive, cela tient à la conscience de l'artiste, à l'impérieuse nécessité de chanter sincèrement les champs ensoleillés, la mer à la fois douce et terrible, les sentiments intimes du cœur. En ces pensées est le refuge de l'artiste. Il est légitime, pendant la période estivale, qu'il cherche à oublier les longs mois d'hiver vécus pour les autres, afin de magnifier leurs œuvres. Il se cherche alors à la clarté des deux, et dans un bel élan il atteint l'Idéal qu'il va concrétiser en des œuvres claires, pénétrantes. Nous allons voir de quelle manière et sous quelles formes.
Les œuvres les plus anciennes remontent à l'année 1908 (abstraction faite des travaux préparatoires et des cantates de Rome). Nous y trouvons une rapsodie pour orchestre : Dans la montagne. La caractéristique de cette oeuvre est la rudesse, la vigueur et la chaleur des teintes, une mélodie : Soir païen (avec flûte) marque déjà une date dans la manière très fine d'envelopper de vaporeuse musique les beaux vers de nos grands poètes français.
En 1910 : Poème pastoral en trois parties pour orchestre, exécuté chez Lamoureux sous la direction de Camille Chevillard. Ciel lumineux, telle, est la note dominante de ces pages.
Nous voici en 1911, année heureuse qui nous donna une des œuvres les plus marquantes : Le Cortège d'Amphitrite, poème symphonique pour orchestre, très connu. La pensée des poètes qui représentent la déesse de la mer se promenant sur les eaux, dans un char en forme de coquille, traîné par des chevaux marins, tenant à la main un sceptre d'or pour marquer son autorité sur les flots, est exprimée par le musicien supérieurement ; nous y retrouvons le sens aigu de la mer. L'orchestration est éblouissante, les timbres se fondent en de belles vagues sonores.
1912 fut une année de grand travail : c'est alors que Philotis, ballet grec en deux actes, fut conçu. Cette œuvre, évoquant l'antiquité en de subtiles danses puisées à une authentique source, fut prétexte, pour le musicien, à écrire une partition orchestrale d'une couleur singulière. L'Opéra monta Philotis qui obtint la faveur du public.
Avec l'année 1913, nous entrons dans la production intensifiée puisque nous relevons un épisode de la Révolution russe (1905) : Sonia, trois actes créés à Nantes avec grand succès. Ajoutons-y une œuvre devenue célèbre : Au jardin de l'Infante. L'un des huit lieder qui la composent, Il est d'étranges soirs, est orchestré. La justesse de touches, la pureté de la déclamation, l'ingéniosité de l'enveloppement du piano, unies à une intuition poétique en éveil, donnent à chacun de ces lieder un charme savoureux, j'en atteste. Nuit blanche, Il est d'étranges soirs, à la prosodie d'une étonnante légèreté, à la fluidité de la pensée et à la péroraison dramatique très vraie. L'Indifférent s'adapte avec fidélité à la poésie doucement pénétrante de Samain. Arpège, très orchestral, est un lied que l'on aimerait entendre dans un parc mystérieux baigné d'ombre. Hiver étreint les âmes sensibles. Il s'en dégage une réelle ; angoisse : « Monte, monte, ô mélancolie/ Lune des ciels, roses des défunts. » Musique sur l'eau, d'une ligne pure, aux harmonies précieuses, est chose adorable. J'ai rêvé d'un jardin primitif débute, en quintes ; la souplesse du milieu est manifeste et la conclusion saisissante. Enfin, Chanson d'été nous fait, comprendre l'amour du musicien pour la nature. Je tenais à insister sur ce recueil exquis. Signalons une Fantaisie pour clarinette et piano, parfaite d'écriture, de nombreuses pièces pour flûte, et harpe.
1914 ! Arrêt assez bref ! Mais en 1915, notre combattant trouve moyen d'écrire au front Aquarelles. Trois pièces de musique de chambre pour violon, violoncelle et piano qui sont comme une renaissance à la vie artistique, en dépit du drame inouï. C'est de cette époque que date aussi la caractéristique Sonate pour violon et piano, composée en majeure partie dans les tranchées, près- des Eparges. Au front également ont été composés deux petits chefs-d’œuvre : Soleils couchants, les Yeux.
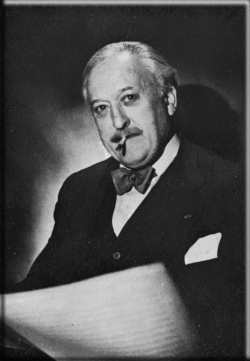 |
| Philippe Gaubert (photo Roger-Viollet) DR. |
1916 et 1917, le silence... Les combats !
En 1918 naît la Première Sonate pour flûte et piano. Cette œuvre chante avec douceur, à la clarté, d'un matin le retour aux possibilités de savourer la vie des champs en toute paix.
De 1919 à 1922, long travail de Naïla, œuvre maîtresse sur laquelle nous nous étendrons un peu, mais avant il convient de mentionner une légende pour orchestre, chœur et soli : Josiane, exécutée chez Colonne avec grand, succès.
Naïla ! Nous serions curieux de savoir la raison pour laquelle nous n'avons été gratifiés que d'un nombre parcimonieux de représentations de cette œuvre à l'Opéra ! C'était pourtant un spectacle infiniment attachant. Faut-il donc qu'automatiquement disparaissent de l'affiche les meilleures conceptions modernes, sans qu'il ait été possible de se les assimiler complètement ? On se souvient de ce conte oriental, des décors savoureux : une terrasse du palais, une grande salle à l'entrée du harem, la campagne, une cabane dans un jardin. Le premier acte, constitue une très poétique « exposition » de l’ouvrage, de construction magnifique. Les, appels à Mithra sont enveloppés de luxuriantes harmonies ! Louons au passage des richesses sonores de premier ordre, notamment : « Elle noue à mon col ses bras, d’ivoire… », plus loin : « Un jour Mithra, Dieu du soleil », aux accents d'une grande noblesse. La deuxième scène, au moment où paraît Naïla, une gerbe dans les bras, est émouvante : « Alors, dans la forêt voisine, je cueille des fleurs », frappe l'auditeur-musicien par de doux accents. Toute la partie qui enveloppe la fin de cette scène, bâtie sur un thème persan, met en relief la musicalité et la science orchestrale de l'auteur.
L'acte II débute par une superbe mélodie arabe exprimée par le cor anglais qui se détache sur un fond de harpes et des « dessous » d'orchestre d'une impalpabilité délicieuse. La fin du jour approche ; rapidement nous arrivons à un chœur de coulisse pour soprani et ténors : « Gaiement vers le soleil monte une folle nue ». Puis, reprise de cette mélodie arabe si prenante. Dans une atmosphère d'angoisse, Naïla, dont les cheveux flottent dénoués, subit la dureté du roi persan Rahman : elle doit de ses mains, suprême humiliation, attacher ses propres torsades aux chevilles de sa rivale triomphante, la favorite Féridjé. La musique exprime cette scène pénible avec une vérité émouvante. Pourquoi vivre ainsi, en de si dures circonstances ? Mieux vaut partir ! Mais, tout s'adoucit par la pitié du magicien des sons. Naïla va emporter sur son cœur un coffret contenant une fleur, une petite morte... La lune s'est levée ! la nature s'endort et veille sur la vérité de l'amour... Éternelle vérité, admirablement comprise, traduite au chant et à l'orchestre. C'est une vision anticipée du triomphe d'une âme cristalline sur la vanité, et les décevantes jouissances, d'ici-bas.
Avant que de passer à l'acte suivant, gardons-nous d'oublier, les Danses orientales, très rutilantes. Elles ont été jouées avec le plus vif succès, chez Colonne et à la Société des Concerts.
Dans l'acte III, un large sentiment de la nature s'exprime en un beau prélude. Naïla est enveloppée de mystère et n'espère plus rien sur terre ! Mais, tout à coup, Rahman arrive... Chez Naïla, réveil de l'âme, vibrations trop, fortes ! Chez lui, que de regrets lorsqu'il chante : « O misère des grands ! Oh ! Vivre simple ! ... » Le début de la troisième scène est fort émotionnant, car Naïla tient sur son cœur le coffret et s'adressant à la rose : « Dors ! Il ne faut jamais se réveiller ». Musique insondable. Et quel symbole ! Il va nous conduire à la fin de l'ouvrage. Hélas, l'union ne se fera pas sur terre !
Dans un sourire d'extase Naïla s'adresse au Dieu Mithra : « Dieu de lumière, Dieu d'amour ! ». Puis, c'est la mort, ou plutôt la vie... Toutes les nuances infinies de cet acte sont exprimées par la musique magnifiquement.
Au sentiment de la nature s'ajoute l'attendrissement, pour la souffrance humaine. Ce sont précisément ces deux grands leviers qui donnent aux pensées dé Philippe Gaubert, à sa musique, à son orchestre, une haute signification.
Et maintenant, pour donner une idée de la puissance de travail de ce maître, il ne faut pas oublier qu'entre temps à été créée la Fantaisie pour violon et orchestre dédiée à Jules Boucherit. Cette œuvre se joue fréquemment dans les grands centres musicaux. Elle fût exécutée en première audition par l'éminent dédicataire, chez Lamoureux.
Nous ne voyons rien en 1923.
Par contre, en 1924, la récolte a été fructueuse : une Deuxième Sonate pour flûte et piano, plus lumineuse encore que la première ; la création des Quatre Ballades de Paul Fort et de Fresques, petit ballet exquis représenté à l'Opéra. Les quatre ballades ont un relief très grand. Le départ du matelot a un grand caractère. Sur la mère au pâle soleil est un lied qui atteste une fois de plus la haute compréhension de la mer. S'ils gagnent la bataille est tout à fait XIIIe siècle ; les harmonies ont une réelle saveur évoquant cette époque. Enfin, Le ciel est gai, c'est joli mai est encore un hommage à la mer, mais à la mer douce comme une belle ligne de chant grégorien.
1925 a vu éclore un ballet inédit en deux tableaux : Le ballet de la rose que nous ignorons.
En 1926 : Esquisses pour violon et piano. C'est une belle suite contenant quatre parties variées. Extase nous transporte dans les régions sereines ; les harmonies sont subtiles, la « rentrée » adorable et la fin d'une joliesse accomplie. Voiles blanches au crépuscule, lied qui contient une montée aux savoureuses harmonies. Le tout forme un petit tableau brossé de main de maître. Une chasse au loin est fort pittoresque. Là-bas, très loin, sur la mer affirme à nouveau l'amour des flots. A la fin, on y trouve des enchaînements harmoniques de choix.
1927 nous a valu : Ballade pour flûte et piano dédiée à « ses élèves » ; elle porte la « marque de fabrique », selon la formule de Franck. Puis Trois Ballades de Paul Fort, aussi belles que celles dont j'ai parlé plus haut. L'une de ces ballades est orchestrée et a été chantée aux Concerts-Lamoureux. Les Trois Pièces pour violoncelle et piano : Lied, Menuet, Cortège peuvent être considérées comme un enrichissement de la musique moderne de violoncelle.
En 1928 : Les Stances. Œuvre également célèbre. (Poèmes de Jean Moréas) : Quand reviendra l'Automne est une page aux larges harmonies. Roses en bracelets est exprimé avec finesse. Belle lune d'argent témoigne d'un enveloppement poétique, la rentrée est un petit chef-d’œuvre. Quand je reviendrai m'asseoir recèle de belles choses. Dans le jeune et frais cimetière, œuvre s'apparentant aux mélodies de Schubert par un certain ton majeur, charme nos cœurs émus. Avril sourit, petite page délicate comme un fil d'or, se termine de manière colorée, tel un ciel nacré. Ah, Fuyez ! malheureuses pensées est une invocation à la nature. Toute la suite est orchestrée ; elle sera entendue ce mois-ci à la Société des Concerts, où la grande cantatrice Germaine Lubin saura la magnifier par son interprétation.
Le Concerto pour violon avec accompagnement d'orchestre sera exécuté prochainement chez Lamoureux et la Société des Concerts par Firmin Touche, l'éminent professeur au Conservatoire, et Merckel. L'œuvre est d'un seul tenant. Remarquons une chose neuve : à l'inverse de la lignée des concertos, le début de celui-ci ne comporte pas de tutti. Le soliste prend immédiatement la parole. Les quatre notes qu'il fait entendre vont devenir l'idée ascendante du premier mouvement. C'est fort curieux, attachant. Le Lied amené par un « pont » d'une simplicité voulue, est une page du premier ordre. La « soudure » qui relie au final reste dans l'atmosphère de grand calme, puis, soudain, éclate en pleine joie la troisième partie. La cadence qui veut n'en point être une a un charme qu'il convient d'apprécier hautement. Sous cette cadence, signalons un changement d'accord qui donne une impression atonale. Puis, c'est la résolution en une ligne virginale qui prend, insensiblement, la physionomie d'un lien qui ramène le thème initial du final. L'œuvre s'achève en pleine lumière.
Pour terminer cette étude, insistons sur : les Chants de la mer. Ce triptyque a frappé tous les musiciens et a été loué dans toute la presse. Voici donc l'aboutissement de la deuxième « manière » de Philippe Gaubert. Nous ne pouvons mieux faire que de citer quelques lignes écrites sur cette œuvre par M. Paul Bertrand en ce journal [Le Ménestrel], le 18 octobre dernier [1929] :
« L'auteur a traité ce triptyque avec une habileté rare. Son premier tableau, taillé en pleine pâte symphonique formée d'harmonies chatoyantes, est d'une sonorité pleine, somptueuse, frémissante. La ronde se déroule ensuite sous forme d'un scherzo de l'agrément le plus vif, et le troisième morceau témoigne d'une force d'évocation singulière, avec ses effets lointains de trompette et de cor en sourdine, se détachant sur la troublante pédale des cordes et auxquels succède une délicate touche de flûte suggérant le mystère de la nuit tombante ».
Cette belle œuvre a déjà été exécutée deux fois chez Colonne. Deux nouvelles auditions s'annoncent à la Société des Concerts et chez Poulet.
Philippe Gaubert ne s'arrêtera pas là. Nul doute qu'il ne s'emploie à porter de plus en plus haut ses pensées de poète, de musicien, vers les sommets peu explorés où tout est Paix et Lumière éternelles. Il est sur cette grande voie à jamais consolatrice.
(in Le Ménestrel, 13 décembre 1929)
PHILIPPE GAUBERT
vu par Louis Beydts en 1947
On dit de la reconnaissance qu’elle est un devoir. Je crois plutôt qu’elle est un plaisir, et le plus doux parce que le plus tenace, le plus profond parce que le plus réfléchi.
Le métier que, d’autre part, nous exerçons, nous, compositeurs, ne trouve pas de fin en soi. Que nous déployions du génie, que nous prodiguions du talent, que nous manifestions de l’habileté, et tout est encore à faire, car nous devons alors nous mettre en quête d’un virtuose ou d’un chanteur qui nous interprète, d’un théâtre qui nous représenta, d’un orchestre qui nous joue.
On parle parfois de l’égoïsme des artistes. Si quelqu’un ignore ce travers, c’est bien le chef d’orchestre. Certes, l’exécution des œuvres connues peut fournir une satisfaction à sa vanité. Cependant, comment ne serait-il pas désintéressé lorsqu’il se penche sur des pages encore ignorées, et qu’il dépense à leur bénéfice, son temps, sa patine et son prestige ?
Il arrive aussi parfois, qu’à ces tyranniques obligations, le professorat ajoute la longue chaîne de ses patients devoirs. A l’ardeur des jeunes volontés, aux promesses des intelligences inexpertes, le Maître vient mêler les bienfaits de son expérience ; il fait siennes les ambitions et les inquiétudes de ses disciples, il tremble ou se réjouit pour eux comme pour lui-même, il partage avec eux ce qu’il a de meilleur en lui.
Ces sentiments généreux, ces contraintes sans calcul consenties, Philippe Gaubert les a éprouvés, Philippe Gaubert s’y est soumis. Il n’est pas d’existence qui, plus complètement que la sienne, ait été vouée à la Musique.
A seize ans, il obtient le premier prix de flûte au Conservatoire de Paris, entrant peu après à l’orchestre de l’Opéra en même temps qu’il s’inscrit aux classes de composition. Le virtuose, partout applaudi, devient bientôt second chef à la Société des Concerts. La guerre éclate sans que lui soit épargné aucun des périls qu’elle entraîne. Puis voilà Philippe Gaubert, premier chef d’orchestre de la Société des Concerts, professeur de la classe de flûte au Conservatoire, directeur de la musique à l’Opéra et professeur de la classe d’orchestre.
Le travail seul le délasse du travail, et la liberté qui lui manque, pour édifier son œuvre personnelle, il la prend sur ses vacances, qu’il emploie à composer sans relâche. Entre temps, il voyage à la tête de son orchestre, à moins qu’il ne s’empresse de répondre aux invitations que lui adressent les Sociétés Symphoniques de province et de l’étranger. On se demande quand il aura vraiment connu le bienfait et le réconfort du loisir.
Cédant enfin aux vœux des siens, plus soucieux que lui-même de sa santé et de son repos, s’il abandonne la présidence de la Société des Concerts, c’est pour être nommé directeur de l’Opéra, où il se voit obligé de satisfaire à d’innombrables devoirs administratifs, sans cesser de monter au pupitre. Après l’armistice, il conduit les Concerts Pasdeloup. La Radio l’emploie, l’Opéra l’accapare, mais il trouve le temps — qu’il vole à son sommeil — d’écrire en quelques mois, un ballet aux proportions parfaites Le Chevalier et la Damoiselle, chef d’œuvre chorégraphique de ces trente dernières années, dont la création s’achève sur des clameurs d’apothéose.
Et le voilà, quelques jours après, terrassé inexplicablement par une mort brutale...
On aimerait s’attarder à considérer tous les aspects d’une œuvre aussi abondante, aussi variée, aussi accomplie que celle de Philippe Gaubert, musique de chambre, mélodie, poème symphonique, opéra, tous les genres l’ont tenté, et, dans chacun d’eux, il a atteint la réussite absolue. Cependant, toutes ses qualités, tous ses dons se sont épanouis sous une forme idéale, le ballet. A ce musicien épris de la vie, à ce tempérament généreux, la danse apportait un élément providentiel d’inspiration, et jamais, sans doute, il n’aura connu une fortune plus complète que dans sa dernière œuvre, Le Chevalier et la Damoiselle, dont la réalisation plastique s’affirma, en outre, comme un miracle de somptuosité, d’invention et de goût. Puisse le délicat enchantement s’en ranimer bientôt !
Que ne nous réservait encore un tel musicien, s’il avait vécu la longue existence qui lui semblait promise, et qu’une ineffable tendresse parfumait des plus pénétrantes délices ! Car, quelque importante que demeure l’œuvre édifiée par Philippe Gaubert, son destin nous apparaît comme inaccompli et sa place reste vide. Comme il reviendrait vite parmi nous, cependant, si la chaleur des larmes pouvait rendre la vie !
Retenons son exemple et restons fidèles à son souvenir ; nous ne serons jamais aussi attachés à Philippe Gaubert qu’il nous fut prodigue de son cœur et de son talent.
(in Revue musicale de France, n° 12, octobre 1947)
![]() Philippe Gaubert, Soir d’Automne, dédicacée “à Madame Fr. Melays”, n° 2 des Trois aquarelles, trios pour piano, violon ou flûte et violoncelle (Paris, Editions Maxime Jamin, 1921). Fichier audio par Max Méreaux (DR.)
Philippe Gaubert, Soir d’Automne, dédicacée “à Madame Fr. Melays”, n° 2 des Trois aquarelles, trios pour piano, violon ou flûte et violoncelle (Paris, Editions Maxime Jamin, 1921). Fichier audio par Max Méreaux (DR.)
![]() La Bibliothèque nationale du Québec propose en
ligne plusieurs enregistrements sonores de compositions de Philippe
Gaubert : résultats de recherche.
La Bibliothèque nationale du Québec propose en
ligne plusieurs enregistrements sonores de compositions de Philippe
Gaubert : résultats de recherche.
1906
 |
| Louis Dumas, vers 1910 (photo Pirou/Musica 1912) DR. |
Fils de Gustave Dumas, professeur au Lycée de Vanves, professeur de l’Université, et de Claire Roger, Louis, Charles Dumas est né le 24 décembre 1877 dans le quinzième arrondissement parisien, au sein d’une famille où la musique est à l’honneur : sa mère est professeur de piano et bonne chanteuse amateur, sa grand-mère maternelle née Cécile Bizot (1833-1919), dotée d’une fort belle voix chante également et ses parents François Bizot (1801-1858) et Marie Jeanne Martin (1807-1890) ont tous deux fait carrière dans la musique comme chanteurs et professeurs de chant ; François Bizot a notamment créé le rôle du Comte Almaviva dans la traduction française (par Castil-Blaze) du Barbier de Séville de Rossini le 6 mai 1824 à l’Odéon de Paris.
La littérature et la poésie sont aussi vénérées dans ce milieu : son oncle Léon Roger (1859-1928), homme de lettres, poète et critique d’art, connu sous le nom de Roger-Milès, est un temps directeur du Figaro Illustré, et son frère Charles Dumas, né en 1881 et « mort pour la France » le 31 octobre 1914, est un poète dont la carrière sera brutalement interrompue à l’âge de 33 ans, tué sur le champ de bataille d’une balle qui lui traverse la carotide. Poète d’une sensibilité délicieuse », celui-ci avait déjà obtenu quelques succès auprès des lettrés avec 2 recueils de vers remarquables : L’Eau souterraine, prix Sully Prudhomme (Paris, P. Ollendorf, 1903) et L’Ombre et les proies (Paris, P. Ollendorf, 1906) et un poème dramatique en un prologue et 3 parties intitulé Stellus (Paris, Lemaire, 1916) dont la musique de scène sera composée plus tard par son frère Louis qui va le créer au Grand Théâtre de Dijon le 17 février 1944.
Dans un tel milieu où on pratique ainsi la musique, en même temps que des études au Lycée Michelet de Vanves, là même où le musicologue et philosophe Paul Landormy (1869-1943) et l’écrivain normalien Romain Rolland (1866-1944) firent leurs études secondaires, Louis Dumas prend des leçons d’harmonie auprès de Jules Bouval, ancien lauréat du Prix de Rome et organiste de Saint-Pierre de Chaillot. Son bac ès lettres obtenu, il rejoint bientôt le Conservatoire de Paris. Tout d’abord auditeur dans une classe de violoncelle, il entre ensuite élève dans les classes de contrepoint et fugue de Georges Caussade, d’harmonie de Xavier Leroux (2ème accessit en 1897 puis 1er prix en 1901) et de composition de Charles Lenepveu (1er prix en 1905).
En 1905, il concourt pour le prix de Rome avec la cantate Maïa (paroles de Fernand Beissier) qui lui vaut un deuxième second Grand Prix. Se présentant à nouveau l’année suivante avec la cantate Ismaïl (paroles d’Eugène Adonis), il décroche cette fois le premier Grand Prix. Jean d’Udine (pseudonyme du compositeur Albert Cozanet) ayant assisté à Paris à l’exécution de cette scène lyrique en novembre 1906 écrit : « … il y a des endroits heureux, notamment une marche de caravane dont l’air se meurt au loin sous les paroles d’un duo assez dramatique. Le tout est d’un musicien délicat et ordonné… ».
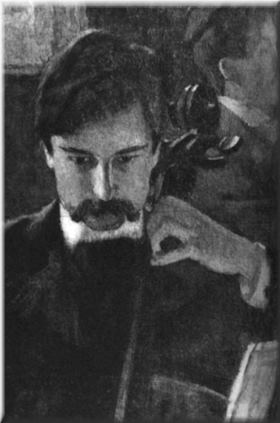 |
| Louis Dumas peint par son camarade de promotion de la section peinture Georges Leroux, vers 1908 (DR.) |
C’est alors le traditionnel séjour à la Villa Médicis qu’il effectue de janvier 1907 à décembre 1910. Durant cette période à Rome il compose plusieurs œuvres imposées par le règlement ; (1ère année, 1907) : un Quatuor à cordes en mi majeur en 4 parties, dédié au violoncelliste Raymond Marthe, interprété en mai 1908 à la Société Nationale par MM. Chailley, Gravand, Jurgensen et Schidenhelm, « contient d’excellentes pages, pleines de forte originalité » et des Mélodies avec accompagnement de piano ou d’orchestre parmi lesquelles Sur une tombe (paroles de son oncle Roger-Milès), Mon rêve familier (Paul Verlaine) dédié « à Charles Dumas », Des fleurs (paroles de son frère Charles) ; (2ème année, 1908) : une Symphonie romaine en 4 parties et une scène lyrique Laure et Pétrarque ; (3ème année, 1909) : l’Ouverture du drame Stellus et une Fantaisie pour piano et orchestre, (4ème année, 1910) : un conte lyrique en 4 actes Le Médecin de Salerne. Egalement à mentionner parmi ses envois de Rome La Chanson de l’amour (poésie d’André Rivoire), chœur pour voix de femmes avec accompagnement de piano, qui est exécutée le 21 décembre 1911 à la salle de la rue Bergère par l’Orchestre de l’Opéra et les Chœurs du Conservatoire dirigés par Henri Büsser lors d’une séance consacrée aux envois de Rome de l’auteur. C’est durant ce séjour à la Villa que le peintre Georges Leroux (1877-1967), premier Grand Prix de Rome de peinture la même année que lui, peint son portrait jouant du violoncelle.
Sur son Quatuor René Dumesnil écrira plus tard en 1949 : « … [il] sait allier la solidité d’une forme classique à une hardiesse de bon aloi dans ses compositions symphoniques, ou dans ses œuvres de musique de chambre. Son Quatuor à cordes est d’un beau sentiment poétique » et Jules Combarieu en 1923 « … œuvre pleine de poésie, où la forme classique soutient des harmonies délicates et hardies qui le rattacheraient à l‘école avancée. » Quant à l’Ouverture de Stellus, elle est notamment jouée en direct à la radio le 19 mai 1946 à 17h30 par Jean Clergue à la tête de l’Orchestre symphonique de la radio. En commentaire on peut lire : « … s’inspire d’un texte de Charles Dumas, qui porte ce titre. Le compositeur cherche à fixer les traits du héros, le chimérique et jeune prince Stellus dont l’âme également éprise d’action et de rêve agonise en proie à ce dualisme qui est comme son essence et sa loi ».
La composition, il l’avait déjà pratiquée lors de ses études au Conservatoire. On lui connaît en effet durant cette période plusieurs pages de musique de chambre et des mélodies éditées : Romance en sol, pour flûte avec accompagnement de piano (Paris, A. Quinzard, 1899), Barcarolle, pour piano, op. 2 (Paris, A. Leduc, 1903), Lamento, pour violoncelle ou alto avec accompagnement de piano (id.), Romance, pour violon, violoncelle avec accompagnement de piano (id.), Chanson d’automne, pour une voix et piano, poésie de Jean Lorrain (Paris, Leduc, 1904), Chanson d’avril, poésie de Jean Lorrain (id.), Romance pour orchestre (id.), Soupir, pour une voix et piano, poésie de Sully Prudhomme (id.), Sonate pour violon et piano en ré mineur, op. 8 (Leduc, 1906).
Avant son départ de Rome, au cours de ses études au Conservatoire il avait intégré comme violoncelliste le « Quatuor Luquin » où on le trouve en 1903 et 1904 aux côtés de Fernand Luquin (violon), Henri Dumont (second violon) et Alexandre Roelens (alto). Cette formation qui se produisait en concert, notamment salle Erard, participait également aux conférences musicales de Paul Landormy à l’Ecole des Hautes Etudes Sociales, présidées par Romain Rolland. A son retour à Paris en 1911, alors domicilié 34 rue Lecourbe et jusqu’à la déclaration de guerre il participe encore à des séances de musique avec le « Quatuor Luquin » ou avec d’autres partenaires, entre autres, en 1913 le violoniste Oberdoerffer. Mais, déjà en 1897, il se produisaitt en public avec son instrument, entre autres le 23 octobre dans un concert organisé par l’« Union Chrétienne de Jeunes gens » au cours duquel il interprétait la Tarentelle op. 33 pour violoncelle de David Popper. La même année, le 8 décembre, au Théâtre d’Application (la Bodinière) de la rue Saint-Lazare, il était applaudi dans un concert donné par l’« Association amicale des élèves de l’Union française de la jeunesse » ; le 24 février 1898, c’est au Vésinet (Yvelines) qu’il se trouvait avec son violoncelle dans un concert offert aux convalescentes de l’Asile National et le 10 mai de cette année participait au vingt-huitième concert donné à la salle Charras, située dans le neuvième arrondissement parisien, au profit de l’hôpital homéopathique Hahnemann.
 |
 |
| Neige pour piano (in Album Musica, éditeur P. Lafitte et Cie, 1909) |
Pièce en mi majeur pour orgue ou harmonium (in J. Joubert, Les Maîtres contemporains de l'orgue, Sénart,1911) |
A son retour en France plusieurs de ses oeuvres sont publiées par l’éditeur parisien Pierre Lafitte et Cie de l’ avenue de l’Opéra, dans les Album Musica : Neige pour piano, dédiée « à André Salomon » (n° 87, 1909), Les Stalactites, chant et piano (n° 105, juin 1911), Elégie pour violoncelle et piano (n° 112, janvier 1912), Berceuse pour violon et piano (n° 126, 1913) et par les Editions Maurice Sénart : Impromptu pour piano en mi bémol majeur, dédié « à Maurice Le Boucher » (1913). Une page pour orgue, sans doute la seule pour cet instrument qu’il a écrite, intitulée Pièce en mi majeur, est aussi éditée par Joseph Joubert dans Les Maîtres contemporains de l’orgue (1er volume, 1911, Paris, Sénart).
Rappelé aux armées le 4 août 1914, sergent au 30ème Régiment territorial d’infanterie puis au 73ème, il participe à la campagne contre l’Allemagne jusqu’au 11 février 1919, date de sa libération, se retirant alors rue Lecourbe. Le 27 février 1916, il est cité à l’ordre du régiment : « Adjoint au Major des tranchées, s’acquitte avec une bravoure qui touche à la témérité de reconnaissances dangereuses. Toujours sur la brèche et prêt à tout dévouement » et est décoré de la Croix de guerre avec étoile de bronze. Pendant la guerre, il compose des chants : La Plainte du village, pour ténor solo, ténor et basse, Chant de Noël pour les enfants des soldats, pour mezzo solo, soprano, ténor et basse ; ces deux chants écrits au front, le premier, en juillet 1915 à Elverdinghe (Belgique), le second, en décembre de la même année, à Westvleteren (Belgique) sur des poésies de Fernand Bontron, sous-lieutenant au 73ème Territorial, où lui-même est affecté à cette époque, sont exécutés le dimanche 17 juin 1917, salle des Concerts du Conservatoire à Paris, par Jean d’Arral (ténor solo), Honoré Snell (ténor), Charles Mahieux (basse), Hélène Duvernay (mezzo), Mme Outhier (soprano) et Marguerite Willemin au piano.
Quelques mois après son retour dans la vie civile, Louis Dumas est nommé le 1er mai 1919 directeur du Conservatoire de Dijon, poste qu’il va occuper durant 33 années. Il succède là à Félix Vendeur, professeur de flûte né en 1856 à Nîmes, décédé subitement le 8 avril 1918 qui lui-même avait pris la suite l’année précédente d’Adolphe Dietrich nommé en 1914 et également mort subitement le 28 décembre 1916. Ancien élève de l’Ecole Niedermeyer, organiste à Narbonne, puis à partir de 1872 à Dijon (Saint-Michel), Dietrich avait recueilli dans ce Conservatoire la succession de Jean-Baptiste Lévêque, démissionnaire en janvier 1914 après une longue carrière de 36 années dans cet établissement. On doit notamment à Louis Dumas, à l’image du Conservatoire de Paris, la fondation à Dijon en 1927 d’un Théâtre d’Application pour permettre aux élèves ou anciens élèves de son établissement de se produire en public : la première séance eut lieu le 8 novembre avec le concours des classes de musique, chant et déclamation.
 |
| Louis Dumas (DR.) |
Menant de front ses fonctions de direction de conservatoire où il enseigne aussi l’harmonie, et de chef d’orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire de Dijon, il n’abandonne pas pour autant la composition, augmentant son catalogue de nombreuses œuvres nouvelles parmi lesquelles on peut citer de la musique concertante : Rhapsodie pour violoncelle et orchestre et version pour violoncelle et piano (Deiss, 1926) ; de la musique de chambre : Quatuor pour 3 cordes et piano (1931), 2 Sonates pour violon et piano et une pour violoncelle et piano (1935), Rhapsodie pour violoncelle et piano (1926, Deiss), Trio pour piano, violon et violoncelle, Barcarolle, pour piano et violon solo, violoncelle et contrebasse ad libitum (1929, Leduc), Pavane sentimentale pour quatuor à cordes (1930) ; des pièces pour un instrument seul : En Sous-bois et Fétiche de Gassin pour guitare (Leduc), Nocturne pour piano, op. 33 (Sénart, 1922), Thème et Variation pour piano (Editions Musicales Transatlantiques) ; une légende lyrique en 2 actes : La Vision de Mona, livret de Desuaux-Verité et Jean Fragerolle, dont « l’action est d’un caractère âpre, dur et triste, presque désespéré » (représentée pour la 1ère fois le 15 octobre 1931 à l’Opéra de Paris) ; une Messe pour soli, chœur, orgue et orchestre et plusieurs mélodies pour voix et piano : Soir et L’Ephémère, poésies de Marcel Legrand (1924, Sénard), Invocation, poésie de Henri de Régnier (1925, Deiss), Tristesse d’aimer, poésie de Roger-Milès (1925, Eschig), Les Vêpres sonnent, poésie de Louis Mercier (1925, Deiss), Buis bénit, poésie de Henri Allorgue (1926, Deiss), Le Baiser volé, poésie de Henri Allorgue (1928, Deiss), Green, poésie de Paul Verlaine (1929, Evette). Mentionnons aussi le chœur à 4 voix mixtes A Cassandre, musique de scène pour le drame Aux jardins de Ronsard de son fils René-Louis Dumas (H. Lemoine) et un opéra resté inédit Selma.
Chevalier de la Légion d’honneur (1931), Officier de l’Instruction publique, Louis Dumas est décédé le 8 mai 1952 à Dijon et ses obsèques célébrées le 10 mai en l’église Saint-Michel. Marié en 1919 à Louise Rossi, née en 1881, alors veuve en premières noces du Capitaine d’infanterie Xavier Heym mort au champ d’honneur le 27 août 1915 à Marcheville (Meuse) à l’âge de 37 ans, celle-ci décédait à l’âge de 56 ans le 14 novembre 1937. D’une précédente union, Louis Dumas avait eu un fils : René-Louis Dumas, né le 20 février 1902 à Paris, mort le 26 juin 1976 au Mesnil-Saint-Denis. Avocat à la Cour de Paris, René avait aussi quelque goût pour les lettres et c’est ainsi qu’on lui doit un roman Myrio, 2 recueils de vers : Le Jongleur (Paris, Aux Editions Internationales, 1935) et La boutique bleue (Paris, Edition Cahiers d’art et d’amitié, 1942), le drame en 4 actes Aux Jardins de Ronsard, (Prix Paul Hervieu de l’Académie française, 1952) écrit en 1942 et créé le 8 octobre 1946 au Grand Théâtre de Dijon par la Compagnie d’art dramatique de l’acteur et artiste lyrique Léon Rappeneau avec ballet, chœur et orchestre et une musique de scène de son père. Celle-ci comporte une introduction, quatre danses du XVIe siècle, un morceau d’orchestre, un chœur écrit sur un psaume de Clément Marot et un quatuor vocal composé sur le célèbre poème de Ronsard A Cassandre. Signalons encore une pièce en un acte Prêtez-moi votre fils (1974).
 |
| La Bourgogne républicaine , 10 mai 1952 (DR.) |
En guise de conclusion, laissons la parole à Gabriel Bender qui écrivait au moment du décès de Louis Dumas ces quelques lignes d’hommage : « … la modestie de Louis Dumas et son éloignement de Paris, de ce Paris qui fait et défait les réputations, ne lui ont pas permis d’occuper la place de premier plan à laquelle il avait droit. Il partage ainsi le sort d’un Ropartz, d’un Ladmirault, d’un Bachelet, d’un Mariotte, d’un Larmanjat, d’autres encore. Hormis ses deux actes La Vision de Mona, représentés à l’Opéra en octobre 1931, Paris ne connaît guère de Louis Dumas que quelques mélodies, quelques pièces instrumentales ou de musique de chambre données de-ci de-là. Mais la personnalité si sympathique de ce grand éducateur, de ce grand compositeur aussi, demeure en toute sa musique dont Paul Landormy disait qu’elle est « simple et directe, ardente, colorée, poétique, comme tout ce qu’il a composé... »
Quant à l’homme, « il était l’affabilité même. Sa courtoisie, sa simplicité, l’espèce de rayonnement qu’il dégageait, forçaient irrésistiblement la sympathie », ainsi pouvait-on lire en 1952 dans le quotidien La Bourgogne Républicaine.
Denis Havard de la Montagne
(juin 2024)
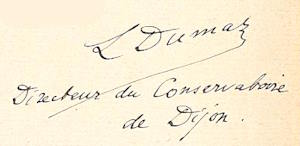 |
| Signature autographe, septembre 1931 (DR.) |
1907
Maurice LE BOUCHER (1882-1964)
 |
|
Grand Prix de Rome 1907, professeur à l'Ecole Niedermeyer, organiste de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois (1913-1920), directeur du Conservatoire de Montpellier durant 26 ans. ( Le Monde musical, n° 13, juillet 1907 ) |
Quelques œuvres de Maurice Le Boucher vues par le journal musical Le Ménestrel
Petite revue d'articles relatifs à des œuvres de ce compositeur, Premier Grand Prix de Rome.
« Nous avons eu dans la salle du Conservatoire, le 19 décembre, l'audition annuelle des envois de Rome, consacrée cette fois aux oeuvres de M. Maurice Le Boucher, grand prix de 1907. Le programme de la séance s'ouvrait par deux morceaux symphoniques intitulés les Heures antiques ; le premier, Au Bois sacré, est une sorte de pastorale où dominent la flûte et le hautbois, d'une couleur agréable et qui se termine d'une façon mystérieuse ; le second, la Danse des Faunes, commence par une introduction à trois temps, que suit bientôt une danse bien rythmée qui ne manque ni de lumière ni d'éclat. Mme Mellot-Joubert est venue nous faire entendre ensuite, avec son style souple et plein de grâce, une série de vieux airs de Gustave Lambert, le beau-père de Lully, si célèbre au dix-septième siècle par ses chants et sa façon de les interpréter, et que Boileau lui-même n'a pas dédaigné d'illustrer. La bibliothèque de l'Arsenal possède un recueil manuscrit d'airs de Michel-Lambert qui n'ont jamais été publiés. Ce sont des airs (de simples couplets) que M. Le Boucher a « reconstitués », au dire du programme, en y joignant un accompagnement de clavecin, quinton, viole d'amour, viole de gambe et basse de viole (instruments tenus par Mme Patorni, M. Casadesus, Mlle Schreiber, M. de Bruyn et M. Devilliers). Ce sont là des sortes de petits pastels musicaux, aux couleurs un peu passées, mais d'un charme discret, et auxquels leur accompagnement ingénieux rend un peu de relief. Le contraste était complet entre cette musique aux contours arrondis et la sonate en si mineur pour piano et violon que MM. Lazare Lévy et Georges Enesco ont ensuite exécutée. Cette sonate est divisée en deux parties, dont la première comprenant deux morceaux reliés entre eux (Allegro moderato— Largo), et la seconde trois morceaux s'enchaînant de même (Allegro scherzando — Andante espressivo — Agitato molto). L'oeuvre est intéressante quoique manquant d'originalité, et l'on y voudrait surtout une inspiration plus fraîche et plus généreuse. Ce qu'elle me paraît offrir de meilleur, c'est l'Allégro scherzando, qui est assez singulier, et l'Agitato molto, qui ne manque pas de chaleur. La séance se terminait par trois Répons pour choeur, orchestre et orgue, tirés des Lamentations de Jérémie, musique assez ample et d'une bonne sonorité. En résumé, ce qui fait un peu défaut dans tout ce programme, c'est le tempérament, c'est la personnalité. Tout cela est intéressant, mais sans grand relief et un peu court d'inspiration. Attendons M. Le Boucher à une oeuvre importante. A. P.
(28 décembre 1912, p. 413)
« Société Musicale Indépendante — Ce fut une très heureuse initiative que de nous réserver, au concert donné le 7 janvier à la salle des Agriculteurs, la primeur d'une oeuvre importante : Le Roi d'un Jour dont le poème est de M. Georges Chennevière et la musique de M. Maurice Le Boucher, le distingué directeur du Conservatoire de Montpellier. C'est un cycle de vingt poèmes chantés n'empruntant rien à la légende ni à l'histoire, évoquant au contraire, sous la forme la plus volontairement dépouillée, une aventure simple, familière : celle d'un inconnu qui entre par hasard dans une pauvre maison, rend à deux vieillards quelque chose de leur lointaine jeunesse, secoue la torpeur d'un village, éveille au coeur d'une fillette un amour qu'elle n'ose avouer et repart comme il est venu, laissant derrière lui un reflet d'espérance qu'éclaire le prisme du souvenir.
Le texte délicieux de M. Chennevière fait curieusement usage de mètres variés, maniés avec une étonnante souplesse, mais toujours coulés dans le moule de la strophe qui donne plus d'unité à l'ensemble et plus d'autorité au texte versifié. M. Maurice Le Boucher a su renforcer ce texte en en prolongeant l'écho, créer l'atmosphère et dégager l'émotion par des moyens simples et des accents justes, en témoignant d'un sentiment très délicat, très pénétrant, exprimé dans une langue musicale élégante, mesurée et discrète. Aucun parti pris de chapelle : l'auteur use aussi bien, selon les besoins suggérés par le texte littéraire, d'un style traditionnel, presque scolastique, comme dans le Prélude fugué que d'un modernisme savoureux comme dans Nocturne. Il fait preuve tour à tour d'une frappante originalité, rythmique dans Gaspard, d'un sens pittoresque dans On frappe, Aube ou En passant, d'une piquante intention drolatique avec le Roi Pépin.
Mme Mellot-Le Boucher, qu'on n'avait pas entendue à Paris depuis assez longtemps, reste la remarquable artiste que nous avons si souvent applaudie, possédant toujours autant de sûreté vocale que d'intelligente et fine sensibilité. Le Quatuor Bastide a accompagné avec un art accompli ces vingt jolis poèmes, secondé par l'auteur, qui tenait excellemment le piano. P.B. »
(16 janvier 1925, p. 28-29).
 |
| Ecole Niedermeyer, classe d'orgue d'Eugène Gigout en 1903 : Maurice Linglin au centre, de face, Eugène Gigout debout, 2ème en partant de la gauche. Maurice Le Boucher à la console de l'orgue. (photo in Musica, N° 10, 1903) DR. |
 |
| Maurice Le Boucher en 1907 (Le Petit Journal, 30 juin 1907) DR. |
« Académie Nationale de Musique. — La Duchesse de Padoue, action dramatique en deux actes, d'après le drame d'Oscar WILDE, livret de Paul GROSFILS, musique de Maurice LE BOUCHER. — […] Les biographes d'Oscar Wilde s'accordent à juger la Duchesse de Padoue comme la plus faible de ses productions de théâtre. On les en croit sans peine. En 1883, son premier essai : Vera ou les Nihilistes, venait d'être fort mal reçu. Dans le vain espoir de conquérir, cette fois, le succès, il se hâta de brocher un gros mélodrame, dont l'action est tissue d'inconséquences, les personnages dépourvus de caractère, et les accessoires pittoresques, les scènes de comparses, l'évocation du décor, inutilement démesurés. […]
Et je trouve beaucoup de mérite à M. Maurice Le Boucher de leur avoir créé une sorte d'ambiance musicale et pittoresque, d'en avoir souligné avec quelque force les moments essentiels, - d'avoir donné une apparence de vie à ces fantoches : Où il n'y a que du bavardage inutile, l'inspiration peut-elle naître ? On ne peut que relever le texte par la fermeté de la déclamation et des effets d'orchestre largement brossés. Le musicien n'y a pas manqué. »
(23 octobre 1931, p. 439-440)
« Comme première audition nous avions un curieux Fox-Trot de M. Maurice Le Boucher... fox-trot écrit en l'honneur de toutes les jeunesses du monde. Pour contribuer au rapprochement des peuples, à l'établissement d'une amitié entre tous les étudiants de la terre (Si tous les gars du monde voulaient s'donner la main...). Ce fox-trot, espérons qu'on ne le dansera pas sur de nouveaux champs de bataille. Il test écrit, on le sent dès les premières mesures, par un musicien accompli. L'orchestration en est très habile mais eût, je pense, gagné à tenir compte davantage des prodigieuses ressources du jazz. Au milieu, un très joli motif langoureux, qui sent la terre d'Espagne, s'intercale comme un rêve, et puis le rythme du fox-trot reprend vigoureusement et Jeunesse du Monde s'achève dans la lumière. »
(31 mars 1933, p. 133)
« Concours du Conservatoire.
Trompette. Les dix élèves de l'excellente classe de M. Vignal ne semblent pas avoir été très favorisés cette année par le morceau de concours (Scherzo appassionato de M. Maurice Le Boucher) assez ingrat et suscitant parfois brusquement, dans l'aigu, des sonorités criardes qui rompent le charme de cette voix héroïque et dont fort peu de concurrents ont réussi à atténuer le caractère déplaisant. »
(22 juin 1934, p. 232)
« Concours du Conservatoire.
Flûte. Le morceau de concours : Ode à Marsyas de M. Maurice Le Boucher, est écrit pour que l'instrumentiste puisse chanter à son aise et déployer toutes ses ressources de légèreté et de finesse. Si les concurrents n'en firent pas toujours ressortir la fantaisie chaleureuse, chacun sut montrer une sonorité égale et un acquis sûr. Rendons grâce à M. Moyse d'être aussi habile pédagogue que talentueux artiste. » (19 juin 1936, p. 200)
Collecte : Olivier Geoffroy
(novembre 2021)
1908
 |
|
( photo Philippe Hutin, 1907, Musica, coll. DHM ) DR. |
(in Comoedia, 1908)
Ayant le grand bonheur d'avoir connu, dès la première heure, le triomphateur d'aujourd'hui, je saisis avec joie l'occasion d'un succès dont je ne suis pas seul à me réjouir, pour présenter, en quelques mots, au grand public, le nouveau grand prix de Rome de composition musicale.
Né le 29 juin 1885 [à Paris], André Gailhard manifesta de tout temps de précoces dispositions musicales. Fils de M. Pedro Gailhard, dont il reçut, durant les premières années de son enfance, les meilleurs conseils et les plus tendres encouragements, il connut donc l'heureuse influence d'un milieu essentiellement musical.
Après avoir travaillé tout d'abord, sous la direction autorisée de Paul Vidal, le jeune musicien entra en 1900 dans la classe de Xavier Leroux. Il y puisa le sentiment exact de la technique exigée par l'art musical moderne. Comme tant d'autres prix de Rome déjà, André Gailhard fait honneur à l'enseignement du maître.
Sous les auspices de M. Charles Lenepveu et de M. Georges Caussade, André Gailhard connaît les douceurs de la fugue et du contrepoint. Son concours de première année lui vaut un second prix de fugue ; l'année suivante, un premier prix de fugue et le second grand prix de Rome font concevoir les meilleurs espoirs au sujet du jeune compositeur. Moins chanceux en 1907, André Gailhard peut oublier aujourd'hui cette déception d'une heure, puisque d'une manière éclatante, il a définitivement triomphé.
Les travaux scholastiques n'ont point exclusivement absorbé le musicien. Il est l'auteur d'un assez grand nombre de mélodies charmantes et de deux ouvrages plus sérieux : L'Aragonaise et Amaryllis. Le premier, ballet coloré et d'une facture élégante, fut joué par Mme Otero et promené par elle dans les principaux centres d'Europe ; le second, délicieux conte lyrique, connut un succès persistant au Théâtre de la Monnaie, à Bruxelles, et sur les scènes de Bordeaux, de Pau et de Toulouse.
Nature généreuse et claire, aux caractéristiques nettement françaises, André Gailhard joint aux dons les plus enviables, une connaissance approfondie de son art. Il est un musicien de cœur et de métier. Il est aussi un être éminemment sympathique dont on recherche la franche et cordiale amitié. On ne peut donc qu'espérer pour lui des succès très prochains que son talent rend légitimes et que son caractère fait souhaitables.
Louis Vuillemin
*
 |
| André Gailhard, vers 1912 ( Musica, 1913, coll. DHM ) DR. |
L'Académie des Beaux-Arts se réunissait hier, dans la grande salle de l'Institut, pour entendre et juger les cantates des jeunes compositeurs, candidats au prix de Rome, M. Luc Olivier-Merson présidait et M. Henri Roujon, secrétaire perpétuel, l'assistait. L'audition provisoire du Conservatoire avait eu lieu la veille, avec le plus absolu secret — pas si absolu cependant que la rumeur n'ait transpiré de la faveur qui avait accueilli l'oeuvre de M. André Gailhard.
La séance d'hier a vivement intéressé. Presque toutes les cantates témoignaient d'un effort sinon d'un talent déjà personnel, et quelques-unes étaient remarquables. L'absence heureuse en résultait de cette monotonie qui plane sur les auditions de ce genre. Il convient de reconnaître que les compositeurs ont été singulièrement aidés, cette fois par le livret, littéraire et ingénieux, de MM. Adenis et Desvaux-Vérité.
L'action se passe en Bretagne. Anne-Marie déplore l'absence de son fiancé, le marin Jann, et soupire, aurait dit Népomucène Lemercier, après son retour. Elle invoque la protection de la Dame de la Mer : la Sirène, qui, touchée par les larmes de la jeune fille. lui promet le retour, prochain de son fiancé. Mais elle exige, en retour, d'Anne-Marie, le serment de lui rendre Jann quand elle l'ordonnera.
Le marin est de retour et la joie des transports retrouvés rend les deux amants oublieux de la promesse qui enchaîne leur avenir. La Sirène réclame sa proie Anne-Marie tente une lutte inégale. Sa tendresse pour, Jann ne réussit pas à fléchir, la rigueur de la Sirène, qui triomphe et entraîne le marin.
Il y avait là matière à des développements musicaux très dramatiques et l'occasion était belle aux natures de théâtre de se manifester. Il est certain qu'à ce point de vue, la cantate de M. André Gailhard, qui a obtenu le prix de Rome, s'imposait incontestablement. Tous les dons dramatiques du jeune compositeur s'y manifestèrent : de la vigueur, de la flamme, un sens très sûr des situations et des caractères — toutes ces qualités, mises en valeur par la technique rigoureuse d'un harmoniste distingué.
L'Institut, par 18 voix, a ratifié le jugement déjà prononcé par une salle favorable. Cette décision n'a pas été prise cependant sans discussion, puisque neuf voix se sont portées sur le nom de M. Mazellier. Son œuvre, très distinguée aussi, est d'une inspiration absolument différente. Il y règne un sentiment poétique très délicat, et il s'en dégage une grande impression de douceur et de tendresse générales. L'écriture est adroite et artiste. M. Mazellier est déjà un musicien accompli. Mais sa nature est autre que celle de M. Gailhard, de qui 1 inspiration, plus appropriée au sujet, a triomphé.
Et, rançon inévitable des sentiments opposés que le jugement de l'Institut devait inspirer aux deux grands rivaux, qui sont aussi deux grands amis, la joie de l'un devait nécessairement entraîner l'amertume de l'autre; mais cette pensée doit donner courage à celui-ci, que son œuvre n'a été discutée que pour ses titres à la plus haute récompense.
Ces deux cantates ont été parfaitement interprétées : Mlle Grandjean, Mme Guiraudon-Cain, M. Muratore, et, au piano, MM. Léon Moreau et Salomon, ont fidèlement traduit la pensée de M. Mazellier. Mais je veux louer particulièrement les interprètes de l'œuvre de M. André Gaihard : Mlle Chenal et Mlle Verlet, admirables cantatrices ; M. Devriès, artiste éprouvé, et ces excellents musiciens MM. Chadeigne et Maxime Dardignac. Dans un élan reconnaissant et spontané, M. André Gailhard leur a attribué tout le mérite de son triomphe. En vérité, je pense que c'était là une charmante exagération.
Un second grand prix a été attribué à Mlle Nadia Boulanger, de qui la cantate, très musicale, abonde en heureuses inventions harmoniques, et bien que presque exclusivement symphonique dénote une vive intelligence du texte. Mlle Nadia Boulanger s'est affirmée une fois de plus une remarquable symphoniste. Mlles Lamare et Winsbach et M. Plamondon, qu'accompagnaient M. Marcel Dupré et Mlle Boulanger elle-même, ont été ses excellents interprètes.
M. Flament a obtenu une mention honorable, et cette récompense a un peu surpris. Certes, son œuvre est consciencieuse, bien écrite ; on y sent le travail appliqué d'un musicien, maître de sa technique, mais l'inspiration ne témoigne pas d'une puissante originalité. Il n'apparaît pas nettement pourquoi cette cantate a été préférée à celle de M. Marc Delmas, homme de théâtre évidemment, au tempérament plus dramatique, ayant le sens de la vie et du mouvement, cantate dont la partie principale, le thème de la Sirène, m'a semblé fort remarquable.
Et l'œuvre de M. Tournier n'était-elle pas d'une inspiration jolie, avec de la fraîcheur et un sentiment assez heureux, pareil à la musique qui l'exprimait ?
Je crois que le succès de M. Flament est dû à une interprétation parfaite, et je veux particulièrement complimenter Mlle Rose Féart, admirable chanteuse et artiste vraiment secourable aux compositeurs hésitants. Mlle Lassalle et M. Corpait, très bien accompagnés par MM. Galabert et Flament, la secondèrent adroitement.
De quoi il serait téméraire de conclure que Mlles Demellier et Laute-Brun, et M. Fernand Lemaire, Mlles Gall et Vauthrin, M. Dantu et les musiciens Boulnois et Mme de Faye-Jozin, interprètes de MM. Tournier et Delmas, ne méritèrent pas les plus grands éloges.
Ferdinand Fauré
NDLR : André Gailhard, décédé le 3 juillet 1966 à Ermont (Val-d'Oise), Grand Prix de Rome 1908, est aussi l'auteur de plusieurs opéras dont Amaryllis (Toulouse, 1906), La Fille du soleil (1910), Le Sortilège (Paris, 1913) et La Bataille (Paris, 1931), et d'une Suite orientale pour orchestre (Choudens). On lui doit aussi des musiques de films, notamment pour Sous les toits de Paris de René Clair (1930), en collaboration, et La route est belle de Robert Florey (1929), également en collaboration. Son père, Pierre (dit Pedro) Gailhard (1848-1918), célèbre basse fut nommé directeur de l'Opéra de Paris en 1893.
 |
| Nadia
Boulanger (1887-1979), Grand Prix
de Rome 1908, professeur à l'Ecole
Normale de Musique, au CNSM et
directeur du Conservatoire
Américain de Fontainebleau, en
grande conversation avec Marc
Delmas (1885-1931), Grand Prix de
Rome 1919, compositeur dramatique.
( photo
Philippe Hutin, 1907 )
|
 |
| Classe d'accompagnement de
Nadia Boulanger au Conservatoire
National Supérieur de Musique de
Paris en 1954-1955. Debout au fond, de gauche à droite : [un invité occasionnel], Bruno Gillet (prof. Au CNSMP), Georges Humbrecht, Cyril Squire (directeur du Conservatoire de La-Chaux-de-Fonds, Suisse), Irving Heller (pianiste, prof. au Conservatoire de Montréal, à l’Université Mc Gill de Montréal et à Ottawa, directeur artistique du Concours international de musique de Montréal à partir de 1968), Ursula Clutterbuck (accompagnatrice recherchée au Conservatoire de Montréal), Dean Witter (pianiste et compositeur Californien), Elisabeth Van Asbeck (pianiste, épouse du violoniste hollandais Bé Feldbrugge). En plan rapproché, à gauche : Jean-Jacques Normand (critique musical), Evelyne Crochet [vêtue de noir] (pianiste franco-américaine), Françoise Lengelé (prof. au Conservatoire de Lyon). Au piano à la gauche de Nadia Boulanger : Dominique Merlet (pianiste, organiste, prof. au CNSMP). A droite, derrière Idil Biret [souriante] : Robert Gardel (pianiste, chef d’orchestre à l’Opéra), Easley Blackwood jr. [de profil] (pianiste, prof. au Conservatoire de Chicago). ( coll. Hélène Gabor-Humbrecht - aide à l'identification: merci à Idil Biret) |
|
|
| Signature autographe de
Nadia Boulanger ( Coll. Céline Fortin ) |
 |
| Compiègne en 1910, lors du Concours du Prix de Rome (fragment photo Hetuin, coll. J. Cabon) DR. |
Entretien en 1957 avec Edouard FLAMENT (1880-1958)
Gabriel Bender [1884-1964, musicologue, directeur et fondateur en 1910 de la revue Guide du concert] — La scène est divisée en deux parties. D'un côté, une vingtaine de scrutateurs pointent des bulletins de vote. Agitation fiévreuse. De l'autre, des instruments : piano, violon, basson... Au milieu, un tableau noir : des noms et des chiffres...
Edouard Flament — Oui... je me souviens : le concours des chefs d'orchestre. Chevillard aux prises avec Pierné...
— Si la Salle Gaveau, disait Chevillard, avait été plus grande que le Châtelet, j'aurais battu Pierné.
— Il est arrivé au poteau après Pierné ?
— Je viens de revoir les chiffres. Pierné : 2.444 voix, et Chevillard : 2.101. Mais, il ne s'agissait pas de décerner aux chefs d'orchestre un certificat de bonne conduite. Non, seulement une cote d'amour. Et puis, le Guide du concert avait greffé sur ce plébiscite un concours doté de nombreux prix dont un piano Pleyel et un violon Marc Laberte. Vous étiez venu étrenner le premier, et René Bas, le second.
— Oui, Et j'avais aussi accompagné des mélodies chantées par Cécile Winsback et par Panzéra.
— Un vieux souvenir... juin 1922 ! Depuis, vous ai-je rencontré deux ou trois fois ?... Un jour, je me suis aventuré dans vos parages, mais votre concierge m'a dit : « Edouard Flament, oui, c'est bien ici. Il joue du piano tout le temps, et quand on sonne chez lui, il ne répond pas. Le mieux, pour le voir, c'est de vous promener entre le pont d'Asnières et le pont Bineau, vers treize heures. Vous le trouverez en train de regarder passer les bateaux. II prétend que ça lui donne le « rythme de sa vie »... C'est bien joli, mais, je n'aurais pas eu l'idée de comparer le rythme de votre vie à celui si tranquille des bateaux. Vous avez mené de front les carrières de compositeur, de chef d'orchestre, de pianiste, de bassoniste, et votre catalogue accuse, provisoirement, cent soixante-dix œuvres...
— Aussi ai-je besoin de regarder passer les bateaux pour donner, ou plutôt redonner, à ma vie un rythme normal.
— Tout s'explique. Essayons donc de prendre le rythme de votre vie. Vous êtes, je crois, natif de Douai. Je dis : je crois, parce que votre opus 8 s'intitule Douai déborde, revue locale, votre opus 97 : Carillon de Douai, et votre opus 120 : 5° Symphonie Douay, dite Symphonie des géants — votre « Héroïque » !
— Je suis Douaisien, en effet. Né le 27 août 1880 dans la rue du « Pied-d'Argent », non loin de « La Scarpe d'argent »... C'est assez dire, sans le secours d'une extra-lucide, que j’étais né pour exercer un métier d'argent.
— Aussi fûtes-vous enfant prodige ?
— Mieux, j'essaie de le rester. Comme Saint-Saëns qui me disait à la fin de sa vie : « Je suis toujours un enfant prodige » — et c'était vrai.
— Votre instrument de prodige : le piano ?
 |
( Coll. DHM ) DR |
— Non. Le tambour. Un superbe tambour que ma grand-mère m'avait rapporté de l'Exposition, celle de 1889. Ma réputation de virtuose fut vite établie, et l'on me demanda d'accompagner les danses des « Marionnettes Lafleur ». Nous allions, d'estaminet en estaminet, donner des représentations, à la lueur des quinquets à pétrole, et je gagnais vingt sous par soirée, une jolie pièce d'argent de un franc.
— Puis, vous avez troqué le tambour contre le basson.
— En 1894, le directeur de l'Académie de Musique me fit venir dans son bureau et me dit froidement — il est vrai qu'il gelait à pierre fendre — : « Jeune Flament, j'ai décidé que vous joueriez du basson. Vous viendrez à la classe demain matin à six heures et demie. » Et il me remit une espèce de petit cercueil en bois noir contenant l'instrument. Je sortis affolé, dégringolai l'escalier, glissai, m'étalai de tout mon long, en envoyant dans la neige les morceaux du basson...
— Ce mauvais début ne vous a pas empêché de décrocher un premier prix au Conservatoire dans la classe Bourdeau, ni de devenir, par la suite, sociétaire des Concerts Lamoureux (1898), basson solo au Théâtre Lyrique (1899), fondateur de la Société Moderne des Instruments à Vent, de la Société des Instruments Anciens et du « Double Trio », président du Jury au Conservatoire...
— Quelle mémoire !
— Et je puis même ajouter — toujours en m'aidant de votre curriculum — que vous avez créé la Sonate de Saint-Saëns (1921), le Bal de Béatrice d'Estre de R. Hahn ; que des œuvres vous ont été dédiées : Divertissement de Roussel, des Quintettes de Caplet, Magnard, etc... ; que vous avez écrit sur le basson dans l'Encyclopédie Lavignac, et pour le basson un concerto, des exercices, etc... dont une étude sur le « grattage des anches ». Voilà qui est précis... Le basson est mort, vive le piano !
— Elève du grand Francis Planté. Accompagnateur au Conservatoire (1899-1919). Pianiste au Poste parisien, Radio-Paris, Radio L. L. Accompagnateur de Litvinne et d'Yvette Guilbert. Séances de sonates avec Marsick et Hollmann...
— Parfait. Nous menons un train !... La voie est libre ? Parlons de Flament compositeur... Non. Il y a Flament maestro.
— J'ai dirigé les Diaghilew : Biches, Fâcheux, Train bleu..., les Concerts classiques de Marseille, de Fontainebleau, de Nantes (Schola), de Bordeaux (Conservatoire, 1930 à 1936), de Monte-Carlo, Trianon, Gaîté-Lyrique, Mogador, province, radio, Londres (Coliseum), Barcelone (Liceo), Berlin (Opéra)... Ouf ! Je m'arrête un instant. Avec Diaghilew, après une répétition au, Gewand-haus de Leipzig, nous descendons le grand escalier. Une statue monumentale nous barre le chemin : Félix Mendelssohn Bartholdi ; je m'incline profondément. — Que pensez-vous de celui-ci ? dit Diaghilew. — De toutes ses œuvres, son Concerto de violon est la plus belle. Après lui, c'est le Concerto pour piano de Schumann que je préfère. Diaghilew trouva cette réponse satisfaisante...
— Qu'importe ! Mais vous venez d'entrer tout de go dans le vif de cet entretien. Si je vous avais demandé votre profession de foi de compositeur, vous m'auriez probablement répondu d'une façon évasive, tandis que, connaissant vos préférences musicales, il n'y a plus qu'à appliquer le « dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es »... Autre indication : au Conservatoire, vous avez eu plusieurs professeurs, mais c'est a Georges Caussade, m'avez-vous dit, que vous réservez une particulière reconnaissance. Pourquoi ?
— Il était un maître de la construction musicale, un grand architecte des sons.
— N'en puis-je déduire que vous attachez une grande importance à la structure, à la forme ?
— Je crois, en effet, qu'il n'y a pas d'œuvres vraiment belles qui ne soient solidement charpentées. Mais je dirais aussi qu'il n'y en a pas qui ne soient inspirées par le cœur. En fait, je suis très éclectique, et n'ai pas peur de l'avouer. J'aime et j'admire les classiques, et Mozart, et Beethoven, et Wagner, et Debussy, et Ravel avec qui j'ai eu l'honneur d'être recalé au Concours de Rome — car il fut aussi recalé —, et Strawinsky dont j'ai encore dans les oreilles la « Danse sacrale » et « Les Noces » (création avec quatre pianos : Mlle Meyer, Poulenc, Auric et votre serviteur), et Prokofieff dont, après « Chout », j'ai travaillé la 3e Sonate, et mon petit ami Bela qui fut avec moi au Concours Rubinstein en 1905 et qui est devenu le grand Bartok, roi du dynamisme...
— Un mot qui n'était pas encore à la mode il y a cinquante ans... Vous êtes éclectique, mais dans le meilleur sens du terme.
— Au théâtre, mon éclectisme est encore plus étendu et quelque peu différent. Par exemple, si je considère qu'au concert le début du « Requiem » de Fauré et le « Psaume » de Florent Schmitt sont des chefs-d’œuvre définitifs, au théâtre j'admire le final du second acte de « Proserpine » de Saint-Saëns, et l'orchestration de « Manon » de Monsieur Massenet m'enchante.
— C'est encore faire preuve d'un éclectisme de bon aloi.
— Et si je vous disais que « Paillasse » me paraît être une excellente œuvre de théâtre, et que je considère le « Quo vadis ? » de Jean Nouguès et surtout l'acte du « Tibre », comme étant du grand théâtre ? Il faut donner au public le théâtre qui lui convient.
— C'est une opinion très contestable. Mais je me borne à constater qu'elle n'engage pas votre goût personnel. Elle montre tout au plus que vous placez bien bas le public de nos théâtres lyriques.
— Molière n'a-t-il pas dit à peu près que son travail était fait quand une pièce plaisait à la foule ?
— II se fiait volontiers aux réactions du parterre... Mais c'était tout de même du Molière... Assimilez-vous la musique de film à la musique de théâtre ?
— Au cinéma, le compositeur doit être le serviteur des images, et ne jamais tirer à lui la couverture.
— C'est une profession de foi.
— Ma profession de foi tiendrait en un titre d'œuvre : « Le Clavecin bien tempéré », et dans un mot aussi : le travail. « Il faut travailler toujours, disait Péguy, sans jamais regarder en arrière ; pendant dix ans, pendant vingt ans, vous n'écrirez que des banalités, et puis, un beau jour, sans l'avoir fait exprès, vous aurez écrit un chef-d'œuvre ! » Travailler, c'est encore plus simple que de suivre le conseil de Ravel, après ses « Jeux d'eau » : « Lisons Edgar Poe : la genèse d'un poème... le théorème de Sabine... la loi de Fechner... le traité des harmoniques de Gurr... » Travailler... et laisser « cancoanner les mamamouchis »... Travailler, sans chercher à tout expliquer. J'évoquais, il n'y a pas longtemps, un souvenir de jeunesse. Le 13 juillet 1896, on déchira le voile qui cachait la statue de la poétesse douaisienne Marceline Desbordes-Valmore. L'orchestre joua une cantate. Catulle-Mendès s'approcha du pupitre des bassons, et me dit en me montrant la statue : « Sa voix était grosse comme celle du basson ! » Qui me dira pourquoi cette réflexion banale a donné naissance, soixante ans plus tard, à une symphonie ?...
Edouard Flament est parti, au « rythme de sa vie », travailler à sa nième Symphonie, et avec ses chœurs.
Gabriel BENDER
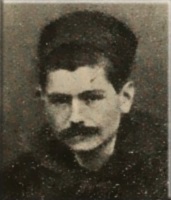 |
| En uniforme de zouave et alors malade, 1916 (photo Manuel, coll. DHM) DR. |
NOTULE BIOGRAPHIQUE : Fils d'Edouard FLAMENT, calligraphe expert (c.1855-1942) et de Léonie Duhaut (c.1858-1914), Edouard FLAMENT, compositeur, pianiste, bassoniste et chef d'orchestre, né le 27 août 1880 à Douai (Nord), décédé le 27 décembre 1958 en région parisienne, à Bois-Colombes, effectua ses études musicales au Conservatoire de Paris. Il y fréquenta, entre autres, les classes de basson d'Eugène Bourdeau (1er prix en 1898 avec un Solo de concert de Gabriel Pierné), d'harmonie d'Albert Lavignac (2e accessit en 1899), d’accompagnement au piano de Paul Vidal (1er accessit en 1904), de contrepoint et fugue de Charles Lenepveu (2e prix en 1906). Par ailleurs, il fut également élève de piano de Francis Planté. Il s'était présenté à 4 reprises au Concours de Rome, entre 1906 et 1910, et remporta une mention honorable, derrière André Gailhard (1er grand Prix) et Nadia Boulanger (deuxième second grand Prix), à celui de 1908 avec la cantate La Sirène sur des paroles d'Eugène Adenis et Gustave Desveaux-Vérité. Son catalogue comporte au total près de 200 œuvres, ainsi qu'une vingtaine de musiques de films principalement composées dans les années trente, dont notamment celle du Mystère de la chambre jaune de Marcel L'Herbier (1930) et celle du Sang du poète de Jean Cocteau (1931) en collaboration avec Georges Auric. Plusieurs autres compositions de musiques légères sous le pseudonyme de Théo Noletty sont aussi à mettre à son actif. Bassoniste à l'Orchestre des Concerts Lamoureux et à la « Société des instruments à vents », comme chef d'orchestre on lui doit la direction de celui des ballets russes de Serge Diaghilev avec lequel il crée à Monte-Carlo, le 6 janvier 1924, le ballet avec chant en 1 acte Les Biches de Francis Poulenc, suivie d'une tournée à Barcelone, et l'année suivante la direction musicale du Grand Théâtre d'Angers. En 1927, il occupait le poste de chef au Théâtre des Ternes à Paris où il dirigeait les « Samedis musicaux » et sera encore chef à Radio-Paris. Son poème symphonique Oceano Nox, d'après Victor Hugo, exécuté pour la première fois le 25 octobre 1908 par l'orchestre de l'Association des Concerts Lamoureux, sous la direction de Camille Chevillard, est l'une de ses œuvres les plus marquantes, plusieurs fois rejouée, particulièrement Salle Gaveau à Paris, le vendredi 16 juin 1916 lors du 1er Festival de Musique Française. Mobilisé (classe 1900) le 4 août 1914 au 4e Régiment de Zouaves, il fut mis en retraite temporaire, pour maladie contractée en service, le 1er décembre 1915. Il était marié (1913) à Victoria-Léonie Buriau (1886-1968).
D.H.M. (novembre 2016)
ESSAI
CATALOGUE DES ŒUVRES
par Gabriel Bender (en
1956)
| Opus: — 1. : « Elégie », basson et orgue (édité) — 2. « Le dernier épi », ténor (édité) — 3. « Lamento », «Fantasia», piano (édité) — 4. « Rêve d'enfants», « Rapsodie Izigrane », p. (édité) — 5. « Aubade », v. et p. (édité) — 6. « Rosiane », 2 actes (édité) — 7. « Poème nocturne», p. et instr. à vent — 8. « Douai », revue — 9. « Pièces » v. et p. (édité) — 10. « Allegro» p. (édité) — 11. « Séparation », ténor. — 12. « Trio en la », v. vlle et p. — 13. « Concertstück », basson et orch. (édité). — 14. « Sonate », vlle et p. (édité) — 15. « Concertstück », p. et orch. (édité) — 16. « Le moissonneur », mélodie — 17. « Chanson du vannier », chœur — 18. « A l'aube », choeur. — 19. « Oceano Nox », poème symph. (édité) — 20. « Barcarolle », p. (édité) — 21 « Exercices » — 22. « Capriccio » p. (édité) — 23. « Variations » — 24 et 25. Chœurs — 26. « La Sirène », scène mus. — 27. Chœur. — 28. « Fantasia con fuga » « vent » (édité) — 29. « Soleils », chœurs — 30. « Ave Maria ». — 31, 32, 33. Mélodies (édité) — 34 et 35. « Renouveau », « Nuit », choeurs — 36. « Fontaine de Castalie », 1 acte — 37. « Le cœur et la rose », 1 acte — 38. « Rapsodie », harpes — 39. « Variations », double quintette. — 40. « Exercices », basson — 41. « Ballade », orch. — 42. « Mélodie » — 43. « Air », 2 bassons — 44. « Marche » — 45. « Preludio » — 46 et 47. Mélodies — 48. « Course » (édité) — 49. « L'orgue », ch. — 50 à 52. Mélodies — 53. « Lydie », « Thyrsis ». orch. — 54. « Fantaisie » (édité) — 55. « 2e Sonate », vlle et p. (édité) — 56 et 57. « 2 Tableaux symph. » — 58. « Cimaise », orch. — 59. « Preludio » (édité) — 60. « Nocturne », orch. (édité) — 61. « Ouverture », orch. — 62. « Sérénade» (édité) — 63. « Rolla », orch. (édité) — 64. « Gringoire et Nicole », orch (édité) — 65. « Gavotte », « Aveu » — 66. « Printemps » (édité) — 67 à 69. « Quand dansait », « Orientale », « Hymnes », « Pardon », « Danse » (édité) — 70. « En attendant le coche », opérette (édité) — 71. « Symphonie en la » — 72. « Pièces » — 73. « Andromède » — 74. « Nantas », prél. — 75. « Ronde » (édité) — 76. « Poème pastoral » — 77. « 4 Pièces » (édité) — 78. « Lovelace », ouv. (édité) — 79. « Francesca » (édité) — 80. « Evocations » (édité) — 81. « Orage » (édité). — 82. « Alla fuga » — 83. « Pièces » (édité) — 84. « Suite symph. » (édité) — 85. « Prélude » (édité) |
—
86. « Au
désert » — 87. « Légende », ballet — 88. « Allegro » (édité) — 89. « Mariage villageois » (édité) — 90. « Pièces » (édité) — 91. « Pastels » (édité) — 92 et 93. « 6 Pièces » (édité) — 94. « Romance », vlle (édité). — 95. « Course » — 96. « 8 Pièces » (édité). — 97. « Carillons », « Cantiques » — 101. « Symphonie en mi min. » — 102. « Poème » — 103. « Inventions », p. (édité) — 104. « Suite », quat. — 105. « Elégie ». — 106. « Aiglon », « Fétiche », films — 107. « Pagode », « La Maternelle », films (édité) — 108. « Quintette », fl. et cordes — 109. « Sextuor » — 110. « Sinfonia radio » — 111. « Vagues » — 112. « 3° Symphonie » avec chœurs — 113. « Variations radiophoniques » — 114. « Préludes » — 115. « Fantaisie » — 116. « Ouverture » — 117. « Chœur » — 118. « A 2 pianos » — 119. « 4° Symphonie » — 120. « 5° Symphonie » — 121. « Concerto I » p. et orch. — 122. « Inventions » — 123. « 6e Symphonie » — 124. « Suite » — 125. « Fantaisie radio » — 126. « Suite », quint. — 127. « Pièces » — 128. « Suite », trio. — 129. « Sérénades » — 130. « Sextuor » — 131. « Concerto II » — 132. « Concerto », bas. et vlle. — 133 à 135. Mélodies — 136. « Nonetto » — 137. « Divertimento » — 138. « Pièce », tuba — 139. « Quintette », 5 bas. — 140. « Etudes » — 141. « Piano Bar » — 142. « Pièces », bas. — 143. « Chansons » — 144. « Quatuor », 4 bas. — 145. « M. Favart » — 146. « Divertimento » — 147. « 7° Symphonie » — 148. « Nocturne » — 149. « Ouverture.» — 150. « Concerto III », p. — 151. « Sonate », saxo alto — 152. « Sonate », alto et p. — 153. « Divertimento » — 154. « Sonate », v. et p. — 155. « Quatuor vocal » — 156. « Lydéric et Rosèle », 3 actes — 157. « Concertino », bas. — 158. « Concerto IV », p. — 159. « Sonatina », bas. — 160. « Ballade », orch. — 161. « 2° Quatuor » — 162. « Appassionato » — 163. « Suite » — 164. « 8° Symphonie » avec chœurs — 165. « Sonate », p. — 166. « Fantaisie », hautb. — 167. « 3e Quatuor » |
 |
| Programme concert à Paris du 16 juin 1916 (coll. DHM) DR. |
1909
 |
|
( Photo H. Manuel, 1909 ) DR. |
Hommage à Jules Mazellier
 |
| Mazellier (de face) au château de Compiègne pour l’épreuve du Prix de Rome, juin 1909 (Musica, 1909) DR. |
Jules Mazellier vient de mourir [1959]. Né à Toulouse le 6 avril 1879, il appartenait à cette génération de compositeurs du début de ce siècle, tous Prix de Rome, génération qui forma les musiciens de notre école actuelle. Elève de Lenepveu, c'est en 1909, avec sa cantate La Roussalka, qu'il remporta la récompense suprême, après avoir obtenu le second Grand Prix en 1907. Chef d'orchestre de l'Opéra-Comique de 1918 à 1922, il a été professeur de la classe d'ensemble vocal au Conservatoire de Paris, de 1930 à 1945.
Mazellier consacra la plus grande part de son activité au théâtre lyrique. De son séjour à Rome [1910 à 1913], il rapporta la partition d'une comédie lyrique : La Villa Médicis, créée à Nice, et celle d'un drame lyrique, Graziella, sur un livret de Raoul Gastambide [et d'Henri Cain, d'après Lamartine] : cette dernière œuvre ne vit les feux de la rampe qu'en 1925, à l'Opéra-Comique, après avoir été bien accueillie au Capitole de Toulouse, en janvier 1914, et à Rouen en 1919.
Le 16 décembre 1927, l'Opéra représente Les Matinées d'Amour, fabliau-miracle, également sur un livret de Gastambide : commentant fidèlement cette « imagerie de missel », la musique atteste un métier consommé.
On doit également à Jules Mazellier une comédie musicale d'après Courteline, Boubouroche et un opéra-bouffe, Oreste et Pylade, qui datent de 1928 ; Le Pater, drame lyrique d'après François Coppée (Toulouse, 1929) ; Mirandoline, comédie musicale (1929) ; Esquisse, comédie musicale en un acte, sur un livret d'André Baugé (Porte Saint-Martin, 1934), Paufin, comédie musicale de Gastambide (Porte Saint-Martin, 1935) ; Cœur de Paris, opérette en 3 actes de José Germain (Radio et Grand Théâtre de Nancy, 1950) ; Un baiser... ce m'est rien, comédie musicale donnée intégralement sur les ondes de la R.T.F., en février 1955, etc. ; ainsi que des musiques de scène.
Compositeur symphonique, il a fait exécuter une ouverture dramatique, Circences (1907), des suites d'orchestre (Impressions d'été) [1911], un Poème romantique pour violon et orchestre (Concerts Lamoureux, 1934), Cinq chants pour violoncelle et orchestre, Scherzo, choral et variations [sur un thème unique] pour piano et orchestre [Eschig], etc. Compositeur de musique de chambre, il a écrit notamment un Quatuor à cordes en si majeur (couronné du Prix Chartier de l'Institut), des pièces pour le piano et pour divers instruments. Les concours du Conservatoire lui sont redevables de plusieurs morceaux dont certains ont été orchestrés.
Dans le domaine de la musique vocale, il a composé un Cantique nuptial pour soli, choeur et orchestre exécuté en l'église Saint-François-de-Sales en 1943 ; un poème lyrique L'Arc et le Dôme, des chœurs, des mélodies, dont le recueil Le livre chantant (Salle Gaveau, 1943).
Ayant connu la notoriété en son temps, Jules Mazellier vivait désormais dans une discrète retraite. Dernièrement, en lui décernant un de ses prix annuels, l'Institut lui a rendu un hommage mérité.
Pierre Debièvre
(Guide du concert,
1959)
Glanes biographiques supplémentaires
Fils d’Hippolyte Mazellier, « agent des ponts et chaussées » à Toulouse, et de Marie-Louise Galinier, Jules-Marius Mazellier est décédé précisément le 6 février 1959 à Paris. Il avait épousé à Paris en 1929 la soprano dramatique Marthe Ingrand de l'Opéra-Comique, à laquelle on doit notamment la création en 1927 à l'Opéra des Matines d'Amour, fabliau-miracle en trois images de Raoul Gastambide, musique de Jules Mazellier, avant d'être donnés le 31 mars 1933 au Théâtre du Capitole de Toulouse (et diffusés par radio), avec l'auteur à la tête de l'orchestre. Née à Paris en 1902, élève du Conservatoire de Paris, premier prix de chant en 1927 dans la classe du ténor Emile Engel et la même année second prix d'opéra-comique (classe de Thomas Salignac), elle avait débuté à l'Opéra-Comique le 11 mars 1928 avec le rôle de Miss Rose dans Lakmé de Léon Delibes et chantera plus tard dans ce même théâtre, entre autres rôles, Fraquita (Carmen, Bizet), Lola (Cavalleria rusticana, Mascagni), Camille, Gavroche (Louise, Charpentier). Emile Mazellier (1872-1933), frère de Jules, avait quant à lui épousé la fille de Georges Hodin, adjoint au Maire de Reims et président du parti radical rémois...
En dehors des œuvres citées dans l'article de Pierre Debièvre, mentionnons encore : Complainte pour Noël pour piano (Billaudot), Nocturne pour piano (Billaudot), 4 Versets pour orgue (United Music Publishers, Londres), Contemplation pour violon et orchestre ou piano (Combre), Ballade pour violon et piano (1954, Eschig), Bercelonnette pour violon et piano (Billaudot), La Fileuse pour violoncelle et piano (morceau de concours du Conservatoire national, 1941, Eschig), Divertissement pastoral pour flûte et piano (Leduc), Fantaisie-Ballet pour clarinette et piano (Leduc), Prélude et Danse pour basson et piano (1931), Thème varié languedocien pour hautbois solo ou saxophone alto et orchestre ou piano (Salabert), 10 Fugues pour 4 saxophones (Lemoine), Rhapsodie montagnarde pour cor et piano (Salabert), Poème lunaire pour voix et piano, Prière de Saint-François d'Assise pour soprano ou contralto, ténor ou baryton, violon, violoncelle et orgue (Eschig), Cœur de Paris, opérette en 3 actes, paroles de José Germain (1950) et un Quatuor en sol mineur pour cordes, composé en décembre 1939 et janvier 1940, remanié et terminé le 13 mars 1951, notamment donné le 18 mars 1959 à la Société Nationale (Eschig), portant pour sous-titre général « La mort et la vie » et pour chacun de ses 4 mouvements dans lesquels le thème de la mort se retrouve : I. « La mort implacable rôde sur la terre (lento doloroso, allegro moderato), II. « L'esprit du malin appelle nos désirs » (scherzo), III. « L'ange de clarté dissipe les ténèbres » (andante), IV. « La vie s'exaspère désespérément » (allegro vivo). On lui doit aussi un ouvrage d'enseignement : 500 Dictées musicales à 1, 2, 3 et 4 voix classées par ordre progressif et par tonalité, 9 séries en 4 volumes (Eschig).
En 2012, la comédie lyrique en trois actes La Villa Médicis, archivée à la bibliothèque de l'Académie de France à Rome (Villa Médicis), a été redécouverte par Francesco Filidei, compositeur italien en résidence. Retravaillée pour une version de concert d'une heure sous forme d'un condensé du drame resserré autour de trois personnages, elle est donnée l'année suivante, le 18 octobre 2013, dans le cadre du festival Autunno in Musica à la Villa Médicis, par Florian Cafiero (ténor, rôle de Gilbert, peintre), Virginie Pochon (soprano, Fiorellina, jeune modèle), Aurore Ugolin (mezzo-soprano, Mariette, ancien modèle) et Jeff Cohen (piano). Cet opéra, racontant l'histoire d'un amour entre un peintre, pensionnaire de la Villa, et son modèle, avait été créé au Casino de Nice en 1923.
Denis Havard de la Montagne
Marcel TOURNIER (1879-1951)
 |
 |
| Marcel Tournier, Au seuil du Temple extrait de la Suite n° 1, op. 29, Trois Images pour harpe, dédicacées "à Micheline Kahn" (Paris, éditions Henry Lemoine, 1925) DR. |
|
 |
| Marcel Tournier (1879-1951), second Grand Prix de Rome 1909, professeur de harpe au Conservatoire de Paris de 1912 à 1948 auquel succédera Lily Laskine ( Musica, 1912 ) DR |